|
|
|
Présence de Louis Mercier
A contretemps n° 8 (juin 2002) spécial Louis Mercier
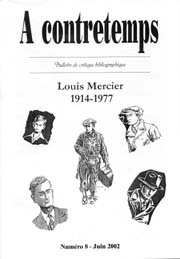
D. BERRY, A. BERTOLO, S. BOULOUQUE, P. CASOAR, M. ENCKELL, C. JACQUIER
Présence de Louis Mercier (ACL, 1999, 128 pages, illustrations : P. Casoar)
L’ouvrage que nous présentons ici – et qui sert de base à ce numéro spécial d’A contretemps – offre l’avantage de mettre à jour le parcours militant de Charles Cortvrint, alias Charles Ride]], alias Louis Mercier. Prolongeant un colloque organisé à Paris en 1997 par le Centre international de recherche sur l’anarchisme (CIRA), Présence de Louis Mercier s’attache à suivre les pas d’un anarchiste proprement hors du commun qui, sous l’un ou l’autre de ses pseudonymes et fausses identités, traversa l’histoire sociale du XX’ siècle et, quelles que fussent les circonstances, s’entêta à comprendre le monde pour mieux le combattre au nom d’une indispensable lucidité libertaire. « Je suis à moi seul une fédération de pseudonymes », avait coutume d’affirmer Louis Mercier, éprouvant sans doute un malin plaisir à brouiller les pistes de sa biographie. Marianne Enckell [1], qui le connaissait bien, nous restitue pourtant à grands traits, en ouverture d’ouvrage, l’itinéraire – multiple et complexe – de cet homme qui adopta, dès son plus jeune âge et sans jamais le renier, l’anarchisme comme écrin définitif de ses révoltes et de ses doutes, de ses espoirs et de ses tourments. C’est jeune, en effet, que le Bruxellois Charles Cortvrint – né en 1914 – découvre les vertus roboratives de l’idée libertaire. Il a seize ans et fréquente déjà quelques figures illustres de l’anarchisme local, comme le libraire Hem Day et le réfractaire russe Nicolas Lazarévitch. Quelques années plus tard, on le retrouve dans le Paris des années 1930. II n’a pas répondu aux sollicitations de l’armée, il s’appelle désormais Charles Ridel et il vivote – petits boulots et expédients –, avant d’assurer pour un temps la noble fonction de correcteur et de rejoindre ce que, faute de mieux, on a appelé l’aristocratie ouvrière. Ce qui l’intéresse, Ridel, c’est la mêlée sociale, le syndicat, l’Union anarchiste, le communisme libertaire, les groupes d’usine, mais c’est aussi les copains de sa bande – les « Moules-à-gaufres » –, la marginalité, l’expérimentation individuelle, la vie en somme. La sienne sera tumultueuse et nomade, il le sait. En mai 1936, il est au congrès de la CNT à Saragosse. En juin, il s’entête à croire que le front social vaut mieux que le front populaire et s’agite dans les usines en grève. En juillet, il touche sa paye et part rejoindre la colonne Durruti avec son pote Charles Carpentier.
Cet épisode espagnol, Phil Casoar [2] le traite sous deux aspects. Il s’attache, d’une part, à situer la participation de Ridel à la révolution espagnole en nous restituant l’histoire de ce groupe international de la colonne Durruti qui recruta « des Italiens antifascistes, des Allemands antinazis, des Français, des Belges, des Suisses, des Bulgares ayant fui la terreur blanche, voire un Ukrainien rescapé de la Makhnovtchina » . Il aborde, de l’autre et par le détail, la polémique sur l’éthique révolutionnaire qui, longtemps après les faits et à titre posthume, opposa Ridel – devenu Louis Mercier – à la philosophe Simone Weill. Cette guerre civile le marqua durablement et instilla en lui la profonde nostalgie d’une époque où, pour l’anarchiste qu’il était, l’engagement ne souffrait aucun doute. D’un côté, un ennemi immédiatement identifiable, archétypique pourrait-on dire, l’alliance du sabre, du goupillon et du capital ; de l’autre, un « prolétariat conquérant », majoritairement anarcho-syndicaliste et décidé à porter l’espoir de la révolution sociale aussi loin que possible au risque de périr sous les balles du vieux monde. Après l’Espagne, jamais plus combat ne sera, pour les libertaires, aussi évident, aussi clair. Tous ceux qui suivront induiront des hésitations, des interrogations, des pièges et des compromis, car les libertaires n’y seront plus les maîtres du jeu, mais des comparses à peine tolérés et soumis à toutes les manipulations. D’où la force de la référence espagnole pour les combattants du « bref été de l’anarchie »ineffaçable dans l’imaginaire et source d’un éternel regret.
L’Espagne fut bien sûr cela, mais elle fut aussi pour l’anarchisme, force dominante, l’épreuve des faits, cet instant de vérité où la confrontation avec le réel provoque l’éclatement des schémas établis et précède le temps des bilans. Charles Ridel y prend sa part. Rentré en France, en octobre 1936, il « troque son Mauser contre un projecteur de cinéma » et parcourt le pays comme conférencier de l’Union anarchiste pour y porter la bonne parole. De l’autre côté des Pyrénées, il sait pourtant que rien ne va plus : la CNT et la FAI participent au gouvernement, la révolution recule, le stalinisme progresse, les libertaires perdent la bataille de Mai 1937 à Barcelone. Dès lors, il entre en dissidence avec l’Union anarchiste, dont il juge la position suiviste et trop alignée sur celle du mouvement libertaire espagnol, et la quitte en novembre 1937. L’antifascisme en a fini avec la révolution et, en se rangeant sous sa bannière, l’anarchisme a cédé sur l’essentiel, faisant lui-même le lit de la contre-révolution. Telle est la leçon essentielle que Ridel tire de l’épisode espagnol, mais il semble hésiter encore sur la voie à suivre désormais : l’adoption d’une ligne communiste libertaire pure et dure, celle d’un syndicalisme révolutionnaire d’action directe au sens large ou encore la profonde révision des anciens contenus et pratiques d’un mouvement dont la déroute est alors évidente à ses yeux. Pour un temps, il suivra ces trois voies simultanément.
En février 1938 naît la revue Révision dont la profession de foi indique : « Il serait temps de dire ce que l’on pense et de penser ce que l’on dit. Première révolution à accomplir chez les révolutionnaires. » Ces révolutionnaires, qui sont–ils ? Majoritairement des libertaires en rupture de ban, mais également des pivertistes et des marxistes
critiques, tous convaincus que « le mouvement ouvrier a besoin d’une révision idéologique et stratégique profonde ». David Berry [3] consacre sa contribution à cette expérience originale à laquelle participera Charles Ridel et qui, là encore, dégage des pistes pour comprendre certaines constantes de son parcours futur. Alors membre du Cercle syndicaliste « Lutte de classes » et collaborateur du Réveil syndicaliste, Ridel est convaincu que l’anarchisme court un risque majeur en cultivant son intemporalité, celui de sombrer dans l’inconsistance. Cette idée d’une permanente volonté d’adéquation de l’anarchisme à des réalités mouvantes et inédites deviendra la pierre angulaire de son cheminement intellectuel. En cela, la critique de l’anarchisme que Ridel opère, à travers Révision, constitue pour partie le socle de ses engagements ultérieurs.
C’est à cette époque qu’il établit clairement une typologie négative de l’anarchisme : son atavisme antiorganisationnel, l’élasticité de sa doctrine, son imprécision théorique, son goût pour les généralités hâtives. Il déroge même aux convenances, en dénonçant un « anarchisme de gouvernement » fait de connivence avec le républicanisme radical, coupé de toute dimension sociale et « où le bon-cœurisme et les sentiments humanitaires débordent », portés par « les vieilles barbes "indépendantes" et les cabotins de la larme à l’œil ». Le ton est rude, tranchant, sans concession. Tout y passe : l’antifascisme sans contenu de classe et l’empressement de la CNT et de la FAI à capituler « en surenchérissant d’esprit réaliste » et « à endosser avec satisfaction le complet veston de ministre ou de conseiller ». Seules surnagent de ce chaos critique deux figures mythiques de l’anarchisme violent, celle du prolétaire sans état d’âme et celle du démolisseur solitaire et isolé. Cette table rase révèle, sans aucun doute, une particularité de Charles Ridel : son attachement évident pour l’inconvenance de la jeunesse et son attirance pour la démolition des idoles. Mais s’arrêter là relèverait du contresens, car si ce Ridel s’exprime – et comment ! – dans les colonnes de Révision, c’est un autre Ridel qui perce sous l’outrance du premier, celui qui insiste – comme le souligne très justement David Berry « sur la sincérité, la clarté, la lucidité, le "parler vrai", le rejet de la langue de bois » , celui qui s’interroge sur la nécessité de repenser le concept de socialisme dans la liberté, celui qui exige des intellectuels qu’ils exercent à fond leurs talents d’analyse et de critique mais sans prétendre diriger une classe ouvrière qui se suffit à elle-même, celui qui conteste le sens de l’Histoire théorisé par les marxistes et ne croit pas à l’avènement fatal du socialisme. Dans Révision, l’autre part de Ridel, celle qui fait de lui un analyste subtil, contrebalance en permanence, mais sans la nier jamais, la première, celle du canonnier anarchiste. Les deux composent un homme qui n’a pas fini de balancer entre l’une et l’autre.
Révision aura une courte vie : cinq mois. C’est que l’histoire s’emballe et que cette année 1938 qui fut « des plus grises », comme l’écrivit Marceau Pivert, laisse prévoir que le trou noir n’est pas loin. Un sixième numéro de la revue paraîtra en août 1939, en français et en espagnol, sous le titre Courrier des camps.Tout un programme ! Les camps, ce sont ceux de la honte où s’entassent ces parias de l’Espagne vaincue, abandonnés de tous. On pouvait y lire :
« L’illusion dans la démocratie, à travers la catastrophique expérience des fronts populaires français et espagnol, a empêché le prolétariat d’écraser la bourgeoisie dans ces deux pays. » Le « prochain massacre » n’allait pas tarder.
II faut avoir lu la Chevauchée anonyme pour comprendre ce que signifia l’exode pour ces sans-patrie, ces exilés de tout pays, ces internationalistes de chaque instant. Tout y est : le sentiment d’étrangeté au monde, la solidarité, la volonté de tenir. « II y a des périodes où l’on ne peut rien sauf ne pas perdre la tête. » En 1939, Ridel choisit d’abord l’insoumission, fait le grand saut, se retrouve en Amérique latine et rentre en France en 1945, après s’être engagé dans les Forces françaises libres et avoir séjourné à Durban, Brazzaville et au Liban. Désormais Charles Ridel n’est plus. Il a laissé la place à Louis Mercier Vega, citoyen chilien.
La France de l’après-guerre, Louis Mercier va la vivre à Grenoble – où il se marie – comme journaliste au Dauphiné libéré. Les temps ont changé, et d’abord pour l’anarchisme quia perdu pied dans un monde où la subversion n’est plus à l’ordre du jour. Marianne Enckell écrit : « Il y a moins de dix ans que les communistes aux ordres de Staline ont écrasé la révolution espagnole. Dans l’immédiat après-guerre, ils occupent en France et ailleurs des postes ministériels, les journaux, le monde syndical et intellectuel. » Pour l’anarchisme, c’est une longue traversée du désert qui commence. L’alternative qu’il choisit, avec d’autres minorités révolutionnaires, c’est « de tenter de maintenir une politique ouvrière autonome », pour reprendre la formule de Charles Jacquier. Elle est sans doute logique, mais plus théorique que pratique. Le « ni l’Est ni l’Ouest » ne tient pas longtemps devant les logiques des blocs. Pour Mercier, en tout cas, il pêche par ingénuité et risque de mettre l’anarchisme définitivement hors course par incapacité à saisir le monde tel qu’il est devenu. C’est le combat contre les visées hégémoniques du stalinisme et sa mainmise sur le mouvement ouvrier qui lui semble prioritaire. Il n’est sans doute pas le seul anarchiste à le penser, mais il en tire quelques conclusions pratiques dont on lui fera longtemps grief.
Abordant cette période charnière de la vie de Mercier, Charles Jacquier [4] n’a pas tort de souligner qu’il est, en 1945, à trente et un ans, un anarchiste « lucide et volontaire » dont le passé de militant communiste libertaire et syndicaliste révolutionnaire parle pour lui, le contraire en tout cas d’un « théoricien verbeux et pontifiant » . De 1946 à 1949, il collabore régulièrement à la Révolution prolétarienne et au Libertaire sous les pseudonymes de Damashki, Santiago Parane et L’Itinérant, mais le ton n’est plus celui de Révision, ou plutôt celui du Ridel première manière. C’est l’autre qui a pris toute la part, c’est l’analyste quia chassé l’imprécateur. Sous la plume d’un Mercier libéré de sa propre histoire, une seule chose compte désormais : saisir le monde tel qu’il est devenu et adapter l’anarchisme aux nouveaux mécanismes de domination. A distance, il n’est sans doute pas facile de comprendre ce que signifia cette époque pour les libertaires, mais l’effort est nécessaire. Charles Jacquier le tente et la dépeint pour ce qu’elle fut : un temps sans espace pour les révolutionnaires authentiques, un temps d’hypocrisies et de mensonge déconcertant, un temps d’« inversion des valeurs » où le « socialisme » s’associait au crime et à la terreur, un temps où les défenseurs des droits de l’homme réservaient, comme l’écrivit le poète surréaliste Georges Heinen, « leurs attendrissements aux bourreaux et leurs silences aux victimes ». « Pour comprendre la participation de Louis Mercier à Preuves et au Congrès pour la liberté de la culture, indique justement Charles Jacquier, il faut la resituer dans le cadre de son itinéraire et de ce que l’on sait de sa personnalité marquée par la double passion de comprendre et d’agir. » Si, d’une certaine façon, le choix de Mercier – celui de la « liberté relative » contre le totalitarisme stalinien – est une forme de « consentement au monde », pour reprendre la formule de Camus, celui-ci ne suppose rien d’autre que la mise en acte d’une conscience lucide née de ce qui, pour lui, était nécessaire en toute circonstance : « l’indispensable confrontation de l’idéal avec le réel » , ce réel incontournable sauf à pratiquer le repli au risque de l’inexistence.
« Rien au monde, écrivit Simone Weil, ne peut nous interdire d’être lucides » en précisant : « Il n’y a aucune difficulté, une fois qu’on a décidé d’agir, à garder intacte, sur le plan de l’action, l’espérance même qu’un examen critique a montré être presque sans fondement ; c’est là l’essence même du courage. » [5] Le problème que se posa, alors, Mercier recoupe sans doute cette thématique. La lucidité impliquait, pour lui, un regard froid sur l’état des forces en présence, un diagnostic clair et un engagement déterminé dans le réel, sans abdiquer l’espérance. C’est ce qu’exprime Charles Jacquier : « Mercier, plus isolé qu’avant 1939, a besoin d’un point d’appui pour agir et travailler à la renaissance d’un mouvement libertaire. Il ne se sert donc pas de sa collaboration à Preuves comme d’un marchepied vers une carrière classique de journaliste que son talent lui permettrait, mais comme d’un outil qui lui assure à la fois le pain quotidien et des moyens d’action accrus au niveau international. » Qu’ultérieurement – en 1966 – le New York Times ait révélé, en faisant référence au Congrès pour la liberté de la culture, l’hypothèse de son financement occulte par la CIA à travers des fondations culturelles, ne change rien à l’option choisie par Mercier en 1953, d’autant qu’il est difficile de s’imaginer qu’en période de guerre froide les belligérants de l’un et l’autre camps n’aient pas eu financièrement partie prenante dans le champ culturel du combat qu’ils se livraient. La seule question qui demeure, c’est celle du choix et de son corollaire, abordé par Mercier lui-même dans la Révolution prolétarienne, en septembre 1965 : « Ce qui compte pour moi, c’est de savoir si l’on a le droit d’utiliser (sous certaines réserves et non sans discrimination) des moyens financiers offerts sans condition pour diffuser des idées que l’on juge saines, sans subir aucune contrainte, sans accepter aucune altération de sa pensée. » Il répondait à ses détracteurs. C’est peu dire qu’il ne les convainquit pas, mêmes ceux qui, comme Robert Louzon, s’étaient depuis belle lurette alignés, eux, sur ce « camp américain » qui n’était pas à proprement parler celui de Mercier.
En parallèle de la contribution de Charles Jacquier, celle de Sylvain Boulouque [6] – qui recoupe grosso modo la même période – aborde la question de son rapport au syndicalisme et de sa pratique de la solidarité ouvrière. S’il est une expression qui compta beaucoup pour Mercier, c’est bien celle de « coutume ouvrière », empruntée à ce grand spécialiste du syndicalisme français des origines que fut Maxime Leroy. Elle symbolisait, à ses yeux, l’esprit du syndicalisme authentique, celui d’avant « la greffe bolchevique sur le mouvement ouvrier », celui de l’autonomie de classe, celui de la charte d’Amiens, celui de la solidarité ouvrière. Partout où il fut, c’est ce syndicalisme-là qu’il pratiqua. Sylvain Boulouque excelle à relever et à situer dans leur contexte les multiples expériences que Mercier tenta pour promouvoir cette coutume ouvrière : son militantisme à la CGT–Force ouvrière dans l’Isère, sa participation au noyau de la Révolution prolétarienne, la constitution du Groupe de liaisons internationales avec Nicolas Lazarévitch et Albert Camus, la création du Trait d’union syndicaliste, la mise sur pied de la Ligue syndicaliste, puis des cercles Pelloutier et Zimmerwald, le lancement de l’Alliance ouvrière et de son organe du même nom, la formation de l’Union des syndicalistes et celle, enfin, de la Commission internationale de liaison ouvrière (CILO), sur laquelle nous reviendrons. Toutes ses structures relevaient, bien sûr, pour beaucoup de cette « fraternité des solitudes » dont parla Mercier à la mort de Lazarévitch, mais elles maintenaient, pour l’essentiel, les principales valeurs de la coutume ouvrière : l’indépendance, la connaissance et la solidarité.
Dimension fondamentale de son parcours de militant, la solidarité, pour Mercier, c’est l’expression même de la coutume ouvrière, son plus bel héritage. Solidarité envers les persécutés des dictatures de l’Ouest et de l’Est, envers les insurgés de Hongrie et les combattants clandestins d’Espagne, mais aussi envers les « déchards », les compagnons dans le besoin ou sans travail. Solidarité encore, exaltée sous forme d’hommage cette fois-ci, quand celui qui l’a pratiquée avec constance reçoit les crachats des révolutionnaires de pacotille – comme Camus après son prix Nobel – ou disparaît sans laisser de trace. Cet hommage, Mercier le pratiquait avec talent et sobriété, fraternellement. Les nécrologies de Nicolas Lazarévitch, de Pierre Monatte, de Jacques Doubinsky et de nombreux sans grade, simples militants d’un quotidien souvent désespérant, sont là pour le prouver. « Cette volonté de rendre hommage aux luttes ouvrières, à travers ses héros et ses représentants, écrit Sylvain Boulouque, est également pour Mercier un moyen d’aider à la connaissance du mouvement anarchiste et ainsi de participer à la formation des militants et à la transmission du flambeau. » Certes, mais c’est aussi l’esprit de famille, cette famille que Mercier s’était choisie dès son plus jeune âge, la seule qu’il reconnaissait comme telle et à laquelle il se voulut toujours fidèle. « II ne me restera qu’une pointe supplémentaire d’amertume et un nouveau goût de tristesse, écrivait-il lors de sa rupture avec la Révolution prolétarienne après les accusations portées contre lui par Louzon, car je croyais n’ [y] avoir que des amis. »
L’amitié compta sans doute beaucoup pour Mercier. L’aventure de la Commission internationale de liaison ouvrière (CILO) – qui fait l’objet d’une étude fouillée de Marianne Enckell [7] – en offre un exemple parfaitement probant, puisqu’elle repose pour beaucoup sur sa relation d’amitié avec Helmut Rüdiger, anarcho-syndicaliste d’origine allemande réfugié en Suède et rédacteur d’Arbetaren, organe de la SAC. Plus d’un point commun, écrit Marianne Enckell, unissait Mercier et Rüdiger : « un intérêt passionné pour l’analyse et la compréhension des phénomènes sociaux, un goût pour le journalisme, un non-conformisme certain ». Ensemble, ils vont tenter de mettre sur pied un réseau international de correspondants dont la tâche principale consistera à alimenter en informations un bulletin imprimé en plusieurs langues (français, anglais, allemand et espagnol). L’idée qui sous-tend le projet est récurrente chez Mercier : n’avoir à dépendre d’aucun filtre médiatique pour saisir le monde et, pour ce faire, chercher l’information à la base à partir de nos propres forces et l’interpréter selon nos seules capacités d’analyse. Au-delà, la correspondance entre Rüdiger et Mercier, sur laquelle a travaillé Marianne Enckell, laisse percer une forte ambition de faire renaître « une culture ouvrière globale »internationaliste et, comme l’écrit Mercier, « de renouer avec la bonne tradition de la liaison entre écrivains sociaux et mouvement ouvrier », ce que, d’une façon, il obtiendra à travers les collaborations d’Albert Camus, d’Ignazio Silone, de Ramón Sender et de Folke Fridell. Entre 1958 et 1965, le Bulletin CILO réalise certains de ses objectifs, mais se heurte à de nombreux obstacles, dont le moindre n’est pas celui des finances. Le 11 juin 1958, Mercier écrit à Rüdiger : « Quant au [numéro] 3, je ne pourrai le sortir qu’en août, au moment où j’aurai touché ma paie. Tu vois que malgré notre réputation d’agent des États-Unis les moyens sont limités ». Et il ajoute : « Si vraiment, au sein des noyaux anarcho-syndicalistes qui demeurent dans le monde, il n’est pas possible de trouver des ressources pour un bulletin bimestriel, alors nous sommes tombés bien bas. » Bien bas, en effet, et d’autant plus bas que la CILO va être la cible privilégiée de certaines micro-bureaucraties anarchistes, dont celle qui contrôle la CNT espagnole en exil. C’est d’ailleurs sur la question de la stratégie syndicale à suivre en Espagne qu’échouera l’expérience de la CILO. Elle provoquera aussi la rupture entre les deux amis. « J’ai l’impression, écrit Mercier à Rüdieer en février 1966, qu’il est impossible de reprendre notre vieux dialogue et notre collaboration, même sous des formes limitées... Dommage. » Helmut Rüdiger, malade du cœur, mourra cinq mois plus tard lors d’un séjour à Madrid.
Les temps sont difficiles pour Mercier. A l’été 1965, il a rompu, pour des motifs déjà évoqués, avec ce noyau de la Révolution prolétarienne, auquel il était très attaché. Quelques mois plus tard, la fin de l’expérience de la CILO le coupe de tous ses liens. Il est isolé, battu froid par d’anciens camarades, voué aux gémonies par d’autres qui, écrit Marianne Enckell, « font mine de ne pas le connaître ». Les temps sont durs, vraiment, mais Mercier est un volontaire congénital. Il souffre, mais supporte. Il voyage beaucoup, et d’abord en Amérique latine, dont il deviendra un grand spécialiste. Ces années vont être celles d’un certain repli sur son travail de rédacteur de la revue latino-américaine Aportes, émanation de l’Institut latino-américain de relations internationales (ILARI). Il y mettra un terme en 1972, de son propre fait, jugeant que la réorganisation que veulent lui imposer ses financiers entame son indépendance. En décembre 1965, dans une lettre à Nicolas Faucier, Mercier s’exprimait ainsi : « Peut-être se présentera-t-il un jour une situation où je me trouverai coincé, avec des groupes nord-américains qui tenteront de me torpiller (...) Dans ce cas, j’espère que j’aurai autant de courage que Victor Alba, qui pour avoir pris position contre le débarquement des marines à Santo Domingo (...) a été liquidé. » Ce jour est donc venu, et le courage avec. A cinquante-cinq ans, il tire le rideau, sans hésitation aucune, et va pointer au chômage. A notre connaissance, ses détracteurs ne commentèrent pas la nouvelle.
La période qui suit, celle qui couvre les années 1970 et s’achève – le 20 novembre 1977 – sur son suicide, sera celle d’Interrogations, revue internationale de recherche anarchiste. Elle est traitée, ici, par Amedeo Bertolo [8] sous la forme d’un émouvant témoignage. Le Mercier de ces années-là, écrit-il, était un « vrai intellectuel anarchiste, riche d’une extraordinaire culture cosmopolite et d’une extraordinaire expérience militante, " sans illusion et sans regret ’ , avec ses certitudes et ses inquiétudes d’anarchiste et d’intellectuel. Son anarchisme était lucide, anti-rhétorique, fascinant ». Ceux qui l’ont connu et fréquenté alors, presque tous bien plus jeunes que lui, se reconnaissent, pour la plupart, dans ce portrait. Il faut croire que Mercier ne laissait pas indifférent. Beaucoup de ceux qui s’agrégèrent à la dernière aventure de sa vie, cette austère revue que les historiens de la période s’accordent pourtant à juger comme la meilleure, l’avaient découvert à travers la lecture de l’Increvable Anarchisme, paru en 1970, remarquable voyage à l’intérieur d’un mouvement à qui l’actualité avait redonné quelques couleurs, mais dont l’histoire était si souvent calomniée, maquillée ou ignorée. Pour Mercier, l’accueil que reçut l’Increvable Anarchisme eut sans doute cet effet bénéfique de réactiver un désir de poursuivre la tâche. II lui permit en tout cas de se sentir moins isolé, occasionna de nouvelles rencontres, fit naître de durables amitiés.
Pourtant, nous dit Marianne Enckell, « lorsque Mercier crée la revue quadrilingue Interrogations, il est usé ». La perte de son travail l’a privé de son principal outil de connaissances ; le décès prématuré de sa compagne a accru sa solitude ; la campagne de discrédit dont il a été victime l’a touché plus profondément qu’il ne le laisse entendre, d’autant qu’elle reprend de plus belle, comme l’indique Amedeo Bertolo, « lorsque Mercier redevient "visible" dans le mouvement anarchiste international ». A-t-il alors programmé son suicide ? Amedeo Bertolo ne semble pas en douter. Marianne Enckell, elle, s’en tient à cette phrase : « II décide que ce sera son dernier round. » Pendant quatre ans – de 1973 à1977 –, il travaille d’arrache-pied : Interrogations, qu’il tient à bout de bras dans sa première étape ; deux ouvrages de référence sur l’Amérique latine – Autopsie de Peron et la Révolution par l’État – ; une brochure sur l’anarcho-syndicalisme ; un grand nombre d’articles ; une correspondance nourrie ; des rencontres internationales.
Activité débordante, donc, chez cet homme qui pense alors que l’anarchisme a mangé son pain noir et qu’on peut lui inventer un avenir à la seule condition de perdre, comme il l’écrivait plus de trente ans auparavant à propos de l’Espagne, cette « exécrable habitude que la plupart des révolutionnaires ont prise – sous l’influence des démocrates larmoyants et réactionnaires – de ne réfléchir sur les faits qu’avec leur sentimentalisme passif » . Cette conviction d’un désert enfin traversé repose, comme toujours chez lui, sur un examen minutieux d’une réalité complexe. Pêle-mêle, il y décèle des signes encourageants : le caractère anti-autoritaire des plus récentes révoltes ouvrières, l’effondrement progressif de la croyance au socialisme d’État, la « systématisation de l’absurde » dans un capitalisme sans autre justification que « sa propre existence ». C’est dans cette dialectique du possible qu’il se situe, sans enthousiasme débordant. Ce qui a changé, c’est la perspective, non la méthode, la sienne du moins. Qu’on en juge : « Interrogations est une revue modeste, mais qui répond à une grande ambition : étudier et analyser les problèmes de la société d’aujourd’hui d’un point de vue libertaire ; aller au-delà, parce que nous n’en sommes plus là, de la réédition des classiques ; chercher et transmettre une information directe, en marge des agences de la propagande et du conformisme ; s’intéresser et interpréter les expériences de caractère anarchiste qui peuvent se dérouler ici ou là ; abandonner le terrain facile des certitudes pour celui des questionnements. » [9] Aucune prise à l’illusion chez lui et toujours la même exigence de lucidité, quelle que soit l’époque, contre toutes les époques, au risque même de réduire quelque peu cette part de rêve nécessaire à tout engagement anarchiste. II est vrai qu’il devait estimer que, de ce côté-là, on pouvait toujours aller voir ailleurs et s’en contenter.
C’est peut-être en cela que Charles Cortvrint, alias Charles Ridel, alias Louis Mercier Vega fut sans doute un anarchiste hors du commun, et d’abord hors du commun de l’anarchisme, ce qui est toujours un handicap, même dans ce milieu-là. Ce livre lui rend l’hommage qu’il méritait et en suscitera d’autres. La preuve.
José Fergo
Revue A Contretemps n° 8, juin 2002
Fernand Gomez, 55 rue des Prairies, 75020 Paris.
NOTES :
[1] Marianne Enckell, « L’amer orgueil de la lucidité désespérée » (pp. 7 à 12).
[2] Phil Casoar, « Avec la colonne Durruti : Ridel dans la révolution espagnole » (pp. 13 à 20) et « Louis Mercier, Simone Weil : retour sur une controverse » (pp. 21 à 36).
[3] David Berry, « Charles Ridel et la revue Révision (1938-1939) » (pp. 37 à 49).
[4] Charles Jacquier, « Louis Mercier, la revue Preuves et le Congrès pour la liberté de la culture » (pp. 71 à 96).
[5] Simone Weil, Oppression et liberté, Gallimard, 1955.
[6] Sylvain Boulouque, « La coutume ouvrière : Louis Mercier et le syndicalisme » (pp. 51 à 70).
[7] Marianne Enckell, « Helmut Rüdiger, R Louis Mercier et la Commission internationale de liaison ouvrière, 1958-1965 »(pp. 97 à 112).
[8] Amedeo Bertolo, « Interrogations, Mercier tel que je l’ai connu » (pp. 113 à 120).
[9] Cette citation est extraite d’un entretien en espagnol accordé par Mercier à Josep Alemany en décembre 1976 et publié à titre posthume dans le numéro 13 d’Interrogations, janvier 1978.
|
|
|
|
|















