|
Le commerce véridique et social de Michel Marie Derrion (1835-1838)
Cahiers Charles Fourier n° 16 - décembre 2005
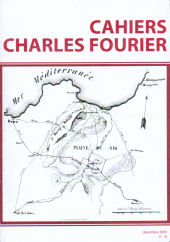
Autour d’un livre de Denis Bayon
La pensée de Fourier est une pensée de la dissidence économique, passionnelle, sociale. En rompant avec le projet de révolution politique, elle engage à l’expérimentation sociale en acte, à un ensemble de propositions pragmatiques et inédites d’association. Fourier fait des plans, des propositions concrètes, des prévisions précises pour la mise en place des phalanges. Les préparatifs matériels sont planifiés, codifiés jusqu’à l’idee d’une phalange d’essai comme une expérimentation en réduit de la phalange idéale. Fourier appelle ces expérimentations des approximations de mécanismes sociétaires » (Le Nouveau Monde industriel et sociétaire, Paris, Anthropos, 1966, p. 380). Il n’est donc pas étonnant qu’il ait pu inspirer au XIXe siècle des pratiques économiques et sociales d’associationnisme nouvelles. Loin de rester pure théorie, le fouriérisme a debouché sur des tentatives réelles d’organisation économique en rupture avec l’ordre civilisé incohérent ». Michel-Marie Derrion est entre 1835 et 1838 l’initiateur de la première coopérative de consommation ou première « vente sociale d’épicerie ». Derrion, ouvert aux idées nouvelles, met en application les principes d’une autre organisation du commerce sur la colline lyonnaise de La Croix-Rousse. Lyon est aussi la ville inspiratrice et source de la pensée de Fourier ainsi que des rejets et dégoûts de l’homme Fourier - il dut travailler comme commerçant dans cette ville. Michelet a écrit que c’est Lyon qui a fait Fourier. Et « Lyon est à cette époque tout a la fois la ville où la misère de la classe ouvrière est la plus effroyable (sous l’Empire le pain y coûtera jusqu’à 10 sous le kilogramme tandis que le salaire journalier ne dépasse guère 15 sous) et où abondent les sociétés plus ou moins secrètes de réformateurs, de théosophes, d’illuministes de toutes sortes. Tout se passe comme si l’exploitation industrielle y sécrétait un brouillard mystique, une fume de rêve où elle se console et se dissimule » (Andre Vergez, Fourier, Paris, PUF, 1969, p. 9). Il ne s’agit pas seulement de se consoler, mais de passer à la pratique et à la mise en œuvre d’une entreprise « d’harmonisation de tous les intérêts », dans une micro-société de « libres égaux ». La cible du combat de Derrion : le commerce, qui fausse les relations avec l’industrie et le consommateur travailleur. Fourier lui aussi fait des commerçants la classe parasite par excellence, cause de la plupart des maux de la société industrielle. Il s’agit selon Derrion de « conquérir pacifiquement le commerce et l’industrie » au profit des travailleurs de tout rang. Il faut faire coopérer ensemble toutes les classes, y compris celle qui possède les capitaux. Le commerce pourrait être, dans le projet Derrion, le levier de la réforme sociale par instauration de nouveaux principes d’organisation de la distribution et de la production.
L’épicerie coopérative que Derrion et Joseph Reynier (saint-simonien et fouriériste) créent a pour vocation de mettre fin a « la concurrence malfaisante et oppressive » au laissez faire que favorise le développement d’une classe commerçante oisive et parasite. Il s’agit de se rendre maître de la distribution pour se détourner des pratiques commerciales que Fourier dénonce comme frauduleuses, sources de surproduction, de spéculation, d’agiotage et même de dégradation de la qualité des marchandises. Derrion lance une souscription pour la fondation d’une vente sociale d’épicerie devant préfigurer la grande reforme sociale. Y répondent favorablement saint-simoniens, fouriéristes et francs-maçons. Le principe de cette épicerie sociale, dont l’enseigne « Au commerce véridique » est déjà une proclamation et un combat, vise à limiter la concurrence malfaisante et génératrice d’effets pervers : baisse des salaires, baisse de la qualité des produits, misère des consommateurs. Fourier est le géniteur imaginatif de cette expression « commerce véridique ».
Le problème est récurrent : la multiplication des échanges, la concurrence « libre et non faussée » seraient l’un des déterminants incontournables de toute organisation économique. Fourier dénonce dans Le Nouveau Monde industriel et sociétaire la croissance exponentielle de cette classe de commerçants improductive et parasite qui favorise la contre-marche des circuits économiques. Gaspillages et surproduction sont les calamités du commerce qui ne peut plus satisfaire les besoins réels. L’aveugle cupidité des marchands pousse, lorsqu’un marche ou un débouché est ouvert, à exporter quatre fois plus de denrées que n’en absorbe la consommation : 100 millions d’étoffes pour vêtir 20 millions d’habitants, dit Fourier. Le commerce en développement est a contresens des besoins et du bien-être des peuples. La banqueroute est un effet certain de cette pléthore de marchandises, . « refoulement pléthorique et contre-coup d’avortement » selon Fourier (Le Nouveau Monde industriel et sociétaire, p. 393).
L’analyse de Fourier est plus subtile encore car il repère deux tendances contradictoires dans cette généralisation et amplification des échanges : accumuler un superflu gigantesque et simultanément dépouiller ces marchés d’un approvisionnement nécessaire. Cela signifie développer les échanges et en même temps priver les marchés des produits de première nécessite. Cette organisation de la production-distribution provoque aussi l’incohérence visible des circuits économiques : l’abandon les productions locales au profit d’une importation de produits de marchés lointains. Ne plus s’approvisionner sur les marches locaux c’est favoriser selon Fourier le parasitisme commercial et le vampirisme du commerce. On aboutit ainsi à ce paradoxe du mécanisme civilisé : générer la pauvreté en civilisation d’abondance. Cette organisation de la concurrence et de l’accroissement du commerce devient contraire à toute rationalité et utilité collective. La liberté anarchique du commerce produit des effets pervers que la science dite « économisme » se refuse à analyser et à prendre en compte. Mystification que ce système, qui élargit le champ des échanges, mais en même temps prive du nécessaire.
L’analyse est encore très juste aujourd’hui, surtout dans les pays convertis à la mondialisation des échanges et qui font l’expérience de ce paradoxe : produire pour le commerce international et ne plus pouvoir assurer la production vivrière, c’est-à-dire les produits de première nécessité. Le Brésil est exportateur de céréales et continue d’abriter une masse de pauvres souffrant de malnutrition. La Thaïlande exporte du manioc et souffre aussi de ce mal endémique : la carence alimentaire. La culture commerciale se développe contre la culture vivrière, d’où le paradoxe que seuls les pays riches profitent de cette production. La mondialisation des échanges n’a rien de rationnel puisqu’elle favorise une concurrence excessive dérégulatrice des économies, source de pauvreté pour une partie des populations. Fourier aurait encore aujourd’hui confirmation de ses thèses sur le parasitisme du commerce mondial. Il pourrait faire ce constat amer que ce qu’il déplorait au début du XIXe siècle n’a cessé de s’aggraver : le développement exponentiel du commerce et la persistance de la pauvreté. On exporte ce qui est produit en monoculture et on importe ce qui est nécessaire. Au Ghana, le cacao occupe 56 % des terres cultivées, au Senegal, l’arachide en occupe 52 % (voir le chapitre « Leur faim, notre assiette » du livre d’Andre Gorz : Les Chemins du paradis et l’agonie du capital, Paris, Galilée, 1983). Dans une optique fouriériste l’aberration du commerce mondial est encore avèrée, avec la dégradation de la qualité des produits et l’accroissement de la longueur des circuits économiques. Dans les pays industriels, la nourriture a parcouru des milliers de kilomètres avant d’arriver dans nos assiettes. Fourier serait scandalisé de l’état de la planète et de l’épuisement de ses ressources, lui qui déplorait déjà les destructions « écologiques » de son époque. Ni Derrion ni Fourier ne mettent pourtant fin a la concurrence, mais ils se gardent bien de la favoriser partout comme ici. La concurrence bienfaisante est pour Derrion un facteur d’émulation, de perfectionnement industriel, mais elle peut être annulée par l’excès de concurrence malfaisante qui induit fraude et baisse de qualité. La concurrence commerciale comme seul et unique principe d’organisation sociale apparaît contre-performante.
Revenons a cette expérience d’une épicerie coopérative à Lyon. Elle affiche comme vocation de contrôler démocratiquement les opérations de commerce, d’assurer l’approvisionnement des produits de qualité aux ouvriers et constituer un fond social dont l’utilisation est débattue démocratiquement. Sept magasins sont ouverts : épicerie, charcuterie, boulangerie... Ces entreprises sont bénéficiaires (bénéfices redistribués pour la solidarité : retraite, chômage et éducation), mais elles ne durent que trois années, mises à mal par la crise économique qui sévit entre 1836 et 1837 : « vie et mort du commerce véridique ». En 1848, « La Société des travailleurs uni » qui comprend des saint-simoniens, des icariens, des fouriéristes, tente une nouvelle fois de mettre en harmonie la production et la consommation au moyen d’un système d’échange de marchandises contrôlé. Sur le plateau de La Croix-Rousse voient le jour une boulangerie, une charcuterie, six épiceries. En 1851, le coup d’Etat met fin a ces expériences économiques et politiques. Les militants sont dispersés et emprisonnés. Aujourd’hui des embryons d’épicerie coopérative voient le jour qui tissent un lien direct entre producteurs et consommateurs. Le but est de court-circuiter l’intermédiaire ou le commerçant, mais surtout de privilégier une nourriture de qualité essentiellement « biologique ». Elles n’ont pas conservé cette volonté de constituer des fonds sociaux comme dans l’expérience de Lyon, mais elles prennent en compte cette nécessite de relocaliser l’agriculture, anticipant la fin du pétrole a bon marché.
L’expérience de Michel-Marie Derrion est presentée par Denis Bayon qui donne en annexe des textes de Derrion parus dans L’Indicateur (20 déc. 1834-25 janv. 1835). Lyon, ville d’expérimentations et d’alternatives, n’a pas fini de faire parler d’elle : signalons aussi le livre de Mimmo Pucciarelli, chez le même éditeur : Les expériences collectives de La Croix Rousse, 1975-1995, Lyon, 1996. La tradition lyonnaise perdure !
Chantal Guillaume
|













