Le marronnier et la marmite

 Promotion estivale sur France Culture. L’émission Les lundis de l’histoire du 13 juillet 2009, dans sa troisième partie, permet à l’historien étasunien John Merriman de présenter son dernier titre : The dynamite club. How a bombing in fin-de-siècle Paris ignited the age of modern terror, « dont la traduction française paraîtra en septembre 2009 chez Tallandier » dixit le site internet de la dite radio de service public. Promotion estivale à Libération. 9 juillet 2009. L’article de Dominique Kalifa, auteur d’un récent et excellent Biribi sur les bagnes militaires français, nous fait découvrir le nouveau livre de l’universitaire nord américain John Merriman : Dynamite Club. L’invention du terrorisme moderne à Paris. L’étude historique de 256 pages de ce spécialiste du XIXe siècle français a été traduite de l’anglais plus vite que prévu semble-t’il par Emmanuel Lyasse. Promotion estivale un jour plus tard dans les colonnes du Monde des Livres. L’article de Jean Birnbaum fait l’éloge du travail de chercheur américain John Merriman et du volume qui en découle : Dynamite Club. L’invention du terrorisme moderne à Paris. Le lecteur pourra se l’offrir pour la modique somme de 20 €.
Promotion estivale sur France Culture. L’émission Les lundis de l’histoire du 13 juillet 2009, dans sa troisième partie, permet à l’historien étasunien John Merriman de présenter son dernier titre : The dynamite club. How a bombing in fin-de-siècle Paris ignited the age of modern terror, « dont la traduction française paraîtra en septembre 2009 chez Tallandier » dixit le site internet de la dite radio de service public. Promotion estivale à Libération. 9 juillet 2009. L’article de Dominique Kalifa, auteur d’un récent et excellent Biribi sur les bagnes militaires français, nous fait découvrir le nouveau livre de l’universitaire nord américain John Merriman : Dynamite Club. L’invention du terrorisme moderne à Paris. L’étude historique de 256 pages de ce spécialiste du XIXe siècle français a été traduite de l’anglais plus vite que prévu semble-t’il par Emmanuel Lyasse. Promotion estivale un jour plus tard dans les colonnes du Monde des Livres. L’article de Jean Birnbaum fait l’éloge du travail de chercheur américain John Merriman et du volume qui en découle : Dynamite Club. L’invention du terrorisme moderne à Paris. Le lecteur pourra se l’offrir pour la modique somme de 20 €.
 Décidément l’anarchie est à la mode avec son lot d’histoires violentes et saignantes à souhait. Des histoires à faire froid dans le dos du lecteur allongé sur la serviette chauffée par le sable brûlant des plages de la Méditerranée, de l’Atlantique ou d’ailleurs selon l’épaisseur du portefeuille. L’année dernière déjà, le très libéral Figaro s’attardait pour ses lecteurs juilletistes sur l’ennemi public numéro 1 en 1912 : le petit Jules Bonnot. Cet excès de zèle figaresque nous livrait, entre deux séances de bronzage un morceau de choix, un bloc de premier ordre. Un bloc que dis-je ? Non, c’est un peu court, jeunes gens et vieilles personnes ! Un météore d’anthologie de la connerie réactionnaire d’expression française considérée dans le domaine historique. Le grand du crime ne pouvait être que petit … comme la pensée politique que l’infâme papier ne daignait même pas lui accorder.
Décidément l’anarchie est à la mode avec son lot d’histoires violentes et saignantes à souhait. Des histoires à faire froid dans le dos du lecteur allongé sur la serviette chauffée par le sable brûlant des plages de la Méditerranée, de l’Atlantique ou d’ailleurs selon l’épaisseur du portefeuille. L’année dernière déjà, le très libéral Figaro s’attardait pour ses lecteurs juilletistes sur l’ennemi public numéro 1 en 1912 : le petit Jules Bonnot. Cet excès de zèle figaresque nous livrait, entre deux séances de bronzage un morceau de choix, un bloc de premier ordre. Un bloc que dis-je ? Non, c’est un peu court, jeunes gens et vieilles personnes ! Un météore d’anthologie de la connerie réactionnaire d’expression française considérée dans le domaine historique. Le grand du crime ne pouvait être que petit … comme la pensée politique que l’infâme papier ne daignait même pas lui accorder.
L’actualité booste les ventes. Les trains déraillent depuis Tarnac ; les manifestations anti-OTAN se heurtent à la violence policière à Strasbourg. Les cagoules, bien malgré eux, tendent désormais à faire de l’histoire du mouvement libertaire et de la geste de certaines de ses figures quasi mythiques un marronnier éditorial.
 Là où le bas peuple, par définition moutonnier et acéphale parce que bas, se décervelle paradoxalement l’esprit, avant l’apéro, avec le tour de France, après l’apéro avec Secret Story, le péquin moyen (ou plus) a lui aussi droit à sa ration quotidienne de lobotomie intellectuelle, donc consumériste. Cette année encore la recette fonctionne. Du poulet sauté façon Mimile. Cuit dans sa marmite renversée et dans son jus. Et mythonné à la mode de la rue des Bons Enfants. L’ouvrage de John Merriman se focalise sur la vie d’Emile Henry. Il ouvrirait, par l’ampleur du travail de recherche effectué, de nouvelles perspectives. Des perspectives qui éclairent notre époque. Des perspectives qui illuminent notre compréhension. Oyez ! Oyez ! Braves gens !
Là où le bas peuple, par définition moutonnier et acéphale parce que bas, se décervelle paradoxalement l’esprit, avant l’apéro, avec le tour de France, après l’apéro avec Secret Story, le péquin moyen (ou plus) a lui aussi droit à sa ration quotidienne de lobotomie intellectuelle, donc consumériste. Cette année encore la recette fonctionne. Du poulet sauté façon Mimile. Cuit dans sa marmite renversée et dans son jus. Et mythonné à la mode de la rue des Bons Enfants. L’ouvrage de John Merriman se focalise sur la vie d’Emile Henry. Il ouvrirait, par l’ampleur du travail de recherche effectué, de nouvelles perspectives. Des perspectives qui éclairent notre époque. Des perspectives qui illuminent notre compréhension. Oyez ! Oyez ! Braves gens !
Rassurons de suite le lecteur et acheteur potentiel de l’ouvrage ci-dessus mentionné et des autres à l’occasion. Le méchant, à la fin, est toujours puni. La tête à Mimile a heureusement fini par rouler dans le son du panier à Deibler et, aujourd’hui, l’ordre règne d’ailleurs à Bagdad, à Kandahar, à Peshawar, à Téhéran, au Tibet, dans le Xinjiang même s’il y a peu de chance pour que l’on n’y entende le bruissement des plis d’un quelconque du drapeau noir.
 Depuis les actes de propagande par le fait, le folklore du poseur de bombes colle à l’anarchiste comme montre Rollex au poignet présidentiel. L’anarchiste fait peur. L’anarchiste soulève encore bien des inquiétudes. L’anarchiste fait couler – faute de sang – beaucoup d’encre. L’image du libertaire induit fréquemment la question de la violence en politique. Elle suggère celle de l’action militante hors d’un cadre traditionnel et institué. Mais le politiologue, le spécialiste supposé, l’expert scribouillard attitré ne peuvent s’empêcher de faire un très insupportable et très improbable parallèle rattachant le présent qui fait peur, et dont tout le monde parle, donc consomme, aux évènements passés. Même si elle bredouille de temps en temps, l’histoire ne se répète pourtant pas. Le fait n’est pas nouveau. De la ficelle en veux-tu ? Du bon gros cordage tu auras ! Exemples.
Depuis les actes de propagande par le fait, le folklore du poseur de bombes colle à l’anarchiste comme montre Rollex au poignet présidentiel. L’anarchiste fait peur. L’anarchiste soulève encore bien des inquiétudes. L’anarchiste fait couler – faute de sang – beaucoup d’encre. L’image du libertaire induit fréquemment la question de la violence en politique. Elle suggère celle de l’action militante hors d’un cadre traditionnel et institué. Mais le politiologue, le spécialiste supposé, l’expert scribouillard attitré ne peuvent s’empêcher de faire un très insupportable et très improbable parallèle rattachant le présent qui fait peur, et dont tout le monde parle, donc consomme, aux évènements passés. Même si elle bredouille de temps en temps, l’histoire ne se répète pourtant pas. Le fait n’est pas nouveau. De la ficelle en veux-tu ? Du bon gros cordage tu auras ! Exemples.
Le 3 juillet 1987, Jean-Noël Jeanneney établit dans les colonnes du Monde un parallèle discutable entre les militants du groupe d’extrême gauche Action Directe, « les terroristes venus du Proche Orient » et le mouvement anarchiste de la fin du XIXe siècle : « Cibles symboliques, violences aveugles, psychose collective … la logique est la même »[1]. L’auteur de l’article reconnaît toutefois l’existence d’un phantasme sécuritaire légitimant, selon lui, les lois dites « scélérates » de 1893-1894. Le parallèle devient nettement ambigu lorsqu’il s’agit de pointer le doigt sur les coupables des atteintes portées par ricochets à la vie démocratique et à notre vieux monde capitaliste et post-industriel.
 Le même principe dialectique prévaut quelques années plus tard dans le Monde Diplomatique où l’on retrouve encore cet amalgame facile, issu du rapport violence politique – répression. Le numéro de septembre 2004 de ce journal évoque en effet « le temps du terrorisme anarchiste » pour rendre compte de celui, plus contemporain, des islamistes wahhâbites. Dans les deux cas, le « terreau » du malaise social est exploité par « une minorité de fanatiques ». L’auteur, Rick Coolsaet, prédit en conclusion la fin du terrorisme djihadiste à l’image de celle de la propagande par le fait[2]. Il est vrai que le temps où la marmite servait de titre de rubrique aux grandes feuilles bourgeoises de l’époque fut relativement court. Il est encore plus vrai le fanatisme religieux et le terrorisme enturbanné des sectateurs d’Allah n’a pas encore disparu.
Le même principe dialectique prévaut quelques années plus tard dans le Monde Diplomatique où l’on retrouve encore cet amalgame facile, issu du rapport violence politique – répression. Le numéro de septembre 2004 de ce journal évoque en effet « le temps du terrorisme anarchiste » pour rendre compte de celui, plus contemporain, des islamistes wahhâbites. Dans les deux cas, le « terreau » du malaise social est exploité par « une minorité de fanatiques ». L’auteur, Rick Coolsaet, prédit en conclusion la fin du terrorisme djihadiste à l’image de celle de la propagande par le fait[2]. Il est vrai que le temps où la marmite servait de titre de rubrique aux grandes feuilles bourgeoises de l’époque fut relativement court. Il est encore plus vrai le fanatisme religieux et le terrorisme enturbanné des sectateurs d’Allah n’a pas encore disparu.
Il est enfin vrai que les deux papiers que nous venons d’évoquer révèlent surtout une profonde et dédaigneuse méconnaissance du mouvement anarchiste en général, des actions militantes des libertaires en particulier. Mais le mot anarchie s’associe dans la mémoire collective à la notion de désordre. L’exploitation politique, médiatique et historique des bombes de Ravachol, de Vaillant, d’Henry, de Pauwels, etc. permet d’occulter l’étymologie du terme : an archos.
 L’anarchie organise une société sans pouvoir. Elle ne peut se limiter au seul désordre issu d’une quelconque question sociale, d’un quelconque discours révolutionnaire. Elisée Reclus n’écrivait-il pas d’ailleurs : « L’anarchie est la plus haute expression de l’ordre »[3] ? Pierre Joseph Proudhon affirmait également : «La plus haute perfection de la société se trouve dans l’union de l’ordre et de l’anarchie »[4]. En retenant ces aphorismes, nous pouvons nier de fait l’interprétation, dans la presse, qu’elle soit grand public ou non, faisant de cet idéal politique une simple, mais violente et épidermique, réaction à l’exploitation de l’homme par l’homme. Mais dans ce cadre, d’aucun pourrait être tenté d’entrevoir l’anarchisme comme l’une des nombreuses utopies qui fleurissent avec la Révolution Industrielle. Rien n’est moins faux.
L’anarchie organise une société sans pouvoir. Elle ne peut se limiter au seul désordre issu d’une quelconque question sociale, d’un quelconque discours révolutionnaire. Elisée Reclus n’écrivait-il pas d’ailleurs : « L’anarchie est la plus haute expression de l’ordre »[3] ? Pierre Joseph Proudhon affirmait également : «La plus haute perfection de la société se trouve dans l’union de l’ordre et de l’anarchie »[4]. En retenant ces aphorismes, nous pouvons nier de fait l’interprétation, dans la presse, qu’elle soit grand public ou non, faisant de cet idéal politique une simple, mais violente et épidermique, réaction à l’exploitation de l’homme par l’homme. Mais dans ce cadre, d’aucun pourrait être tenté d’entrevoir l’anarchisme comme l’une des nombreuses utopies qui fleurissent avec la Révolution Industrielle. Rien n’est moins faux.
Cette ignorance conduit finalement à restreindre l’acte de propagande par la marmite, le revolver ou la pince monseigneur à un fait divers un peu moins simple que le moyenne. D’où l’incompréhension journalistique lorsque le terroriste ne correspond pas au profil lombrosien du criminel. Peut-être parce que l’acte criminel et illégal, c’est-à-dire hors du cadre instituée par la société elle-même attaquée, se situe d’abord et avant tout dans le champ politique.
 Viennent alors tous les poncifs sur l’individu incriminé et auteur du monstrueux attentat : marginal, refoulé, exclu, aigri, violent. Ajoutons simple d’esprit et par extension victime lui-même de la sphère des théoriciens institués de l’hydre anarchiste. Ceux-là sont des vrais penseurs aux mains propres. Clairs, Sans tâche de sang sur leur chemise. Mais ils dictent par leurs écrits l’épidémie de bombes qui a ensanglanté la France et l’Europe en 1892-1894 ; ils provoquent les actes qui ont semé la mort et la désolation.
Viennent alors tous les poncifs sur l’individu incriminé et auteur du monstrueux attentat : marginal, refoulé, exclu, aigri, violent. Ajoutons simple d’esprit et par extension victime lui-même de la sphère des théoriciens institués de l’hydre anarchiste. Ceux-là sont des vrais penseurs aux mains propres. Clairs, Sans tâche de sang sur leur chemise. Mais ils dictent par leurs écrits l’épidémie de bombes qui a ensanglanté la France et l’Europe en 1892-1894 ; ils provoquent les actes qui ont semé la mort et la désolation.
Le complot anarchiste, tel que le réinvente Vivien Bouhey dans sa thèse parue aux Presses Universitaires de Rennes en 2009, en réactualisant la notion de réseau, prend dans le titre du livre de John Merriman l’image d’un club, celui de la dynamite. D’où la fatale corrélation, avec, aujourd’hui, des groupes comme Al-Qaida, ETA, le Hamas, le FLNC, le mouvement Tupac Amaru, etc. Et cette confrontation entre le passé et le présent doit fatalement raisonner. D’abord dans la tête du lecteur de l’article, de l’auditeur de l’émission ; elle doit ensuite interpeller l’acheteur, qu’il est censé normalement devenir, de l’ouvrage en question.
 L’iconographie devient ensuite primordiale pour accrocher. L’article de Jean Birnbaum dans Le monde des Livres débute en une et en surimpression d’un dessin signé Rita Mercedes. L’image présente Emile Henry surdimensionné et au milieu des décombres que sa bombe a provoqué au café Terminus le 12 février 1894. Le nom du bar, proche de la gare Saint Lazare, apparaît dans l’image. Le frère de Fortuné Henry tient un bâton de dynamite dans sa main droite levé bien haut. La main gauche, baissée, agrippe un haut-de-forme. Nous doutons que le personnage ainsi croqué puisse faire penser au Gavroche de Delacroix dans La Liberté guidant le peuple. Il est plus probable d’envisager une allusion au King Kong né en 1933 de l’imagination cinématographique de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack. Mieux encore. Il faut coller à l’actualité récente. La scène, bien que parisienne, peut facilement se transposer à New York le 11 septembre 2001, et le terroriste du XIXe siècle se retrouver au centre de décombres, bien réelles parce que proches de nous dans le temps, des deux tours jumelles.
L’iconographie devient ensuite primordiale pour accrocher. L’article de Jean Birnbaum dans Le monde des Livres débute en une et en surimpression d’un dessin signé Rita Mercedes. L’image présente Emile Henry surdimensionné et au milieu des décombres que sa bombe a provoqué au café Terminus le 12 février 1894. Le nom du bar, proche de la gare Saint Lazare, apparaît dans l’image. Le frère de Fortuné Henry tient un bâton de dynamite dans sa main droite levé bien haut. La main gauche, baissée, agrippe un haut-de-forme. Nous doutons que le personnage ainsi croqué puisse faire penser au Gavroche de Delacroix dans La Liberté guidant le peuple. Il est plus probable d’envisager une allusion au King Kong né en 1933 de l’imagination cinématographique de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack. Mieux encore. Il faut coller à l’actualité récente. La scène, bien que parisienne, peut facilement se transposer à New York le 11 septembre 2001, et le terroriste du XIXe siècle se retrouver au centre de décombres, bien réelles parce que proches de nous dans le temps, des deux tours jumelles.
![]() Jean Birnbaum, auteur de l’article, a alors la paraphrase facile pour rendre compte de l’ouvrage de Merriman. Avec le Dynamite Club, la propagande par le fait du Saint Just de l’anarchie revêt le caractère d’un terrorisme à visage humain. La prose du chroniqueur littéraire, même si elle regrette un ouvrage « Desservi par de trop nombreuses coquilles », encense néanmoins un livre « au style enlevé » et « qui se lit comme un roman ». Patatras ! Tout est dit. Et même plus encore : « un roman noir aux mille résonances particulières ». Nous voilà prévenus. Il fallait bien une ambiance, une atmosphère, un climat, sombre, lourd, brumeux et pesant pour traiter de « l’acte tristement inaugural » de « l’attentat moderne en occident ». Si Dominique Kalifa, dans Libération, ne met pas en avant la volonté de gloire personnelle pour expliquer la propagande par le fait d’Emile Henry nous retrouvons pourtant le même son de cloche … le même son de marmite. La geste de ce petit bourgeois déboussolé « portait en lui un terrorisme d’un genre nouveau, dont les activistes du XXe siècle devaient se souvenir ». Les deux articles, pour finir de dresser le terrible et néanmoins édifiant portrait du monstre, tentent alors de cerner la personnalité de cet « aristocrate du crime », de ce « pâle jeune homme » dont les actes furent accomplis « sans le moindre état d’âme ».
Jean Birnbaum, auteur de l’article, a alors la paraphrase facile pour rendre compte de l’ouvrage de Merriman. Avec le Dynamite Club, la propagande par le fait du Saint Just de l’anarchie revêt le caractère d’un terrorisme à visage humain. La prose du chroniqueur littéraire, même si elle regrette un ouvrage « Desservi par de trop nombreuses coquilles », encense néanmoins un livre « au style enlevé » et « qui se lit comme un roman ». Patatras ! Tout est dit. Et même plus encore : « un roman noir aux mille résonances particulières ». Nous voilà prévenus. Il fallait bien une ambiance, une atmosphère, un climat, sombre, lourd, brumeux et pesant pour traiter de « l’acte tristement inaugural » de « l’attentat moderne en occident ». Si Dominique Kalifa, dans Libération, ne met pas en avant la volonté de gloire personnelle pour expliquer la propagande par le fait d’Emile Henry nous retrouvons pourtant le même son de cloche … le même son de marmite. La geste de ce petit bourgeois déboussolé « portait en lui un terrorisme d’un genre nouveau, dont les activistes du XXe siècle devaient se souvenir ». Les deux articles, pour finir de dresser le terrible et néanmoins édifiant portrait du monstre, tentent alors de cerner la personnalité de cet « aristocrate du crime », de ce « pâle jeune homme » dont les actes furent accomplis « sans le moindre état d’âme ».
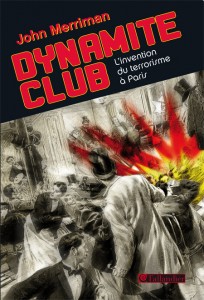
 Un choix s’impose à nous : soit nous filons sur les plages de la Méditerranée, de l’Atlantique mais pas d’ailleurs parce que la largeur de notre portefeuille nous l’interdit et nous lisons, après l’avoir honnêtement acheté l’ouvrage de John Merriman ; soit nous gardons en référence l’ouvrage essentiel commis par Walter Badier et publié en décembre 2007 aux éditions Libertaires sous le titre Emile Henry, de la propagande par le fait au terrorisme anarchiste. Là, on y verra plus clair. Nous venons tout juste de poser les deux livres sur notre serviette de plage.
Un choix s’impose à nous : soit nous filons sur les plages de la Méditerranée, de l’Atlantique mais pas d’ailleurs parce que la largeur de notre portefeuille nous l’interdit et nous lisons, après l’avoir honnêtement acheté l’ouvrage de John Merriman ; soit nous gardons en référence l’ouvrage essentiel commis par Walter Badier et publié en décembre 2007 aux éditions Libertaires sous le titre Emile Henry, de la propagande par le fait au terrorisme anarchiste. Là, on y verra plus clair. Nous venons tout juste de poser les deux livres sur notre serviette de plage.
Steve Golden
Le cahier livres de Libé
Livres 09/07/2009 à 06h53
Emile Henry, bombes à tout faire
Critique
Anarchie : John Merriman reconstitue le destin d’un jeune bourgeois des années 1890 devenu terroriste.
Par DOMINIQUE KALIFA
John Merriman, Dynamite Club. L’invention du terrorisme à Paris Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Emmanuelle Lyasse, Tallandier, 255 pp., 20 euros.
Le 12 février 1894, en début de soirée, le jeune Emile Henry, 22 ans, entre dans la grande salle du café Terminus à Paris, au coin de la gare Saint-Lazare, et lance la bombe artisanale qu’il vient de fabriquer dans sa mansarde de Belleville. Le souffle de l’explosion est terrible. Il éventre les tables, projette les chaises, les lustres, les verres, et provoque une indescriptible panique. Vingt consommateurs sont grièvement blessés, et l’un d’eux décède peu après. Cet événement est bien connu, tout comme la vague d’attentats anarchistes dans laquelle il s’inscrit et qui déferle sur l’Europe et les Etats-Unis à la fin du XIXe siècle. Le livre de John Merriman revient bien sûr sur tous ces aspects, ainsi que sur la psychose de la dynamite qui caractérise ce moment, mais son intérêt est surtout ailleurs. En s’attachant à suivre pas à pas le destin d’Emile Henry, à reconstituer le moindre de ses gestes, il a voulu «pénétrer dans l’esprit d’un terroriste», dont l’acte inaugure selon lui les formes du terrorisme contemporain.
Polytechnique. Emile Henry n’est en effet pas un poseur de bombes comme les autres. Ni un bandit comme Ravachol, ni un pauvre hère poussé par la misère comme Auguste Vaillant, ni un illuminé de l’anarchisme comme Caserio, l’assassin du président Sadi Carnot. Henry vient d’un milieu plutôt bourgeois, il a fait d’excellentes études qui l’ont mené jusqu’à l’oral de l’Ecole Polytechnique (on l’y interroge sur les «propriétés détonantes» du chlore !) et ses divers employeurs le décrivent comme un sujet très doué. Il existe bien sûr une tradition révolutionnaire dans la famille : son père, ancien communard condamné à mort par contumace, s’est exilé en Espagne, où il a rejoint les libertaires catalans, et son frère Fortuné devient lui aussi anarchiste. On souligna d’ailleurs qu’Emile, né en 1872, avait été conçu durant la Commune. Mais son engagement procède d’une prise de conscience personnelle : il est scandalisé par le luxe des beaux quartiers, quand la misère gangrène toujours le Paris populaire, indigné par la corruption des élites, révolté par la brutale répression qui, à Fourmies ou à Carmaux, s’abat sur les revendications ouvrières. C’est donc sans le moindre état d’âme qu’il devient adepte de la «propagande par le fait» et de la dynamite. «Une haine profonde» le tenaille, «chaque jour avivée par le spectacle révoltant de cette société». En novembre 1892, il pose sa première bombe, devant le siège parisien des mines de Carmaux, avenue de l’Opéra. L’engin est remarqué par un employé, porté au commissariat voisin, où il explose en tuant cinq policiers.
A Paris, à Bruxelles et surtout Londres, où il fréquente le milieu des anarchistes en exil, sa détermination ne fait que croître. Il s’emporte contre les théoriciens de l’Idée qui, comme Malatesta, prennent leur distance avec l’action violente et invitent à ne pas dépasser «la limite marquée par la nécessité». Au contraire, estime Henry, il faut frapper partout et sans limite, car la bourgeoisie est partout et collectivement coupable. Elle «doit toute entière expier ses crimes».
Echafaud. A l’encontre d’une tradition terroriste qui visait jusque-là les rois, les présidents ou les agents de l’Etat, Henry inaugure l’attentat en aveugle qui prend pour cible les citoyens ordinaires. «Je ne frapperai pas un innocent en attaquant le premier bourgeois qui passe.» La plupart des théoriciens anarchistes déplorèrent l’explosion du café Terminus, qui atteignit des innocents. «Sa bombe a surtout frappé l’Anarchie», écrit son ancien ami Charles Malato. Arrêté, Henry fut guillotiné quelques semaines plus tard – il monta sur l’échafaud, sûr d’accéder à «l’immortalité révolutionnaire» – et une lourde répression s’abattit en effet sur le mouvement anarchiste. Mais son geste portait en lui un terrorisme d’un genre nouveau, dont les activistes du XXe siècle devaient se souvenir.
Vendredi 10 juillet 2009
Le terrorisme à visage humain
Le terroriste a rarement le visage qu’on voudrait lui coller. Pour se rassurer, notre société le décrit sous les traits d’un être aigri, tordu par le ressentiment. Fatalement, quand éclate la vérité, chacun feint la surprise. Quoi, cette femme qui actionne sa ceinture d’explosifs dans une boîte de nuit, est-elle vraiment la brillante étudiante que pleurent ses parents ? Et cet homme qui planifie la mort à l’autre bout du monde, se peut-il qu’il mène une fulgurante carrière de mathématicien ? On veut les présenter comme des déshérités, ce sont des petits-bourgeois. On jure que la frustration les a mis en mouvement, ils se révèlent habités par un enthousiasme ravageur.
Il faut s’y résoudre : la pulsion première du terroriste est moins la rancoeur qu’une certaine espérance. S’il en vient à semer l’effroi parmi ses contemporains, c’est qu’il ne peut pardonner leur lâcheté quotidienne, toutes ces petites démissions qui retardent, à ses yeux, l’avènement de la justice sur terre : « J’aime tous les hommes dans leur humanité et pour ce qu’ils devraient être, mais je les méprise pour ce qu’ils sont », résumait en mai 1894 l’anarchiste Emile Henry. Il avait 21 ans et se préparait pour la guillotine. Retracer l’itinéraire de cet intellectuel révolté, comme le fait l’historien américain John Merriman d’une plume quasi romanesque, ce n’est pas seulement retrouver le décor de la Belle Epoque. C’est reconstituer la scène où fut inventé l’attentat moderne en Occident.
Il y a de cela vingt ans, John Merriman avait consacré une superbe étude à Limoges, la ville rouge (Belin, 1990). Avec la rigueur et la générosité qui distinguent l’histoire sociale venue des Etats-Unis, incarnée également par son ami Charles Tilly (1929-2008), Merriman y redonnait vie à la Limoges du XIXe siècle, à ses rues, ses faubourgs, pour observer les élans politiques des « artistes en porcelaine ». Passion tenace, vieille fidélité : bien que traitant un tout autre sujet, Dynamite Club, son nouveau livre, commence aussi par donner la parole à un ouvrier porcelainier, en citant son ultime lettre. Tuberculeux, désespéré, cloué sur son lit d’hôpital, l’homme écrivait ceci : « Bourgeois inconscients et cruels, ne sentez-vous pas que je puis me faire justicier ? (…) Bourgeois, je ne mourrai pas seul ; je veux entraîner dans la mort quelques-uns de ceux qui sont responsables de ma mort. »
Au coeur de ce récit-là, pourtant, Merriman a placé non un prolétaire mais un fils de bonne famille : né d’un père socialiste, qui publia jadis des chansons pour enfants, et qui dut s’exiler au lendemain de la Commune, Emile Henry a fait de prestigieuses études. Elève modèle, récompensé par plusieurs prix d’excellence, bachelier à 16 ans, il est certes collé à l’oral de Polytechnique, en 1889, mais reste néanmoins promis à un avenir radieux. Or cinq années plus tard, il se verra condamné à mort pour avoir perpétré plusieurs attentats sanglants. Toute l’enquête de John Merriman tente donc de répondre à la question : que s’est-il passé ? Comment expliquer, en particulier, l’acte tristement inaugural accompli par Emile Henry le 12 février 1894, à Paris ?
Ce jour-là, le pâle jeune homme fabrique une bombe en plaçant de la dynamite dans une boîte à casse-croûte. Vêtu d’un pantalon sombre, d’une cravate et d’un feutre, il emprunte successivement quatre voitures pour sillonner les boulevards huppés du quartier de l’Opéra : « Comme un vrai bourgeois, je ne marchais pas à pied », témoignera-t-il plus tard. Il cherche le café le plus chic, le plus bondé aussi. Vers 20 heures, il finit par s’attabler au Terminus, à l’angle de la gare Saint-Lazare, où s’égaille une foule dense, pressée d’entendre le concert du soir. Emile, lui, commande une bière et un cigare. Non sans avoir pris soin de régler ses consommations, il décide que le moment est venu. Son acte marque une étape dans l’histoire des violences politiques : pour la première fois en Europe, au lieu de viser tel ou tel représentant de l’Etat, un militant anarchiste aura choisi de frapper des anonymes, de tuer au hasard.
Donc, que s’est-il passé ? La réponse n’est guère évidente, et Merriman se garde bien de trancher. La force de son livre se confond avec un aveu de faiblesse : habitué à privilégier la question sociale, en effet, l’historien a conscience que ce type d’approche bute fatalement sur des itinéraires comme celui d’Emile Henry. Dès lors, il choisit une méthode d’investigation à la fois savante et littéraire, croisant les sources afin de multiplier les points de vue. Il suit Emile Henry dans les rues de Paris, ulcéré par les scandales de la IIIe République, bouleversé par le sort qu’elle réserve aux ouvriers, par la répression qui s’abat sur les militants. Il le surprend en plein débat, dans telle ou telle gargote bellevilloise, criant : « Mort aux flics ! Mort aux bourriques ! », et constatant que « seuls les cyniques et les rampants peuvent se faire une bonne place au banquet ». Bref, il l’accompagne sur le chemin de la radicalisation, qui conduit bientôt Henry à choisir la « propagande par le fait », et même cette violence aveugle que condamnent par ailleurs beaucoup de ses camarades anarchistes.
UN ARISTOCRATE DU CRIME
Bien sûr, la police est convaincue qu’elle affronte un complot international, ourdi depuis Londres par un véritable « dynamite club ». Mais Henry agit en solitaire. Sous le regard de Merriman, il apparaît comme un aristocrate du crime. Ni marginal ni déclassé, c’est d’abord un homme déchiré : un intellectuel qui hait les beaux parleurs ; un petit-bourgeois qui vomit la classe moyenne, cette « masse bête et prétentieuse qui se range toujours du côté du plus fort » ; un bouffeur de curé, qui élève la politique au rang d’absolu ; un esprit sensible et sans pitié ; un militant qui chérit moins les gens que les idées, et qui finit par haïr ses semblables. « A ceux qui disent : la haine n’engendre pas l’amour, répondez que c’est l’amour, l’amour vivant qui engendra souvent la haine », disait-il.
Ce livre est un peu sa biographie. Desservi par de trop nombreuses coquilles, mais soutenu par un style enlevé et une élégante traduction, il se lit comme un roman. Un roman noir, aux mille résonances contemporaines, où le meurtrier pourrait porter le même nom que sa victime : Espérance. Tout part de là, tout s’y abîme. Troublante coïncidence : Rose Henry, la mère d’Emile, tenait une auberge baptisée A l’espérance.
– DYNAMITE CLUB. L’INVENTION DU TERRORISME MODERNE À PARIS (THE DYNAMITE CLUB. HOW A BOMBING IN FIN-DE-SIÈCLE PARIS IGNITED THE AGE OF MODERN TERROR) de John Merriman. Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Emmanuel Lyasse. Tallandier, 256 p., 20 €.
Signalons également le livre de Vivien Bouhey, Les Anarchistes contre la République. Contribution à l’histoire des réseaux sous la IIIe République (1880-1914), préface de Philippe Levillain, Presses universitaires de Rennes, 496 p., 24 €.
Jean Birnbaum
[1] Jeanneney Jean-Noël, article « Anarchistes et terroristes » dans Le Monde, 31 juillet 1987.
[2] Coolsaet Rick, article « Au temps du terrorisme anarchiste » dans Le Monde Diplomatique, septembre 2004.
[3] Voir la Revue Itinéraire, (1998) N° 14-15. Numéro spécial consacré à Elisée Reclus.
[4] Proudhon Pierre Joseph, « Qu’est-ce que la propriété ? Ou recherches sur le principe du droit et du gouvernement », 1840.
Tags: anarchie, Badier, Bonnot, café Terminus, cagoule, complot, criminalisation, criminel, Dominique Kalifa, Dynamite Club, Emile Henry, Fortuné Henry, France Culture, Jean Birnbaum, Jean-Noël Jeanneney, John Merriman, Le Figaro, Le Monde, Le Monde des livres, Le Monde Diplomatique, Les Lundis de l'histoire, libération, marmite, marronnier, propagande par le fait, Proudhon, Reclus, Rita Mercedes, rue des Bons Enfants, Tallandier, terrorisme, terrorisme anarchiste, violence policière, Vivien Bouhey, Walter Badier
 Imprimer cet article
Imprimer cet article
 Envoyer par mail
Envoyer par mail



