Dix questions à … Dominique Kalifa
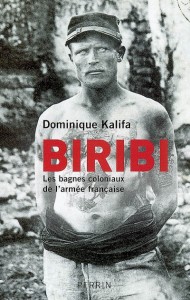
 Dominique Kalifa, en axant la majeure partie de ses travaux sur l’histoire du crime et de ses représentations, a renouvelé la vision de la société française à la Belle Epoque. Avec l’Encre et le sang, paru chez Fayard en 1995, il révèle l’importance du fait divers et de son corollaire le sentiment d’insécurité.
Dominique Kalifa, en axant la majeure partie de ses travaux sur l’histoire du crime et de ses représentations, a renouvelé la vision de la société française à la Belle Epoque. Avec l’Encre et le sang, paru chez Fayard en 1995, il révèle l’importance du fait divers et de son corollaire le sentiment d’insécurité.
Les écrits de ce collaborateur régulier au supplément littéraire de Libération et professeur à l’université de Paris I Panthéon – Sorbonne contribuent donc à éclairer l’histoire de l’honnête cambrioleur et des Travailleurs de la Nuit en particulier, de l’illégalisme français en général. Son dernier ouvrage, Biribi (Perrin, 2009), nous fait plonger dans les bas-fonds des bagnes militaires. Il a bien voulu pour l’occasion répondre à quelques-unes de nos questions.
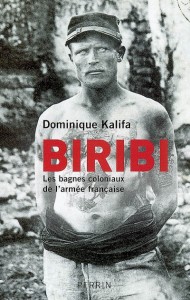 •1) Votre dernier livre, Biribi, explore un pan méconnu de l’histoire coloniale française. Peut-on établir un parallèle avec celle des bagnes de Guyane ?
•1) Votre dernier livre, Biribi, explore un pan méconnu de l’histoire coloniale française. Peut-on établir un parallèle avec celle des bagnes de Guyane ?
Oui, bien sûr, à deux égards au moins. Il s’agit dans les deux cas de bagnes coloniaux, qui procèdent de cette volonté de relégation, voire d’élimination, qui est aux sources de la transportation des condamnés au XIXe siècle. Pendant ce temps, on vide les prisons françaises. Le second parallèle concerne la vie carcérale de ces bagnes, qui est très proche, tant du point de vue de la répression exercée que de la société des détenus, qui obéit à des règles analogues. Cela dit, des distinctions existent aussi, à commencer par la dimension militaire de Biribi, qui lui est propre.
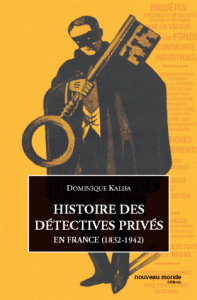 •2) Pourquoi Biribi est-il un « non-lieu de mémoire » ?
•2) Pourquoi Biribi est-il un « non-lieu de mémoire » ?
Parce qu’on l’a largement oublié, et qu’une sorte d’amnésie nationale, à l’instar d’ailleurs de beaucoup de réalités coloniales, a recouvert cette expérience qui était pourtant très familière aux hommes des années 1850-1940. C’est tout l’inverse du « lieu de mémoire » tel que Pierre Nora l’a construit, et qui suppose un actif « travail » de reconstruction et de remémoration nationale.
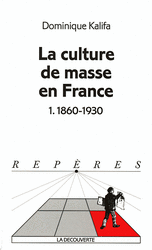 •3) Que recouvre exactement ce terme de Biribi ?
•3) Que recouvre exactement ce terme de Biribi ?
Toutes les structures disciplinaires et pénitentiaires mises en œuvre par l’armée française en Afrique du nord, et par extension, tous les bagnes militaires.
 •4) En quoi le thème de l’insécurité, que vous développez dans vos études précédentes, a-t-il pu participer à votre désir de connaissance sur ces camps militaires d’Afrique du Nord ?
•4) En quoi le thème de l’insécurité, que vous développez dans vos études précédentes, a-t-il pu participer à votre désir de connaissance sur ces camps militaires d’Afrique du Nord ?
J’ai eu l’idée de ce livre lorsque j’écrivais L’Encre et le sang en 1994, notamment autour des grands débats sécuritaires de 1907-1910, lorsqu’on commence à dénoncer « les apaches à l’armée » et que certains réclament des mesures plus énergiques pour lutter contre tous ceux – délinquants, criminels, mais aussi militants révolutionnaires et antimilitaristes – qui menacent l’armée.
 •5) Le cas de Paul Roussenq parait intéressant parce que Biribi l’envoie en Guyane. Tout se passe comme si le chemin vers les travaux forcés était tracé d’avance pour le jeune cheminot du Gard, tombé dans la petite délinquance. Y-a-t’il une volonté établie et délibérée d’élimination du criminel, petit ou grand, du marginal de la « Belle Epoque » ?
•5) Le cas de Paul Roussenq parait intéressant parce que Biribi l’envoie en Guyane. Tout se passe comme si le chemin vers les travaux forcés était tracé d’avance pour le jeune cheminot du Gard, tombé dans la petite délinquance. Y-a-t’il une volonté établie et délibérée d’élimination du criminel, petit ou grand, du marginal de la « Belle Epoque » ?
La pénalité militaire conserve son propre circuit (prisons, pénitenciers, ateliers de travaux publics), à l’exception des condamnations aux travaux forcés prévus par le Code de Justice militaire pour certains crimes. Dans ce cas, le conseil de guerre qui juge le crime envoie le condamné en Guyane. Certains détenus militaires recherchaient même cet envoi parce l’on croyait qu’on s’évadait plus facilement de Cayenne que de Biribi. Elimination ? tout dépend du sens que vous donnez au terme. Relégation serait plus juste, comme le dit d’ailleurs la loi sur la relégation des multirécidivistes de 1885. En fait, beaucoup de criminalistes en sont venus à ce moment à l’idée que la prison ne « corrigeait » pas, et était en un sens inutile. Mais comme il convenait de protéger la société des délinquants – c’est la notion de « défense sociale » qui commence à se développer – les expédier au loin était sans doute la meilleure solution à leurs yeux. Les plus optimistes espéraient qu’ils puissent se régénérer par l’expérience coloniale, les plus cyniques qu’ils s’y engloutissent.
 •6) Le bagne a, par l’entremise d’Albert Londres, révélé Roussenq l’Inco, dont les éditions Libertalia viennent de rééditer les souvenirs. Y-a-t’il eu pour Biribi des victimes « vedettes », soulevant une émotion populaire d’envergure ?
•6) Le bagne a, par l’entremise d’Albert Londres, révélé Roussenq l’Inco, dont les éditions Libertalia viennent de rééditer les souvenirs. Y-a-t’il eu pour Biribi des victimes « vedettes », soulevant une émotion populaire d’envergure ?
Oui, les bataillonnaires Aernoult (assassiné par des surveillants en 1909) et Rousset, qui osa parler et dénoncer les tortionnaires. Ce fut une grande affaire, oubliée aussi aujourd’hui, qui mobilisa tout le mouvement antimilitariste en 1910-1911, et qui réussit aussi à faire rejouer tout le mouvement dreyfusard, qui prit position pour Rousset. Il y eut de grandes manifestations, des procès, des meetings, une grande « cause » que certains appelèrent l’Affaire Dreyfus des ouvriers.
 •7) Vous débutez votre ouvrage par l’historique des critiques faîtes à Biribi. Ces critiques forgent finalement une espèce de légende noire. Le but recherché n’était-il pas de provoquer un effet de peur sur les populations ?
•7) Vous débutez votre ouvrage par l’historique des critiques faîtes à Biribi. Ces critiques forgent finalement une espèce de légende noire. Le but recherché n’était-il pas de provoquer un effet de peur sur les populations ?
Je ne crois pas que l’armée n’ait jamais cherché à susciter une telle légende. Cela pouvait lui servir en un sens (voilà ce qui vous attend si…), et certains officiers ou sous-officiers pouvaient le souhaiter, mais il n’y eut pas d’intention en ce sens. Les autorités militaires (le bureau de la justice militaire) essayèrent plutôt de toujours limiter les abus, même si elles n’y mirent pas toujours les moyens ou l’énergie suffisante.
![]() •8) Qu’en est-il des anarchistes à Biribi ?
•8) Qu’en est-il des anarchistes à Biribi ?
Beaucoup y furent envoyés, ne serait-ce que parce que beaucoup d’entre eux avaient subi de petites condamnations correctionnelles avant leur service, ce qui les expédiait directement à partir de la loi de juillet 1889 aux bataillons d’Afrique. D’autres, mais ce fut moins systématique, étaient envoyés dans les corps disciplinaires par les commandants d’unité pour se débarrasser d’eux. A compter de 1912, il y a un désir croissant d’expédier les antimilitaristes dans les sections d’exclus, ce que la loi permettait.
 •9) Vous vous êtes, en son temps, intéressé à « l’honnête cambrioleur » Jacob. Vous avez même fait partie de notre jury de soutenance de thèse. Le cas Jacob peut-il, selon vous et pour reprendre l’expression de Jean Maitron, être qualifié de témoin du sentiment d’insécurité évoqué précédemment, mais aussi de l’histoire carcérale française ?
•9) Vous vous êtes, en son temps, intéressé à « l’honnête cambrioleur » Jacob. Vous avez même fait partie de notre jury de soutenance de thèse. Le cas Jacob peut-il, selon vous et pour reprendre l’expression de Jean Maitron, être qualifié de témoin du sentiment d’insécurité évoqué précédemment, mais aussi de l’histoire carcérale française ?
L’affaire des bandits d’Abbeville survient en pleine crise sécuritaire, elle joue donc un rôle tout à fait évident, avec d’autres affaires criminelles, dans l’exacerbation de ce sentiment et son exploitation politique à la Belle Epoque. Quant à Jacob, sa longue détention au bagne est évidemment très intéressante à suivre, et en dit beaucoup sur le monde de la transportation. Ses « écrits » sont passionnants à cet égard.
 •10) Lors de notre soutenance de thèse, vous avez évoqué l’impossibilité de détruire le mythe lupinien. L’image de l’anarchiste illégaliste serait dans ces conditions indissociable de celle du gentleman cambrioleur. Alexandre Jacob est-il Arsène Lupin ?
•10) Lors de notre soutenance de thèse, vous avez évoqué l’impossibilité de détruire le mythe lupinien. L’image de l’anarchiste illégaliste serait dans ces conditions indissociable de celle du gentleman cambrioleur. Alexandre Jacob est-il Arsène Lupin ?
Non, évidemment, Lupin n’est pas Jacob ni vice versa, et l’assimilation est tout à fait déplacée. Mais voila, cela fait un siècle qu’on l’évoque régulièrement, ce qui a fini par en faire une espèce de vérité d’évidence, simple et commode. C’est une idée fausse, mais qui a acquis (et continue d’acquérir) une telle épaisseur qu’il sera sans doute impossible de l’éradiquer. Mieux vaut essayer de comprendre pourquoi elle apparait si séduisante aux yeux de l’opinion et des médias.
Tags: anarchistes, armée, bagne, bagne militaire, Belle Epoque, Biribi, Dominique Kalifa, élimination, fait divers, honnête cambrioleur, illégalisme, insécurité, Jacob, Kalifa, L'encre et le sang, Lupin, mythe lupinien, presse
 Imprimer cet article
Imprimer cet article
 Envoyer par mail
Envoyer par mail

 (12 votes, moyenne: 4,83 sur 5)
(12 votes, moyenne: 4,83 sur 5)