Attila et la magie blanche
 Attila aime la magie blanche et nous n’y trouvons rien à redire. Le livre de Gilles del Pappas s’ouvre pourtant sur un singulier avertissement. Il n’aurait pas voulu, selon ses dires, écrire une énième biographie de l’honnête cambrioleur. Logique, l’auteur est un prolixe faiseur d’histoires délaissant ici Constantin le grec pour l’illégaliste Jacob. Ou plutôt pour Marius le Marseillais. Mais, alors, pourquoi, dans cette longue préface, prend-il le soin d’expliquer au béotien lectorat ce que furent le capitalisme triomphant de la belle Epoque, l’anarchisme et le banditisme social ? Pourquoi déclamer son amour du septième art, de cette magie blanche naissante qu’il nous fait découvrir par le prisme d’un ingénieux et intrépide voleur ? Pourquoi, enfin, se prévenir d’une très improbable accusation de lupinose galopante et envoyer aux orties « les experts de tous poils lisant ces aventures à d’autres fins que de s’en régaler simplement » ?
Attila aime la magie blanche et nous n’y trouvons rien à redire. Le livre de Gilles del Pappas s’ouvre pourtant sur un singulier avertissement. Il n’aurait pas voulu, selon ses dires, écrire une énième biographie de l’honnête cambrioleur. Logique, l’auteur est un prolixe faiseur d’histoires délaissant ici Constantin le grec pour l’illégaliste Jacob. Ou plutôt pour Marius le Marseillais. Mais, alors, pourquoi, dans cette longue préface, prend-il le soin d’expliquer au béotien lectorat ce que furent le capitalisme triomphant de la belle Epoque, l’anarchisme et le banditisme social ? Pourquoi déclamer son amour du septième art, de cette magie blanche naissante qu’il nous fait découvrir par le prisme d’un ingénieux et intrépide voleur ? Pourquoi, enfin, se prévenir d’une très improbable accusation de lupinose galopante et envoyer aux orties « les experts de tous poils lisant ces aventures à d’autres fins que de s’en régaler simplement » ?
Nous n’avons pas, après avoir lu ces quelques peu agressives admonestations, reposé « l’humble opuscule » de plus de 500 pages « sur la vénérable table de chêne ancien ». D’abord parce que nos bras étaient trop courts pour atteindre le dit meuble de salon. Ensuite, parce que, de temps à autres, ce genre de lecture, loin de lobotomiser l’esprit, peut le bercer, le reposer, voire même le faire s’évader de la banalité du quotidien. Cela ne constitue même pas un comble pour qui s’intéresse à l’histoire d’un ancien bagnard. Question de curiosité, nous avons porté nos humbles yeux sur Attila et la magie blanche.
L’auteur nous promet un conte mais c’est plutôt un ersatz anarchiste, pas si désagréable que cela, malgré certaines longueurs, des aventures de Martine, du club des cinq ou de Oui-Oui qu’il nous livre. Marius Jacob, voleur intrépide et doté d’une conscience de classe, occupe-t-il le premier rôle ? Cela n’est pas sûr même s’il est le fil conducteur de la narration imaginée par l’auteur. Car, ce Jacob de roman vous emmène au fil des pages et d’une intrigue bien légère à la rencontre de personnages tous plus haut en couleur les uns que les autres.
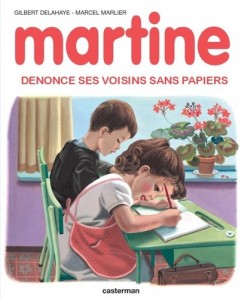 Marius est au chevet de Louise Michel mourante, après l’avoir côtoyée en Nouvelle Calédonie ; Marius fait les quatre cent coups avec son ami Jules Bonnot dont il n’approuve guère le gout pour la violence ; Marius assiste aux derniers jours de Paul Gauguin ; Marius est en meeting avec Pouget et Grave ; Marius discute poésie avec Trotsky devant la tombe de Baudelaire. L’auteur ne précise pas si l’un des deux tient l’ouvrage de William Caruchet dans ses mains ! Continuons. Marius se bat même contre les apaches qui « sont la plaie de Paris » pour défendre Rose son aimée.
Marius est au chevet de Louise Michel mourante, après l’avoir côtoyée en Nouvelle Calédonie ; Marius fait les quatre cent coups avec son ami Jules Bonnot dont il n’approuve guère le gout pour la violence ; Marius assiste aux derniers jours de Paul Gauguin ; Marius est en meeting avec Pouget et Grave ; Marius discute poésie avec Trotsky devant la tombe de Baudelaire. L’auteur ne précise pas si l’un des deux tient l’ouvrage de William Caruchet dans ses mains ! Continuons. Marius se bat même contre les apaches qui « sont la plaie de Paris » pour défendre Rose son aimée.
Marius l’a connu dans d’extravagantes et vaudevillesques circonstances : un vieux mas provençal inhabité. Le premier cambriole la maison de campagne et la seconde le fait visiter à son ami amnésique. Celui-là, prénommé Jean comme on nomme un chien Rex, est l’élément central de l’intrigue à rebondissement. Et il y en a tant, de rebondissements, que l’on finit par se lasser de rebondir pour ne plus remarquer que les arrivées de personnages. La Rose Roux de Del Pappas, jeune femme au grand cœur, finit par avoir autant d’importance que son héros d’amant. Mariée de force par son père, paysan et analphabète, elle fuit le foyer familial à seize pour monter à la capitale et atterrir dans la couche, misérable et artistique de … Pablo Picasso. S’ouvre ainsi au lecteur le Montmartre des peintres et des chansonniers. On évitera de les citer. Rose Roux devient par la suite « jeune comédienne engagée par la Star Film de Georges Méliès » qui devient le quatrième larron de l’histoire, le troisième étant jean, l’ami amnésique. Vous suivez ?
Au fil des pages, les gentils vont en Amérique pour lancer le cinéma à la française. Fort heureusement, le méchant Edison est là pour que le drame puisse survenir. Mais avant, la traversée de l’Atlantique devient croquignolesque. Jean l’amnésique, qui n’a toujours pas retrouvé une once de ses souvenirs perdus, est poursuivi par un dangereux et mystérieux personnage à tête de mort, dont on sait fifre, pendant que Méliès et les deux tourtereaux baguenaudent à bord du vapeur et trinquent avec la bonne société. Un soir, un certain Maurice Leblanc, écrivain, vient même s’assoir à leur table. On a apprécié le pied de nez à l’histoire officielle. Un autre soir rose se prend une cuite d’enfer avec la sulfureuse Colette !
Débarqués à New York, les choses ne font qu’empirer pour le quatuor qui se voit contraint de fuir les USA vers le Canada voisin. Le mystérieux méchant a tout juste le temps de tirer un coup de fusil avant que nos héros favoris ne s’envolent vers l’Europe à bord d’un ballon dirigeable. Mais, Rose touchée par la baballe du vraiment méchant, dont on sait toujours fifre, finit par expirer avant d’avoir atteint la terre ferme du vieux monde. L’intrigue aussi peu serrée et secondaire soit-elle finit, comme Rose, en eau de boudin. Un faux happy End et une vraie fermeture de livre.
Exit Attila. Exit la magie blanche. Retour à la réalité.
 Del Pappas a produit au final une sorte de Mémoire des vaincus à l’envers. Là où Michel Ragon faisait rentrer l’histoire de l’anarchie par le biais d’une fiction, l’auteur mélange la réalité – ou plutôt – pour en faire une œuvre de fiction. Et, si les intentions nous paraissent louables et intéressantes, le résultat réellement lourdaud nous fait entrevoir un décor binaire des plus stéréotypés et manichéens. Les gentils y sont gentils et les méchants d’affreux jojos.
Del Pappas a produit au final une sorte de Mémoire des vaincus à l’envers. Là où Michel Ragon faisait rentrer l’histoire de l’anarchie par le biais d’une fiction, l’auteur mélange la réalité – ou plutôt – pour en faire une œuvre de fiction. Et, si les intentions nous paraissent louables et intéressantes, le résultat réellement lourdaud nous fait entrevoir un décor binaire des plus stéréotypés et manichéens. Les gentils y sont gentils et les méchants d’affreux jojos.
Depuis belle lurette, Marius Jacob a intégré la sphère fictionnelle de l’écrit. Il apparait dans de nombreux polars. Didier Daenincks l’intègre dans 13 rue Meckert, Il est un des pseudos du Poulpe dans L’amour tarde à Dijon de Jacques Vallet. Patrick Pécherot le mentionne dans quelques-unes de ses œuvres et imagine le trésor caché de l’honnête cambrioleur dans Le voyage de Phil dont Zoé D. a fait le compte-rendu pour le Jacoblog. Il est encore un des trois personnages dont le héros anonyme de Jean-Pierre Levaray enfile le costume pour approcher sa cible dans Tue ton Patron. Hormis les Souvenirs d’un révolté, écrits par l’intéressé lui-même en 1905, Gilles del Pappas est le premier à en avoir fait un personnage de roman. Bien sûr, il convient de ne pas tenir compte des « œuvres » de MM. Thomas et Caruchet dont la prise sur le réel avait la prétention de la vérité absolue, quasi-universitaire. Nous l’avons dit plus haut Del Pappas fait fi de cette vanité prétentieuse et c’est tant mieux. Marius Jacob pourrait fort bien alors devenir un personnage récurrent.
Mais, la plupart du temps, le prénom Alexandre est laissé au placard de la réalité. Réalité : rappelons juste que le prénom Marius, deuxième sur l’état civil, ne se justifie que par le prix de revient nettement moins onéreux d’une inscription sur le barnum d’un ancien bagnard devenu marchand forain dans les années Trente. Seulement, l’accent du Midi amplifie les aspects pittoresques et caustiques du récit et selon le bon mot d’Henri Varennes, dans les colonnes du Figaro le 14 mars 1905 : On n’est pas anarchiste quand on s’appelle Marius, qu’on a dans la voix, dans l’allure, dans le geste, la gaieté méridionale et un besoin débardant de rigolade.
Que l’honnête cambrioleur éructe une de ses fameuses diatribes, balance une de ses cinglantes réparties, et l’on imagine de facto les stéréotypes anisés, attachés viscéralement au Sud-Est de la France. De la sorte, convient-il mentalement de rajouter au propos de Jacob des Putain con !, des Fan de Chichoune ! ou encore moult Pécaïre ! pour se représenter Attila déclarant triomphalement la guerre au juge de paix et invectivant tout aussi triomphalement le dieu des voleurs de l’Eglise apostolique et romaine. Triomphalement. Le procédé tourne ainsi à la farce avec des relents de Pagnol, des accents de cigale, des répliques à la Giono, Daudet, Mistral et compagnie. Ca sent l’huile d’olive de chez Puget.
Marius de Marseille comme Igor d’Hossegor pardi !
Processus d’inversion oblige ou principe des vases communicantes, la cause devient facile conséquence et la cause passe au second plan. Jacob vole et est anarchiste. Le constat de lutte des classes, la soif de justice sociale, le refus de toute autorité et la haine des profiteurs en tout genre n’incitent plus, ne poussent plus à revendiquer par les actes le droit au banquet de la vie. L’anarchisme d’un Marius de roman ne se conçoit donc que comme un paravent, une facile façade, une excuse peu crédible finalement pour justifier les délictueuses activités et alimenter l’intrigue. Gilles Del Pappas n’échappe pas à la règle. Certes, son bandit social a des convictions affirmées à n’en point douter. Mais, s’il ne revêt pas les habits du gentleman, c’est toutefois l’intrépide et le jovial que l’on retient en refermant la chose.
Le récit, le roman vrai passent comme vérité absolue parce que s’appuyant sur une réalité recomposée, arrangée, retravaillée mais ce n’est plus de l’histoire. Emoi, joie, crainte, sourire, émotion, sensation … autant de sentiments propres aux livres de hall de gare ou de bord de plage. Et s’il poursuit ce but, faire rêver, Gille Del Pappas n’a pas eu la prétention de faire le spécialiste, celui qui sait. Il offre une aventure et c’est tout. On attend la suite s’il décide d’en commettre une.
Gilles Del Pappas, Attila et la Magie Blanche
Au-delà du raisonnable, 2010
501 pages, 19,50 €
Un matin de 1954, Marius Jacob se souvient de son passé, de son enfance à Marseille, de ses voyages, des camarades de la cause anarchiste qu’il épouse. Et puis de sa rencontre avec Rose, une jeune comédienne engagée par la Star Film de Georges Méliès et flanquée de Jean, un amnésique de deux mètres qu’elle accompagne sur la piste de sa mémoire perdue. A l’époque, l’insaisissable Marseillais signe ses coups «Attila». Avec sa bande des Travailleurs de la nuit, il porte la cambriole au rang d’art, subtilisant leurs biens aux profiteurs d’un système qu’il dénonce. Dans ce roman d’aventures, les épisodes basés sur des faits réels (mais pas toujours) racontent aussi une histoire du cinéma, depuis l’âge des cavernes jusqu’au siècle de son invention. On y croise les acteurs, célèbres ou anonymes, d’un temps qui voit naître bien des combats qu’il ne faut pas abandonner tant qu’ils ne sont pas gagnés.
p.7-12 : Avertissement
Voici un hommage à quelques femmes et hommes que j’admire énormément. Notamment le Marseillais Alexandre Marius Jacob. Ce livre est très fortement inspiré de sa personnalité, de sa vie incroyable. Très fortement, mais pas copié : j’ai voulu prendre des libertés, me distancier… Je ne voulais pas écrire une biographie, il en existe au moins quatre, plus ou moins excellentes, ça suffisait très largement. J’avais envie de rêver. À partir de cette existence, par bien des aspects exemplaires, dériver sur les périphéries de mon imaginaire.
Par ailleurs existe le personnage créé par Maurice Leblanc, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, dont je ne sais à quel point certaines péripéties sont entièrement pompées de la vie aventureuse du sieur Jacob ou pas. Je laisse le soin aux experts de trancher. En tout cas, cela aurait pu également me montrer la voie.
Mais Lupin ne me convenait pas, trop éloigné du véritable aventurier cambrioleur. Je n’ai pas voulu faire ressembler cet élégant aristocrate au personnage de mon histoire…
J’ai écrit un conte en mêlant ce que l’on connaît de Marius Jacob sur des toiles de fond réelles que j’ai pu visiter. L’évocation de personnages, connus ou non, qui vont et viennent, m’échappent et agissent tout seuls, se foutant bien d’une quelconque exactitude. Une envie folle de faire se rencontrer „ des gens qui, j’en suis sûr, auraient eu des points communs avec cet inconditionnel de la liberté qu’était Marius Jacob. J’ai ensuite bien gansaillé en cadence, en haut, en bas, de gauche, de droite. Heu… pardon, de gauche, de gauche. Et encore à gauche. Jusqu’à ce que la sauce prenne. Enfin, je le crois. Et voilà !
Place aux chimères, leurres, aberrations, contretemps, fantômes, illusionnismes et à l’invention de la machine à mélanger le temps pour, en partie, le réinventer. Place aux utopies. Et aux utopistes, bien entendu, dont on ne finit pas de s’inspirer. Dans le meilleur et dans le pire des cas car, dans ce siècle, on voit vraiment de tout…
Soyons lumineux, qu’il n’y ait aucune zone d’ombre ! Que la magie blanche prenne enfin toute la place qui lui est due. Car le début du cinéma était là en genèse, tout petit.
Oh pétard !
Les personnages historiques que je convoque n’avaient pas forcément l’âge de se trouver dans les aventures qui suivent et les événements historiques ont pu également être déplacés. Oui, j’ai cuisiné le temps. Mais je le dis encore bien haut : ce livre est une simple fantaisie, destinée uniquement aux rêveurs, aux désireux d’aventures extraordinaires.
Que les spécialistes du cinéma ou du célèbre Marseillais, les historiens de l’anarchie, de la photographie, de la peinture, les universitaires ergoteurs, les fanatiques, les savants à barbe blanche triturée hystériquement passent gentiment leur chemin.
Qu’ils ne m’en veuillent surtout pas !
Que les experts de tout poil lisant ces aventures à d’autres fins que de s’en régaler simplement – si vous êtes dans ce cas, je vous en supplie à genoux – reposent dédaigneusement cet humble opuscule sur la vénérable table de chêne ancien, là, devant eux ; et la lippe altière, allument plutôt une bonne pipe. Allez lire vos pairs, vos égaux, ceusses qui parlent la même langue obscure, ne vous perdez pas entre ces pages qui vont vous faire bondir d’indignation à chaque détour !
Posez donc ce livre. Ou alors que vous chopiez la gale et que vos bras raccourcissent !
Ce n’est que mon désir (le désir étant prééminent à tout !) de changer la vérité pour la rendre plus conforme à mes fantasmes, pour me donner du plaisir, pour vous donner du plaisir, je n’ai pas d’autre but. La vérité, je m’en fous, la vérité, je m’en tamponne le coquillard, elle ne m’intéresse pas, ou peu. Je crois très sincèrement que les événements que je décris auraient pu avoir lieu. Oui, j’en suis certain, il aurait suffi de pas grand- chose, n’est-ce pas ?
Je crois entendre la voix chevrotante de pépé Ferré chantant les mots du poète Aragon : « Il n’aurait fallu qu’un moment de plus… »
Parlons encore un peu de la liberté. Un mot fort, un mot clé qui explique beaucoup et qu’Alexandre Marius Jacob a placé au plein centre de sa vie. Il ne m’aurait pas désavoué, il n’avait certainement que mépris pour ceusses ayant le culte de la personnalité. Alors, je suis sûr que cet homme intègre m’aurait pardonné mes petites incartades littéraires, historiques, géographiques et autres…
J’espère simplement – j’aime le croire – qu’il m’aurait lu avec l’indulgence profonde et l’humour qui l’habitaient.
Le siècle que j’ai choisi de mettre en scène est véritablement génial. C’est le confluent de notre culture, de notre savoir et de notre politique actuelle. C’était le temps des aéronautes, l’invention de la poste par ballon… La Commune n’était pas loin et la Révolution encore proche.
Un jeune poète encore inconnu, Arthur Rimbaud, écrivait :
« Elles ont pâli, merveilleuses,
Au grand soleil d’amour chargé,
Sur le bronze des mitrailleuses
À travers Paris insurgé. »
La naissance de la photographie va pousser les peintres pompiers dans les oubliettes où on les négligera jusqu’à nos jours. La cote de Lawrence Alma-Tadema, très connu à son époque, va s’effondrer ; j’ai vu des toiles de ce peintre, obsédé par l’Antiquité et le Moyen Âge, se vendre, jusqu’en i960, des sommes vraiment ridicules. Heureusement, les années 2000 vont rendre à ce grand artiste son aura. Une autre forme de peinture marque les esprits, qui ne doit rien, ou si peu, à la photographie, il s’agit de l’impressionnisme.
Je ne peux imaginer qu’entre les trois événements il n’y ait pas de corrélation, et je suis assez surpris de n’avoir jamais entendu nos beaux esprits esquisser cette théorie qui semble assez évidente. La haine farouche que nous, photographes conceptuels des années 60, inspirions aux plasticiens perdure peut-être ? Du coup, si la photo n’est pas art, alors, bien sûr, il n’y a pas de dérive et donc pas de lien.
Les hommes, à cette époque – contrairement à nos jours -, croient fermement en la science, la culture, la philosophie. En l’avenir. Demain il fera beau.
Ils défrichent de nouveaux terrains politiques.
« La dépravation suit le progrès des Lumières. » C’est le poète Nicolas Rétif de La Bretonne qui a écrit cette pensée et utilisa le premier le terme de communisme. Mais l’idée, elle, remonte plus loin dans le temps. Le socialisme naît en 1831 et se répand en France grâce à Pierre Leroux et à son livre Egalité. La fameuse anarchie vient du grec anarkhia qui signifie absence de commandement, de chef, et apparaît dans le livre majeur Qu’est-ce que la propriété ? de Pierre Joseph Proudhon.
Oui, être écrivain est réellement jouissif, car on peut sans aucun frais caster les plus grandes figures de l’Histoire sans débourser un sou !
Il y a dans mon récit des hommes et des femmes qui comptèrent pour le cinéma, des anonymes, de la préhistoire aux temps modernes : Platon – Aristoclès de son vrai nom – et sa caverne, « le Docteur admirable », Roger Bacon, moine franciscain qui fut l’esprit le plus novateur de son époque. On lui doit certainement l’invention des lunettes et de la première lanterne magique ; il est l’un des ancêtre du cinéma. Et puis, surtout, Méliès le magicien.
Parmi les personnages que j’ai choisis, la formidable Alice Guy, première réalisatrice de l’histoire du cinéma, est aujourd’hui une figure injustement oubliée par les hommes. Peut-être parce qu’elle a fait une partie de sa carrière aux États- Unis, ou bien, tout simplement et plus sûrement, dans un monde de machos, parce que c’était une femme. Comme Flora Tristan, grand-mère de Gauguin, certainement la première femme socialiste.
Le capitalisme, quant à lui, existe depuis toujours. On le trouve déjà en 1753 sous la plume d’un certain Claude Adrien Helvétius, un philosophe encyclopédiste.
Quant au libéralisme, celui que nous vivons en permanence et duquel des hommes politiques importants se réclament, le mot apparaît en 1818 dans un manuscrit de Maine de Biran. Le concept, la fameuse « main invisible » veillant à produire l’ordre juste qui en découle mécaniquement et nécessairement, ce pur fantasme utopique, date lui de 1776, dans La Richesse des nations d’Adam Smith. Mais la bible à penser de tous ces messieurs vient d’un médecin hollandais, Bernard de Mandeville, qui va cyniquement écrire dans une fable, La Ruche contente ou Les coquins devenus honnêtes, ce que pensent la plupart des gens d’argent. Il y explique très clairement que les hommes ont besoin des malfrats, des vices, du mal. Plus tard, il persiste dans un texte encore plus explicite, La Fable des abeilles, où « les vices privés font le bien public ».
Je pense que tous les libéraux devraient lire le texte fondateur des idées qu’ils défendent, j’espère qu’ils reviendraient ainsi à des pensées plus humanistes ! Je ne suis pas devenu complètement désespéré des hommes, et j’aime à penser qu’ils peuvent se réformer. Enfin, certains.
Les utopistes de gauche. Les utopistes libéraux.
Ce sont les années où Eiffel construit sa tour au centre de Paris, où la France, force coloniale, exhibe les peuples du monde comme des animaux lors d’expositions dans la capitale et à Marseille, l’époque où la magie blanche – le cinéma – apparaît, fruit de l’ensemble des technologies d’ingénieurs éclairés. Et moi, je suis un nostalgique de ce moment de l’Histoire où tout bascule. Siècle lumineux comme les ciels de Marsiho qui a vu naître le formidable héros de roman qu’est Marius Jacob !
Tags: amnésique, anarchiste, Attila, Au-delà du raisonnable, Baudelaire, Bonnot, cambrioleur, cinéma, Colette, Daeninckx, Edison, Gauguin, Georges Méliès, Gilles Del Pappas, Grave, Jean, Levarray, Louise Michel, magie blanche, Marius, Marius Jacob, Martine, Maurice Leblanc, Méliès, New-York, Pécherot, Pouget, Rose, Rose Roux, Travailleurs de la Nuit, Trotsky, voleur
 Imprimer cet article
Imprimer cet article
 Envoyer par mail
Envoyer par mail

