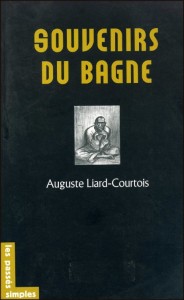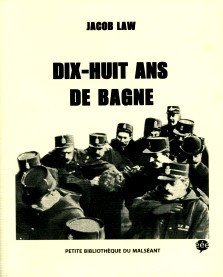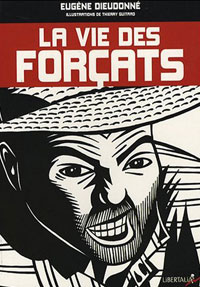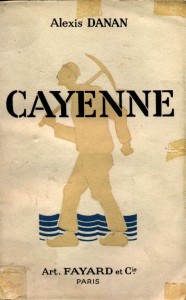Gentil médecin
 Majors, colonels ou capitaines, les médecins du bagne sont des militaires. Ils subissent une double pression : celle inhérente à leur fonction et dans un milieu particulièrement mortifère, et celle de l’Administration Pénitentiaire pour qui le fagot n’est qu’un simulateur. Le constat qu’ils peuvent alors faire induit de facto une opposition qui peut virer au conflit ouvert avec tel ou tel surveillant, puis avec tel ou tel commandant. Le cas du docteur Rousseau n’est pas unique et rares furent les toubibs du bagne, pourtant affranchis de l’autorité instituée, qui firent allégeance à l’œuvre de mort carcérale et ont suivi à la lettre consignes et règlements. C’est entre autres ce qui rend Jacob Law particulièrement acrimonieux à leur encontre… sauf envers l’Oncle Louis qui n’officia pourtant que deux ans aux îles du Salut. On comprend dès lors la courte durée de la fonction exercée et les témoignages qui suivent (Liard-Courtois, Law, Dieudonné, Danan, Maroger, Belbenoit, Roussenq) ne pouvaient que mettre en exergue un véritable apostolat médical en Guyane. Gentil médecin.
Majors, colonels ou capitaines, les médecins du bagne sont des militaires. Ils subissent une double pression : celle inhérente à leur fonction et dans un milieu particulièrement mortifère, et celle de l’Administration Pénitentiaire pour qui le fagot n’est qu’un simulateur. Le constat qu’ils peuvent alors faire induit de facto une opposition qui peut virer au conflit ouvert avec tel ou tel surveillant, puis avec tel ou tel commandant. Le cas du docteur Rousseau n’est pas unique et rares furent les toubibs du bagne, pourtant affranchis de l’autorité instituée, qui firent allégeance à l’œuvre de mort carcérale et ont suivi à la lettre consignes et règlements. C’est entre autres ce qui rend Jacob Law particulièrement acrimonieux à leur encontre… sauf envers l’Oncle Louis qui n’officia pourtant que deux ans aux îles du Salut. On comprend dès lors la courte durée de la fonction exercée et les témoignages qui suivent (Liard-Courtois, Law, Dieudonné, Danan, Maroger, Belbenoit, Roussenq) ne pouvaient que mettre en exergue un véritable apostolat médical en Guyane. Gentil médecin.
Souvenirs du bagne
Charpentier et Fasquelle, 1903
Les Passés Simples, rééditions, 2005
p.233-236 : LES MÉDECINS, LES MALADES ET LES MORTS
La Guyane ne devint lieu de transportation qu’après le coup d’État de 1851. Le premier convoi arriva aux îles du Salut en mai 1852. En 1867, le nombre des transportés envoyés à la Guyane s’élevait à dix- huit mille ; soit une moyenne annuelle de douze cents.
De 1867 à 1880, on n’expédia en Guyane que des forçats condamnés à une peine supérieure à huit années et plus spécialement des Arabes et des Nègres. Deux convois amenaient chaque année sept cents transportés, soit neuf mille cents en treize ans.
À partir de 1880, les convois se renouvellent trois fois par an et comptent chacun de trois cent vingt à trois cent cinquante transportés ; on organise souvent un convoi supplémentaire à destination de la Guyane. Mais tenons-nous en à trois convois; cela nous donne de 1880 à 1898 un ensemble de dix-neuf mille transportés.
Donc, en quarante-cinq ans, la colonie a reçu plus de quarante-six mille condamnés.
Or, en juillet 1898, le nombre des transportés – tant en cours de peine que libérés ou concessionnaires devant répondre à l’appel semestriel – était de sept mille ; ce qui porte la moyenne des morts ou disparus à huit cent soixante-sept par année ; au total et en chiffres ronds : trente-neuf mille de 1852 à 1898, soit 84,5 p. 100.
Les évadés comptent parmi les disparus. Mais, si l’on considère que 2 p. 100 seulement des tentatives d’évasion réussissent et que les grâces, les libérations définitives et les révisions provoquées par des erreurs judiciaires n’atteignent que cinq pour mille des transportés, la proportion des morts ou disparus sera encore de 82 p. 100.
Ainsi, sur cent individus qu’on envoie au bagne, il n’y en a que dix- huit qui ne meurent pas ou qui n’y sont pas tués… qui ne disparaissent pas. Statistique effrayante, si l’on tient compte surtout que l’âge moyen des condamnés aux travaux forcés est de vingt-deux ans.
Dans les chiffres ci-dessus exposés ne sont pas englobés les récidivistes relégués depuis la loi de 1884. En 1892, le nombre de cette catégorie de transportés s’élevait à dix mille, chiffre qui va en s’augmentant de trois cent cinquante à quatre cents par année.
Les relégués, dont je m’occuperai longuement dans un chapitre spécial, occupent un des points les plus malsains du Maroni. Leur camp est, d’ailleurs, justement surnommé le «camp de la Mort».
De 1889 à 1892, il en succomba seize cent cinquante-cinq; et quand je quittai le Maroni, en 1897, l’effectif des survivants était de dix-huit cent-vingt. Cela donne une moyenne de mortalité supérieure de deux et demi pour cent, comparativement à celle des transportés.
La plupart des convois sont décimés dès leur arrivée dans la colonie. La fièvre, l’insolation, la dysenterie, la gangrène – qui s’attaque à la moindre écorchure -, l’insuffisance et la mauvaise qualité de l’alimentation sont les principaux agents de mortalité. La nostalgie et l’hypocondrie font aussi de fréquentes victimes.
Chez l’être le plus vil, chez le plus dépravé, il y a un fond de sentimentalisme qui étonne et déconcerte le philosophe et l’observateur. Et tout indique que, si la société avait su cultiver cet atome de bonté native que tout être porte en soi, les individus qu’elle condamne seraient devenus d’honnêtes gens. J’ai rencontré au bagne des hommes ayant commis des crimes d’une atrocité inexplicable, qui pleuraient de vraies larmes à la pensée qu’un père, une mère, une femme aimée ou un ami pouvait être malheureux à cause d’eux; ils souffraient horriblement et j’en ai vu mourir de consomption.
Ceux qui ont été assez robustes, assez résistants, pour supporter le premier choc, succombent parfois du fait de mauvais traitements; d’autres s’éteignent à l’hôpital, que des soins plus diligents auraient pu sauver. Il y a enfin ceux qui tombent sous la matraque des contremaîtres ou le revolver des surveillants. Ces assassinats sont courants, et ceux qui les commettent sont à peu près certains de l’impunité.
Sur les cent-vingt condamnés que nous étions du même convoi en arrivant au Maroni, il eût été difficile d’en réunir une trentaine après six mois de séjour. Et nous n’avions pas eu d’épidémies. Je laisse à penser ce que c’eût été si la terrible fièvre jaune avait sévi.
Quand plus tard je rentrai aux îles, je constatai que les ravages n’y étaient pas moindres et je n’y rencontrai que très peu de ceux qui étaient venus de France en même temps que moi.
Si l’on apportait un peu d’humanité dans le traitement et d’assiduité dans les soins médicaux, la mortalité serait enrayée dans de notables proportions. Mais le gibier de bagne n’est pas digne d’intérêt; on le déporte pour qu’il meure ; et que ce résultat soit atteint un peu plus tôt ou un peu plus tard, cela n’a qu’une importance minime. Les jurys, d’ailleurs, sont là pour pourvoir à son remplacement.
À l’indifférence coupable de certains docteurs se joint la barbarie des infirmiers. Ceux-ci sont recrutés parmi les forçats; ils échappent à la dure discipline du camp, couchent dans des lits et reçoivent une nourriture plus abondante et plus substantielle que le commun; ils savent l’augmenter au besoin en rognant la ration des malades. Ils commandent en maîtres, oubliant les misères qu’ils ont antérieurement encourues et qui les attendent encore au jour où on les relèvera de leurs fonctions. Ils se cramponnent à leur emploi comme Cynégire au vaisseau perse, et lorsqu’un malade à qui ils supposent quelque argent, s’obstine à ne pas mourir, ils abrègent son agonie par tous les moyens à leur disposition.
L’infirmier est sous la coupe directe de la religieuse de service, aussi s’efforce-t-il de paraître confit en dévotion, il a du bon Dieu plein la bouche et répond d’une voix forte aux prières de la sœur.
De leur côté, les religieuses – dont quelques-unes sont bonnes et impartiales – gardent ordinairement leurs attentions et leurs douceurs pour les hypocrites qui jouent la ferveur et pour les malins qui leur confectionnent des bibelots de piété. Quant aux malades qui conservent l’indépendance de la pensée, ils sont généralement négligés. Les saintes filles songent davantage à la santé de l’âme qu’à celle du corps. Lorsqu’un malade n’a plus que quelques jours à vivre ou lorsque le thermomètre qui prend la température d’un fiévreux dépasse 41, elles appellent en hâte l’aumônier dont la vue a pour conséquence d’effrayer le moribond et de l’expédier plus promptement ad patres.
Autrefois, les médecins des pénitenciers coloniaux étaient des majors de la marine. Ils étaient maîtres dans leur service et jouissaient d’une entière liberté d’action. Quand il arrivait alors que le docteur n’était pas au mieux avec l’Administration, les condamnés en profitaient un peu et les malades étaient, sinon mieux soignés, du moins plus facilement reconnus et hospitalisés.
Cette indépendance du corps médical eut pour effet d’indisposer fortement MM. les administrateurs, qui demandèrent et obtinrent la formation d’un service spécial de médecins coloniaux.
Ceux-ci sont attachés à l’Administration pénitentiaire dont ils relèvent directement et qui les paie. De cette façon, les prescriptions du médecin sont soumises au visa du commandant du pénitencier qui, «sous des prétextes d’économie», supprime, au hasard, telle ou telle ordonnance, enlevant ainsi au malade la potion qui l’aurait peut-être sauvé. Beaucoup de docteurs, il faut le reconnaître à leur louange, ont refusé de s’associer à ces mesures homicides et ont donné leur démission.
J’ai vu de mes yeux un commandant de pénitencier, passant dans les salles de l’hôpital, en faire sortir «par mesure disciplinaire», et sans prendre avis du docteur, un malade entré de la veille.
Le médecin s’insurge parfois contre les fantaisies du commandant, ce dont profitent les transportés malades qui sont plus facilement hospitalisés. À l’époque où j’étais au Maroni, un antagonisme de ce genre existait entre le commandant Deniel et le docteur Mariot qui avait le tort de reconnaître malades tous ceux qui l’étaient réellement. Et le nombre en était grand !
L’hôpital était comble et le camp, aux heures de travail, était rempli d’hommes dont le docteur avait prescrit le repos. Ces exemptions eurent le don d’exaspérer Deniel qui s’en plaignit à la direction.
Le docteur, qui taquinait la Muse, se vengea de l’animosité du commandant en écrivant sur lui une chansonnette satirique qu’il illustra d’un portrait-charge du personnage. Deniel y était représenté chargé d’une hotte pleine de légumes, de poissons, de chapelets, de saucissons et sonnant à la porte de la communauté des sœurs de l’hôpital. La chansonnette était intitulée : La dot à Nonore.
Nonore était le petit nom de la fille du commandant, qui rêvait pour son enfant un avenir à l’abri du besoin ; aussi ne négligeait-il, en vue de l’établir, aucun des mille petits bénéfices que lui rapportait son grade.
La chanson fit bientôt le tour du pénitencier et tous les forçats chantaient La dot à Nonore, au grand dam de Deniel. L’inimitié de ces deux hommes prit une telle acuité que le médecin résolut d’appeler son adversaire sur le terrain. Mais, comme tous les êtres bassement méchants, Deniel était lâche, M. Mariot dut le souffleter publiquement, devant une corvée de cinquante hommes. Le «commandant» refusa de se battre et le docteur fût changé de poste. Je crois me souvenir qu’il démissionna peu de temps après.
Dix-huit ans de bagne
Editions de l’Insurgé, 1926
Egrégores, réédition, 2005
p.87-89 : En 1922, j’ai rencontré un homme qui est digne d’être classé dans le rang des hommes d’action et de sentiments élevés ; il ne s’agit ni d’un transporté ni d’un anarchiste, il s’agit du docteur Rousseau, l’homme qui a lutté ouvertement contre l’Administration, pour le bien des transportés. Grâce à lui on n’a jamais essayé de mettre un malade au pain sec ; tandis que les autres docteurs qui se succédés de 1908 à 1922 étaient les complices de l’Administration et par conséquent des assassins.
C’est par leur faute que les cachots étaient pleins, et que les réclusionnaires mouraient dans leur cellule, de fièvre, de scorbut et de dysenterie, faute de soins.
En 1922, le docteur Rousseau a dit au gouverneur qu’il hospitaliserait, un à un, tous les réclusionnaires parce que l’Administration leur faisait subir un régime barbare. Il a fait comme il avait dit. Il a donné la liberté à beaucoup de condamné en les envoyant à la grande terre ou au Nouveau camp comme malades, quoiqu’ils fussent internés.
Il agissait ainsi contre la volonté de l’Administration dans le but de leur rendre la liberté.
Grâce à lui, en effet, les hommes qui n’avaient plus d’espoir, étant depuis dix, quinze ou vingt ans sur les îles du Salut, ont pu partir en évasion. Beaucoup n’oublieront jamais le docteur Rousseau, car s’ils sont maintenant en liberté, en Amérique ou ailleurs, c’est à lui qu’ils le doivent.
Rousseau n’a jamais touché la main à un surveillant militaire. Quand il faisait sa visite, il mettait dehors, comme un chien, tout surveillant qui tentait de parler contre un transporté.
Pour se moquer de l’administration, il me disait : « Si ça ne va pas, venez me voir, Law » et, malgré la volonté du gouverneur, il me donna plusieurs mois de repos.
Malheureusement, le 10 mai 1922, le Docteur Rousseau quitta les îles pour retourner’ en France. A partir de ce jour, l’Administration a commencé à se venger en mettant au pain sec tous ceux qui se faisaient porter malades. A dater de ce jour, la vie de misère a recommencé.
La vie des forçats
Gallimard, 1930
Libertalia, réédition, 2007
p. 92 : En Guyane les médecins-majors sont souvent humains et tempèrent la rigueur du règlement. Ils ne sont pas toujours dupes des simulateurs et souvent ne les signalent pas à l’AP. Ils ont conscience de remplir un apostolat et rachètent par leur dévouement un peu des injustices s’étalant sous leurs yeux.
p.163-164 : Les médecins-majors sont généralement aimés des condamnés pour le bien qu’ils font.
Le docteur Rousseau a laissé en Guyane le souvenir d’un apôtre, doublé d’un savant. Combien d’hommes n’a-t-il pas guéri, encouragés, amendés, sauvés.
Un jour, un Arabe fut surpris à voler chez le docteur Rousseau. Prévenu, il fit mander l’Arabe ;
« Pourquoi m’as-tu volé ?
– Moi faim beaucoup, major.
– Eh bien, ne vole plus. Viens ici tous les matins, mon cuisinier te donnera à manger. »
L’Arabe ne vola plus. Je cite ce trait entre mille.
L’hôpital militaire de Cayenne est dirigé par un médecin principal, chef du service de santé de la Guyane. Il y a là de nombreux emplois qui sont souvent occupés par des forçats ou des libérés. Souvent, les médecins sollicitent leur grâce du ministère qui en tient généralement compte.
Cayenne
Fayard 1934
p.168-170 : LA FIN DU FORÇAT
Le médecin-colonel Espinasse baissa la voix.
– Ici, dit-il, nous sommes chez les tuberculeux.
Une grande salle blanche, pleine de lumière et de paix. Sur les oreillers, humides de transpiration, des têtes longues, osseuses, reposaient, le nez pincé, les paupières bleues. Presque toutes avaient l’air d’appeler le geste final, qui relève le drap sur la face immobile.
Le médecin, d’un regard rapide, fit le tour des lits. Il interrogea l’infirmier qui nous accompagnait :
– Le rouquin du bout, là-bas, il est fini ?
– On l’a enlevé vers deux heures.
– Il en manque un autre, depuis ce matin ?
– Lacier. Il a passé presque en même temps que le rouquin.
Le docteur se tut, se frisa sa petite moustache blanche. Puis :
Surveillez Cazals, dit-il. Il a une mauvaise respiration.
Nous sortîmes sur la pointe des pieds.
Le médecin-colonel Espinasse connaît tous les malades de sa maison, beaucoup par leur nom, les autres par leur visage ou leur cas, et il y a du mérite, car on entre et sort tout le jour, à l’hôpital de Saint-Laurent. La nuit même, la nuit surtout est active. Les médecins-capitaines Gourmelon et Boux n’ont que le temps de fumer une cigarette entre deux réparations de ventre, à la salle de chirurgie. Les drames de la case nocturne ont ici leur premier écho, de sorte que les jeunes chirurgiens qui aiment leur métier ne veulent plus quitter Saint-Laurent. Il n’y a pas, en France, d’internat qui vaille celui-ci. La moyenne est de trois ventres ouverts par nuit. Le médecin-capitaine qui précéda Gourmelon a compté qu’il avait réalisé, à lui tout seul, six cent vingt opérations, en deux ans. L’admirable est que cette orgie de sang les laisse sensibles et humains. Je n’ai pas rencontré un forçat, un libéré, qui ne rendît hommage à ces hommes, pour cette merveilleuse aptitude qu’ils ont d’évaluer la lassitude morale, du même œil qu’ils décèlent le fléchissement physiologique. Ils admettent qu’un libéré, de temps à autre, éprouve le désir de coucher dans un lit, de manger chaud à des heures régulières, et même qu’un forçat en cours de peine exprime, avec de grosses ruses, l’ambition de reposer un peu son estomac du régime quotidien des lentilles, des haricots rouges et du riz.
– Pourvu qu’il y ait de la place, n’est-ce pas ? disent-ils.
La nourriture des condamnés, non seulement à l’hôpital, mais dans les camps, est le souci majeur du médecin-colonel Espinasse. Il pense, se tenant, non sur le terrain de l’humanité, mais sur celui de la logique, pour ainsi dire utilitaire, que la ration allouée aux forçats est peut-être suffisante pour les entretenir, mais non pas pour les mettre en état de fournir dans la colonie le rude effort qu’ils y doivent, et même un effort moyen. Il écrivait, dans son rapport annuel le plus récent, étayant son affirmation de chiffres et non de considérations sentimentales : « La ration normale du transporté est strictement calculée. Elle est au-dessous d’une ration de travailleur. »
Peut-être cette explication d’un technicien désintéressé dispense-t-elle d’en chercher d’autres, touchant la réelle faillite du bagne en tant que moyen de mise en valeur de la plus riche, sans doute, de nos colonies.
Mireille Maroger
Bagne
Editions Denoël, 1937
p.141-142 : La plupart des médecins se sont révoltés contre un tel système [la réclusion cellulaire]. Ils dénoncèrent inlassablement cette peine comme génératrice fatale du scorbut. Aussi, depuis 1925 un décret prévoit-il que tous les trois mois, le forçat quittera l’isolement de sa cellule pour faire en plein air des travaux en commun avec d’autres condamnés. La peine peut même être interrompue si la santé du réclusionnaire est trop précaire.
Cette réforme est l’aveu implicite qu’un tel châtiment, non coupé de sorties, conduit irrémissiblement à la mort. Sans les médecins, dont l’humaine compréhension a pallié à la dureté de ce régime, en coupant les périodes de réclusion par des hospitalisations fréquentes le législateur n’aurait pas compris l’usage de cette réforme.
Les médecins ont d’ailleurs trouvé d’autres moyens d’atténuer ce régime qui indigne leur conscience. Ils ordonnent des citrons, des heures de préau supplémentaires, exigent pour certains condamnés que le bat-flanc soit rabattu pendant le jour et continuent enfin à prescrire des séjours à l’hôpital.
p.217-218 : Le Docteur Rousseau tout d’abord. Cet homme dont la profession est de sauver des vies humaines, écrivait dans l’introduction du livre qu’il a publié sur le bagne quel point sa conscience de médecin s’était révoltée devant l’œuvre de mort accomplie là-bas. Il n’a cessé de me prodiguer le témoignage de sa plus entière sympathie.
On a déjà trouvé dans les extraits de livres que j’ai repris au chapitre concernant les surveillants militaires l’opinion exacte du Docteur Rousseau sur le bagne.
Il a vécu là-bas deux ans, pendant lesquels il a soigneusement noté ce qu’il voyait, et consciencieusement combattu les abus les plus flagrants.
« Il n’est rien, me disait-il, dans votre reportage que je n’aurais signé, et vous êtes, je vous l’assure, au-dessous de la vérité ».
Au-dessous de la vérité… c’est le refrain de tous mes correspondants.
Les compagnons de la Belle
Les Editions de France 1938
p.141-143 : Le docteur était très bon pour les forçats. Il était même trop bon et nos malheurs l’émouvaient à un point tel qu’il hospitalisait tous les malades possibles et imaginables et nous bourrait non seulement de médicaments mais encore nous prescrivait de plantureux régimes. Je pense qu’il avait le cerveau un peu détraqué. Toujours est-il qu’en quelques mois il vida la pharmacie et la dépense. A la suite de cet exploit il ne fit pas long feu et l’Administration pourvut à son remplacement.
Le docteur Rousseau lui succéda et se mit sans tarder à appliquer ses méthodes personnelles. Le fait que l’hôpital des Iles n’avait pas d’eau courante, que toutes ses vitres étaient cassées et qu’on ne pouvait y admettre séance tenante des hommes qui se mouraient de dysenterie, de typhoïde, de malaria ou de tuberculose, loin de l’amener à prendre l’attitude résignée d’un philosophe l’incita au contraire à redoubler d’activité. Quand il n’y avait pas de poulet et partant pas de bouillon pour les malades, il décrochait tranquillement son fusil et s’en allait faire un tour dans la basse-cour des gardiens. Et pan ! pan ! pan ! II ramenait une vingtaine de poulets. Il déclarait alors aux gardiens fous de rage qu’ils n’avaient droit qu’à quelques volailles quand des moribonds avaient besoin d’un peu de réconfort. Il s’arrangeait pour que, tous les trois mois, les hommes condamnés à l’horrible supplice de la détention en cellule vinssent se refaire pendant un mois à l’hôpital. Il n’hésitait jamais à exprimer aux gardiens et même au commandant sa façon de penser et quand il s’était mis quelque chose en tête, il fallait en passer par où il voulait.
Dès son arrivée aux Iles il commença par vider l’hôpital. Il y trouva cent vingt malades et déclara que, dorénavant, il n’en admettrait que cinquante. Quand il examina mon cas, il ne chercha pas à dissimuler son étonnement devant la quantité de nourriture que m’avait prescrite son prédécesseur. Il me mit pratiquement à la diète. Ce fut ce qui me sauva. Le miracle se produisit. Bientôt je fus en état de manger du pain et je commençai à reprendre du poids. Chaque semaine j’engraissais de trois à trois kilos et demi et en montant sur la balance, j’éprouvais un véritable sentiment de joie à la pensée que je ne laisserais pas mes os en Guyane.
Vers le milieu du mois de mars, le médecin parla de m’inscrire sur la liste des sortants, mais je lui demandai de me garder jusqu’au premier avril, date qui devait marquer la fin de mon sixième mois de séjour à la Royale et du même coup l’expiration de ma peine. En restant à l’hôpital jusque-là j’éviterais de faire connaissance avec les cachots. Le médecin comprit le sens de ma requête et eut la bonté d’y accéder.
A ma sortie de l’hôpital, je me rendis au bureau du gardien chef des Iles. Il me fit signer mon élargissement sur le registre des prisons, m’affecta au second peloton de prisonniers et m’envoya aux baraquements de la Royale ?… à la Case Rouge où tant de forçats célèbres trouvèrent la mort.
En dehors du gouverneur Siadous, le docteur Rousseau est probablement le seul homme dont les forçats parlent encore. Mais on le rappela en France. Le jour où il quitta les Iles, au moment où il s’embarquait dans la baleinière, les forçats lui offrirent un gros bouquet de fleurs cueillies par eux.
Pucheu éditeur, 1957
Libertalia, réédition, 2009
p.77-79 : Les médecins militaires
La Guyane, terre insalubre par excellence, est le foyer de nombreuses maladies, dont la plupart sont endémiques. Citons les diverses fièvres : la dysenterie, l’anémie sèche et enflée, l’ankylostomasie, les maladies de peau et sous-cutanées, la jaunisse, etc. Il y a aussi les maladies provenant des piqûres d’insectes et de serpents.
Les hôpitaux ne sont pas assez vastes pour contenir tous les malades qui devraient y trouver place. En présence de cet état de choses, la tâche des médecins militaires affectés au bagne est particulièrement ardue. Et cela d’autant plus qu’ils doivent s’occuper aussi de la population indigène, car il n’y a pas de médecins civils en Guyane.
Je dirai tout de suite qu’ils remplissent la mission qui leur est dévolue avec un dévouement admirable qui mérite les plus grands éloges. L’abnégation et le sacrifice sont à la hauteur de leur valeur professionnelle. Presque tous montrent envers les condamnés la plus grande sollicitude, ne ménageant ni leur temps ni leur bourse. En effet, il n’était pas rare de les voir apporter de chez eux aux malades du Champagne, des fruits et autres douceurs. Ils se doublaient, en général, de chirurgiens de talent. Ces praticiens trouvaient là un magnifique champ d’études et d’expérimentation.
Ils devaient, à chaque instant, soutenir contre la Tentiaire une lutte opiniâtre dont ils sortaient presque toujours vainqueurs.
La Tentiaire prétendait leur mettre des bâtons dans les roues, par mesure d’économie, soit pour le renouvellement des vivres d’hôpitaux, soit pour celui des médicaments. Elle leur contestait aussi certaines prérogatives qui étaient dûment de leur ressort, notamment en ce qui concernait l’hospitalisation des hommes punis, ou bien l’amélioration du régime de leur punition. La force d’inertie employée par une administration routinière et caduque n’était pas la moindre à laquelle devaient se heurter les médecins. Ces derniers passaient visiter les malades hospitalisés deux fois par jour, se levant la nuit pour se rendre compte de l’état de malades graves. Ils procédaient aux analyses, aux autopsies, aux opérations.
Ils avaient charge également de contrôler la qualité des bêtes à cornes abattues, de faire la visite des camps et chantiers, de s’occuper des salles de maternité, de veiller à l’hygiène générale : on peut juger de leur travail écrasant. Leur mérite était d’autant plus grand qu’ils n’en attendaient aucune récompense, se sacrifiant obscurément dans le cours de leur apostolat.
Pourquoi me faut-il jeter une note sombre sur ce tableau harmonieux?
Il faut bien dire, pourtant, que certains médecins indignes de ce nom manquaient totalement à leur plus élémentaire devoir. On les dénommait médecins administratifs parce qu’ils étaient toujours du côté de la Tentiaire contre les condamnés.
Avec eux pleuvaient les mentions « non malade », qui entraînaient des punitions disciplinaires ; ils infligeaient la diète hydrique jusqu’à huit jours, avec isolement.
Enfin, ils laissaient mourir sans soins quiconque était l’objet de leur indifférence ou de leur parti pris.
Certains passaient la visite avec un revolver sur la table. L’un d’eux avait imaginé ordonner des pointes de feu exécutées avec un fer à souder, rougies à blanc sur un brasero installé auprès de la salle de visite.
Mais ces médicastres, ces bourreaux étaient rejetés par leurs collègues qui les désavouaient hautement. Généralement, ils ne restaient pas longtemps en Guyane.
D’ailleurs, ils ne formaient qu’une faible minorité.
Tags: AP, bagnard, bagne, Belbenoit, Danan, Dieudonné, docteur, docteur Rousseau, fagot, Guyane, hôpital, îles du Salut, Jacob Law, Liard-Courtois, major, malade, Maroger, médecin, médicastre, mort, Oncle Louis, Roussenq, simulateur, toubib
 Imprimer cet article
Imprimer cet article
 Envoyer par mail
Envoyer par mail