Pini dans les coulisses

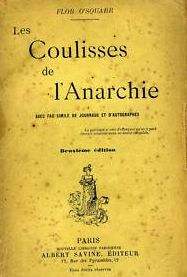 Nous ne savons pas grand-chose de , Charles- Marie Flor O’Squarr. Nous ne connaissons même pas sa date de naissance. Tout juste pouvons-nous avancer que cet écrivain et publiciste belge a suivi la voie tracée par son père Joseph Charles (1830-1890) dont il reprend d’ailleurs le pseudonyme. Il a été rédacteur au Figaro et au Petit Parisien avant d’entrer au Matin. Décédé en 1921, il était aussi correspondant en Belgique du Temps. Auteur aujourd’hui oublié, il demeure néanmoins une référence pour qui étudie le mouvement anarchiste français. Ses Coulisses de l’anarchie ont paru tout juste après l’exécution de Ravachol en 1892. Si l’auteur cherche un coup médiatique évident à la manière du Péril anarchiste de Félix Dubois deux ans plus tard, force est alors de reconnaitre que son livre fourmille de renseignements malgré les a-priori de son temps.
Nous ne savons pas grand-chose de , Charles- Marie Flor O’Squarr. Nous ne connaissons même pas sa date de naissance. Tout juste pouvons-nous avancer que cet écrivain et publiciste belge a suivi la voie tracée par son père Joseph Charles (1830-1890) dont il reprend d’ailleurs le pseudonyme. Il a été rédacteur au Figaro et au Petit Parisien avant d’entrer au Matin. Décédé en 1921, il était aussi correspondant en Belgique du Temps. Auteur aujourd’hui oublié, il demeure néanmoins une référence pour qui étudie le mouvement anarchiste français. Ses Coulisses de l’anarchie ont paru tout juste après l’exécution de Ravachol en 1892. Si l’auteur cherche un coup médiatique évident à la manière du Péril anarchiste de Félix Dubois deux ans plus tard, force est alors de reconnaitre que son livre fourmille de renseignements malgré les a-priori de son temps.
Et, parce que « tout anarchiste se double d’un spécialiste », l’auteur se montre prolixe sur le cas Pini « type achevé du voleur théorique », dont il nous dresse un portrait qui tranche particulièrement avec la vision criminaliste et sécuritaire que la presse de l’époque a pu établir de cet « honnête homme, travailleur, intègre, laborieux, devenu criminel par conviction socialiste et dans des conditions de désintéressement qu’un ascète lui envierait ». Mais Flor O’Squarr n’a ni écrit la fin de l’histoire ni même l’amitié qui lia Pini à Duval en Guyane. En le condamnant aux travaux forcés, la cour d’assises de la Seine envoyait l’illégaliste à une mort certaine.
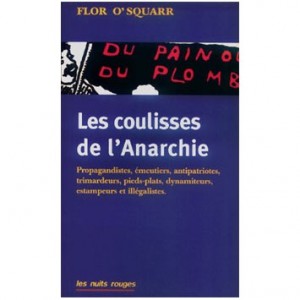 Flor O’Squarr, Les coulisses de l’anarchie, 1892, réédition Les nuits rouges, 2000, p. 118-132 :
Flor O’Squarr, Les coulisses de l’anarchie, 1892, réédition Les nuits rouges, 2000, p. 118-132 :
Pini est le type achevé du voleur théorique.
Nous possédons sur lui un document précieux : sa vie telle qu’il la raconta, telle qu’il l’écrivit lui-même pendant sa détention à Mazas, en attendant sa comparution devant le jury. Tout n’est pas irréprochable dans cette autobiographie ; si nous n’y rencontrons aucune allégation véritablement fausse, il s’y trouve des appréciations tant soit peu erronées -surtout des lacunes Cela sent la besogne accomplie en prison, alors que le spleen, le chagrin vous font tomber la plume des doigts et que la rêverie du prisonnier hante le regret de la liberté perdue. Tel quel le document a sa valeur. Chemin faisant nos renseignements personnels le compléteront :
« Fils d’un pauvre paria, j’ai commencé ma carrière entouré des délices dont la bourgeoisie nous comble depuis le berceau. J’ai vu mourir de misère six de mes frères. Une de mes sœurs s’est usée au service d’une famille de bourgeois étiques.
Mon vieux père, après une douloureuse vie, après avoir donné à la bourgeoisie soixante ans de ses sueurs et avoir enrichi bon nombre de patrons, est mort comme un chien dans un hospice de charité, loin de ses enfants. Bien que les apparences puissent prouver lé contraire, ma famille fut comme celle de tout prolétaire, et, en échange d’une entière existence de travail n’eut que misères, douleurs et abrutissement.
Je passai mon enfance dans un asile de charité et ayant terminé le cours élémentaire, je fus contraint par le besoin à entrer en atelier à l’âge de douze ans. »
L’anarchiste omet de nous dire que les propos de son père eurent une influence singulière sur son esprit. Pini père avait été garibaldien. Il fut de ceux qui, derrière le sublime aventurier niçois, s’embarquèrent à Gênes pour aller conquérir la Sicile et le royaume de Naples, et qu’il retrouva presque tous à Mentana et à Dijon.
Comme tous ces hommes, Pini père adorait le général et en enseignait la vénération à son entourage. Dès son jeune âge, le futur anarchiste haussait les épaules et demandait à son vieux père ce que le dogme de l’unité italienne -il appelait cela un dogme – avait rapporté à la classe ouvrière. Déjà le dédain de la politique formait la base de son jugement, et déjà il concevait la théorie du droit au vol.
Dans l’atelier du typographe Stefano Calderini qui lui donne un franc par semaine, l’enfant vole un jour dix francs. On le surveille, on le prend ; mais sur les prières de son père, on lui pardonne. Il a conservé une impression profonde de ce jour où il a vu son père humble, en larmes, devant le patron, rougissant d’avoir pour fils un voleur.
Plus tard il discute le fait :
« Maintenant, qu’il me soit permis d’établir un juste parallèle entre l’honnête industriel et le gamin larron. Et ici, il me semble logique de vous demander par quelles lois d’équité et de justice il est permis d’appeler honnête homme l’individu qui vit et s’engraisse des sueurs d’autrui et voleur et canaille l’ouvrier qui, produisant toutes choses, se voit dépouillé de la plus grande partie de son produit et condamné à la misère source d’esclavage et d’abrutissement.
« Et je vous demande si un franc pouvait être l’équitable rétribution de huit jours de travail et si, avec cette somme, je pouvais satisfaire mes besoins ?
N’est-il pas évident que, dans ce cas, de nous deux, le véritable voleur était mon patron puisqu’il me volait le produit entier de mon travail et que moi, l’expropriant de la somme de dix francs, je n’avais que repris une minime partie du montant de mon labeur bravement encaissé par l’honnête patron ?
« Est-ce que les lois de la nature ne me faisaient pas éprouver les mêmes besoins que mon patron, et n’avais-je pas, autant que lui, le droit de les satisfaire ?
Mais lui, en récompense de son oisiveté, les lois de votre organisation sociale lui permettaient de jouir des doux plaisirs d’une vie bourgeoise, et mon travail, ajouté à celui de trente autres ouvriers, formait affluent dans sa très honnête caisse.
« Et cet homme qui, dans sa jeunesse,, ne possédait pas un sou, sut, moyennant le travail d’autrui, mener une existence béate et mourir propriétaire foncier, pendant que la plupart de ses ouvriers vécurent et moururent dans la misère. »
En poursuivant ce récit si curieux à tant de titres -puisqu’il nous fournit l’histoire de la formation des idées anarchistes dans la cervelle d’un jeune ouvrier-, nous voyons Pini changer d’imprimerie, devenir typographe dans l’équipe d’un journal rédigé par des écrivains de la gauche, par des publicistes dévoués aux idées des Cairoli, Crispi, Nicotera, Zanardelli, Depretis, Canzio, Bovio, Cavalotti, Rossetti, Pantano, etc4. Là il s’efforce de compléter son éducation. Il passe à Reggio, y obtient son affiliation à l’Internationale et, plus instruit, plus âgé, plus mûr pour les combats de la vie, arrive à Milan en quête d’une existence meilleure.
Là il prend part à une grève pour s’en retirer presque aussitôt -la grève lui paraissant une arme inutile et stu- pide- et il s’enrôle dans le corps des sapeurs-pompiers. Pas pour longtemps. On le voit s’essayant au commerce, n’y réussissant point et finissant par obtenir une petite situation de commis à la préture urbaine de la ville. Cela ne l’empêche pas de s’occuper de politique et de juger sévèrement les hommes de la gauche enfin parvenus au pouvoir :
« La misère, la pellagre, l’ignorance, le manque de travail et l’émigration s’étaient accrus démesurément depuis 1876. Au contraire, les promesses de ces sublimes génies eurent pour suite l’application de nouveaux impôts, la dilapidation des finances publiques, l’achat et la vente des consciences, le « serrement du frein » et le « cela me plaît » de Depretis, ainsi qu’une infinité de concessions réciproques, par lesquelles ces très honnêtes administrateurs se nommaient chevaliers, commandeurs, et les cordons de l’Annonciade tombaient sur le cou de ces fiers républicains. Ces grands patriotes s’illustraient dans les affaires et se mettaient du clinquant sur la poitrine comme…
Pauvre peuple! et pauvres espérances! Tes sueurs avaient servi plus que jamais à enrichir ces affamés et, pendant qu’en travaillant tu crevais de faim, les orgies, les fêtes et les somptueuses réceptions de tes élus se multipliaient, et pour toi, pauvre Paillasse ! les lointaines rumeurs de ces malpropres bacchanales devaient suffire à te remplir la panse. Le pays parut bientôt en avoir assez et déclara Depretis homme fatal aux destins de l’Italie. »
Il quitte Milan à la hâte, compromis dans une agitation électorale avec les meneurs du parti ouvrier, vit pendant quelques mois en Suisse., arrive à Paris en 1886. Il y entra tout frissonnant d’enthousiasme, heureux d’y marcher enfin. Paris, lui avait-on dit, c’est l’Eden.
« Et, de fait, aux premières apparences, il y avait lieu de le croire. Sur chaque monument et édifice public, les mots «Liberté, Egalité, Fraternité» étaient inscrits, comme pour m’indiquer que, finalement, je foulais la terre promise. Une sorte de vernis démocratique était l’apanage de tout citoyen et, réellement, je me trouvai enchanté de l’accueil que j’y reçus. Comme ces places, ces grands boulevards, les Champs-Elysées me parurent majestueux! Quels magnifiques palais ! Il me semblait juste d’admirer les œuvres d’un libre génie. Pauvre fou. A peine eussé-je épuisé mon peu d’argent que les choses changèrent vite et que je m’aperçus de la farce ridicule qui se jouait dans cette grande cité.
« Ses innombrables magasins étaient pleins de tous les produits extorqués au travailleur; l’infortuné avait trop donné à sa sangsue; il avait produit cent fois plus que la bourgeoisie ne pouvait consommer; on n’avait plus besoin de lui jusqu’à nouvel ordre et, en attendant, on le laissait sur le pavé en proie à la faim et à toutes les conséquences qui l’accompagnent.
Triste égalité d’un peuple libre ! Ces parias, je les comptais par milliers, pendant que par milliers aussi je comptais les panses ventrues des gros bourgeois qui, aux terrasses des grands cafés, prenaient leur apéritif pour se préparer à bien digérer et passer ensuite une joyeuse soirée avec quelque fille de meurt-de-faim.
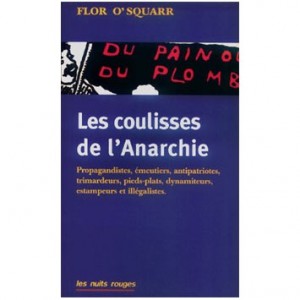 « Comme la vie parisienne était belle pour ces gens!
« Comme la vie parisienne était belle pour ces gens!
« Musique, bals, cafés-concerts, jeux, théâtres, femmes ; et pendant que, des somptueux édifices et des salles illuminées, s’envolaient les échos de ces fêtes, le policier, sur la voie publique, à chaque instant arrêtait les victimes de l’opulence, inculpées d’avoir l’estomac vide et d’être privées de domicile. Un vagabond pour la relégation est une bonne note pour le policier. Voilà la morale de vos lois et de la liberté d’un peuple républicain.
« Puis, le matin, pendant que le bourgeois, sur la douce plume, se délassait des soûleries nocturnes, je voyais arriver par bataillons ces ouvriers qui avaient tout produit et qui, mourant de faim, attendaient pendant trois ou quatre heures à la devanture de ces restaurants pour manger une soupe confectionnée avec des os dépouillés et les restes que la bourgeoisie rassasiée et soûle abandonnait en pâture aux chiens. J’en ai vu qui, pour être des premiers, dès 4 heures du matin, stationnaient pour la distribution de 8 heures. Quatre heures, l’estomac vide, en plein hiver, pour recevoir une soupe que le chien du bourgeois aurait dédaignée ! Et comme la distribution n’arrivait qu’à moitié colonne à cause du grand nombre des miséreux, ceux-ci se jetaient alors sur les caisses aux immondices gisant devant les maisons et disputaient aux chiens sans maître cet horrible repas. Et cela, je le voyais en plein boulevard, au restaurant Brébant et sur cent autres points de la ville, sur le seuil de ces grands magasins remplis de toutes les belles choses de la nature et du produit des fatigues du travail. – Oh! fraternité du régime démocratique. »
Il faut vivre. L’ancien commis de la mairie de Milan s’improvise tour à tour ramoneur, fumiste, garçon d’écurie, coltineur de charbon, scieur de long, employé de commerce, camelot. Et le voici lié avec l’ouvrier parisien.
« La plus grande partie d’entre eux étaient illettrés mais raisonnaient mieux que moi; leurs études ils les avaient faites sur le grand livre pratique des souffrances dont les pages sont tracées en caractères de sang et de larmes.
« Ce furent ces pauvres parias qui m’initièrent les premiers au grand idéal anarchiste, et qui, du sein de leur misère, m’exposèrent comment la société pourrait cheminer heureuse et tranquille dans le monde de la vraie justice.
« Comme ils me parurent grands, ces hommes que la société bourgeoise, après leur avoir sucé le sang, comblait de mépris et d’insultes !
« Les Paroles d’un révolté, de Kropotkine, firent de moi un anarchiste convaincu, et ce fut seulement alors que je pus apprécier les hommes et les choses à leur vrai point de vue. »
Voici l’anarchiste formé. La cristallisation des idées vient de s’achever, le prince Kropotkine lui ayant fourni les formules nettes de ses songeries. Dès lors l’ennemi, le principal ennemi de Pini, ce sera le socialiste classé, le député du Parti ouvrier, Tolain5, Joffrin, Basly, Camélinat, Jules Guesde, ceux qu’il accuse de s’être fait un marche-pied des misères populaires pour arriver à la conquête d’une part de pouvoir représentatif, d’un mandat grassement rétribué. C’est Pini qui dorénavant entreprendra contre eux la campagne, souvent victorieuse pour lui, des réunions publiques. L’anarchiste ne montera pas à la tribune, ne parlera pas. Non. A quoi bon répondre à ces esclaves de la bourgeoisie? Avec quelques amis décidés, il envahira les salles de réunion et y portera un tumulte dont les plus patients n’auront pas toujours raison.
Enfin, vers 1887, Pini cesse de travailler régulièrement. Il vole. Et quand la justice lui demandera compte de ses vols -tellement nombreux qu’elle ne les a point connus tous – Pini se lèvera au banc des accusés et, calme, maître de sa voix et de son geste, il exposera au jury non point un plan de défense, mais la théorie même du droit au vol. Cette plaidoirie de Pini doit prendre place dans cette étude ; nous en reproduisons les passages principaux.
« Voici pourquoi, aujourd’hui, vous me trouvez ennemi déclaré de tout système qui garde pour base la valeur conventionnelle, de cette valeur qui forme la propriété individuelle, seul agent qui pousse l’homme à accomplir les plus monstrueuses infamies, les plus sanglants délits. Voici pourquoi, enfin, nous anarchistes, voulons en premier lieu la destruction de la valeur monétaire. Par elle seule, l’égoïsme humain règne et avec lui tous les grands maux qui affligent l’humanité. Le pivot de votre système est l’or : l’or annihilé, votre système social inique est détruit.
« Je vous affirme donc, messieurs les juges, que la société ne pourra être heureuse, et je dirais presque parfaite que par l’application du communisme anarchiste; mais pour arriver à telle fin la propriété individuelle, sous quelque forme que ce soit, doit succomber.
« Tâche ardue, à la vérité, si nous considérons que l’égoïsme infiltré par votre système domine partout en souverain ; aussi serait-ce temps perdu que de vouloir persuader le bourgeois d’accepter le communisme. Non ; le bourgeois le sait bien que nous avons raison, mais tant qu’il restera une loi et une baïonnette pour le défendre, il tiendra bon, et les anarchistes savent parfaitement qu’il ne cédera qu’à la violence. Par la violence donc, nous poussons les masses à s’emparer consciemment de tout ce qui leur appartient. Mais, pour que l’action puisse avoir un résultat heureux, il est nécessaire que le peuple distingue ses vrais amis des faux; il est nécessaire de lui faire connaître les exemples du passé et de lui montrer qu’une révolution, pour être profitable, ne doit pas avoir pour objet un simple changement d’hommes au pouvoir ou la formation d’un gouvernement provisoire, mais avoir pour unique but la destruction de toute autorité, l’appropriation de toutes les richesses sociales au bénéfice de tous et non de la classe qui voudra les administrer et l’opposition absolue par la violence à l’établissement de quelque pouvoir que ce soit.
« Beaucoup l’ont compris, mais les moyens pour une plus ample propagande manquaient; impossible de nous les procurer autrement que par ce que vous appelez effrontément le voly et c’est pourquoi je me suis résolu à attaquer directement la propriété conventionnelle du gros richard.
« Nous, anarchistes, c’est avec l’entière conscience d’accomplir un devoir que nous attaquons la propriété, à un double point de vue : l’un pour affirmer à nous-mêmes le droit naturel à l’existence, que vous, bourgeois, concédez aux bêtes et niez à l’homme ; le second, pour nous fournir le matériel propre à détruire votre baraque et, le cas échéant, vous avec elle.
« Cette manière de raisonner vous fait dresser les cheveux sur la tête, mais que voulez-vous ? C’est ainsi, et les temps nouveaux sont venus.
« Autrefois le meurt-de-faim qui s’appropriait un pain, traduit devant vos pléthoreuses personnes, s’excusait, demandait pardon, reconnaissait avoir commis un délit, promettait de mourir de faim lui et sa famille plutôt que de toucher une seconde fois à la propriété d’autrui et avait honte de montrer sa figure. Aujourd’hui, c’est bien différent; les extrêmes se touchent et l’homme, après être tombé si bas, se relève : traduit devant vous pour avoir fracturé les coffres-forts de vos compères, il n’excuse pas son acte, mais le défend, vous prouve avec fierté qu’il a cédé au besoin naturel de reprendre ce qui lui avait été précédemment volé : il vous prouve que son acte est supérieur en morale à toutes vos lois, qu’il se moque de vos cris et de votre autorité et, malgré vos accusations, vous prouve que les voleurs, ô messieurs les juges ! sont vous et votre bande bourgeoise.
« C’est justement mon cas. Soyez-en certains, je ne rougis pas de vos accusations, et j’éprouve un doux plaisir à être appelé voleur par vous. »
Après une plaidoirie de ce genre, l’éloquence de MeLabori devait s’employer en vain. Pini fut condamné à vingt ans de travaux forcés.
Ce que Pini n’a point raconté, ce qu’il ne pouvait raconter, ce que nous raconterons, nous, sur la foi de renseignements et de documents certains – c’est l’homme.
On a exploité Pini, on a raconté sur lui des fables qui sont des légendes, des calomnies ou des niaiseries. Le grand estampeur anarchiste de la presse bourgeoise, Henry Dupont -lequel tient d’ailleurs d’aussi loin à la presse, qu’il ignore, qu’à l’anarchie dont il est écarté – a colporté dans les feuilles du matin les plus extraordinaires mensonges sur Pini et sur ses aventures. A l’entendre, à l’imprimer et à le payer, Pini aurait habité la Belgique – faux ! -, serait végétarien -faux ! -, ne boirait que de l’eau -faux !-, et, après une évasion purement imaginaire dont l’estampeur raconte, contre espèces, les diverses péripéties, il habiterait en ce moment une cité de la Virginie où il fabriquerait, avec des capitaux anglais, une lampe de son invention. Tous les journaux où cet estampeur a colporté sa copie fallacieuse nous ont montré un Pini apocryphe, une sorte de type à côté qui ne ressemble en rien à l’original. Au surplus, Dupont n’a point connu Pini.
Pini, c’est l’honnête homme, travailleur, intègre, laborieux, devenu criminel par conviction socialiste et dans des conditions de désintéressement qu’un ascète lui envierait.
Il a volé, souvent, beaucoup, sans aucun profit personnel. Une seule fois il a mis de l’argent volé dans une affaire, et c’était en vue de réaliser des bénéfices destinés par avance à la propagande anarchiste.
A Paris, il vivait de peu, même quand son vol de la veille avait rempli ses poches de louis. Typographe de métier, il lui arrivait de quitter sa casse pour traverser la rue, acheter chez un boucher un morceau d’une viande qu’il mangeait crue, sans épices et sans condiments. Jamais il ne lui arriva de boire plus qu’une chopine à chacun de ses repas. Jamais il ne fit la noce.
C’était d’ailleurs un ouvrier modèle, merveilleusement exact à sa besogne, tempérant sa haine instinctive des patrons par une timidité à l’égard du « singe » absent, par une souple discipline dans le service.
Comme Ravachol, il se montrait généreux et doux. Il donnait toujours aux pauvres, non sans leur reprocher de tendre la main : « Perché qué tou demandes pisque tou peux vouler?»
Il donnait, prélevant parfois sur son maigre salaire, la part, le sou des plus pauvres.
Jamais il ne fit l’aumône avec le produit de ses vols. L’argent volé appartenait à la propagande, à l’idée, à l’avenir. Le rêveur qui était dans Pini se plaisait à penser qu’avec l’or de la bourgeoisie il préparait une évolution sociale salutaire aux masses.
Il arriva devant le jury les mains nettes. Aucun de ses vols ne lui avait profité. Nous pourrions citer les publications françaises et italiennes qu’il a soutenues avec les capitaux arrachés nocturnement à la bourgeoisie. Deux feuilles anarchistes italiennes ont été fondées par lui : elles vivent encore ; elles ont assez d’abonnés, d’acheteurs au numéro pour vivre longtemps. La plupart des placards anarchistes affichés en Italie depuis les premiers jours de 1888 jusqu’à la condamnation de Pini – c’est-à-dire pendant dix-huit mois- ont été rédigés par lui, imprimés et publiés à ses frais. Allons plus loin : son or volé a subventionné des organes révolutionnaires français.
Il disait volontiers à un anarchiste de marque : «Tou as bisoin de cinq cents lires per fare della propaganda… Attends uno poco mercredi prochain, mercoledì, zé t’apporterai la soumme ! »
Et il l’apportait.
D’où venait-elle? Qui Pini avait-il dévalisé? Il ne le disait point et on ne le lui demandait jamais.
Parfois il traversait Paris, sans bottes, presque pieds nus, à peine vêtu l’hiver, pour aller porter quelques sous à des compagnons malheureux. Il leur distribuait un franc, deux francs mais il n’entamait pas pour eux le capital de deux ou trois cents louis, solde de sa dernière expédition.
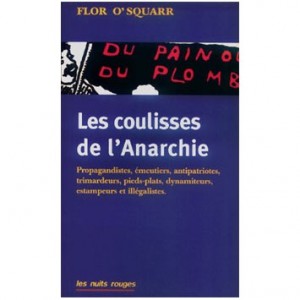 En ses jours de misère, alors qu’aucun camarade n’avait pu lui donner l’hospitalité, il s’allait coucher dans un galetas proche les étangs de la Glacière où l’on passe une nuit pour deux sous sur de la paille dite « plume de Beauce», et où les loqueteux peuvent se rhabiller des pieds à la tête aux conditions suivantes :
En ses jours de misère, alors qu’aucun camarade n’avait pu lui donner l’hospitalité, il s’allait coucher dans un galetas proche les étangs de la Glacière où l’on passe une nuit pour deux sous sur de la paille dite « plume de Beauce», et où les loqueteux peuvent se rhabiller des pieds à la tête aux conditions suivantes :
Paletot 1,85
Pantalon 0,80
Gilet 0,30
Chapeau 0,20
Souliers 0,60
Chemise 0,85
Chaussettes 0,10
Total 4,70 f
Rarement il y ravitaillait sa garde-robe. Grâce à son travail -lequel consistait le plus souvent en «bricoles» – il eut presque constamment de quoi se nourrir et se vêtir.
Quelques-uns de ses compagnons l’exploitèrent. On lui disait : «Dis donc, Pini tu n’aurais pas cent francs disponibles?… C’est pour crever un mouchard. »
Pini donnait les cent francs, et l’anarchiste, sans remords d’avoir estampé un frère, dépensait ce capital en petites orgies dans les gargotes de la barrière.
Il avait des idées. Son projet le plus curieux est assurément celui qui consistait à «exproprier» notre saint-père le pape. Oui. A la lettre. Pini a voulu «refaire» le denier de Saint-Pierre ; il avait rêvé de déménager le Vatican comme il dévalisait une villa des environs de Paris -et ce plan reçut un commencement d’exécution. Ce n’était pas au Vatican que l’anarchiste avait songé tout d’abord, mais aux couvents situés dans Paris et aux petites communautés suburbaines.
Doué d’un aplomb imperturbable, un jour il se présente chez des religieuses réunies à Montmartre, en leur racontant qu’il était le fils légitime de Son Eminence monsignor le cardinal Pini, lequel en effet n’entra dans les ordres qu’après la mort de sa femme. Son accent italien, les renseignements qu’il prodiguait sur la Ville éternelle et sur le monde de la prélature, achevèrent de convaincre ces bonnes femmes, très flattées de recevoir le fils d’un prince de l’Eglise. L’anarchiste sut d’ailleurs les magnétiser en leur remettant une somme de cinquante francs destinée à être distribuée en aumônes et qu’il avait volée la nuit précédente, avec d’autre argent bourgeois et impur, chez un marchand de toiles peintes de la rue de Cléry!
Pini les honora de deux visites, puis disparut. Le fils de Son Eminence avait constaté que «il n’y avait rien à faire» chez ces femmes. Il tourna ses regards vers l’archevêché, sollicita une audience du cardinal-archevêque, l’obtint, s’en fut pousser une reconnaissance dans le palais de la rue de Grenelle. Cette fois encore il renonça, l’entreprise présentant vraiment trop de difficultés.
Alors il songea au Vatican, et nous pouvons affirmer que l’affaire fut sérieusement étudiée par un groupe d’anarchistes romains en correspondance constante avec le pseudo-fils du cardinal.
Pini a réellement dérobé des sommes considérables. A-t-il pu -comme on l’a raconté- cacher une partie de cet argent en lieu sûr? Cela est fort possible. Mais il est beaucoup plus vraisemblable que les capitaux volés dont il disposait au moment de son arrestation ont été affectés à ce qu’il appelait sa «grande affaire».
En dépit des journaux les mieux informés de Paris, Pini n’a inventé aucune lampe à l’usage des mineurs. Un de ses amis a inventé un avertisseur automatique destiné à indiquer dans les charbonnages l’intensité du grisou. En fait, avec cet appareil, les explosions de feu de grisou deviennent absolument impossibles.
L’inventeur manquant des ressources nécessaires à la construction de son modèle, Pini s’empressa de le commanditer avec de l’argent volé. L’appareil fut construit, figura à l’Exposition universelle de Paris en 1889, et valut une médaille de bronze à l’inventeur.
Mais il ne suffisait point de construire et d’exposer l’avertisseur automatique ; il fallait l’exploiter. Inventeur et bailleur de fonds passèrent un traité en bonne forme, et l’associé de Pini s’en fut à Londres recruter de nouveaux commanditaires. Cinq capitalistes anglais (un à Londres, un à Birmingham, trois à Manchester) fondèrent une association pour l’exploitation de cette découverte et d’autres découvertes encore dont ils admirèrent les dessins et payèrent les brevets. Pini se trouva donc introduit dans les affaires, comme un bourgeois, avec la perspective de recevoir des jetons de présence et de toucher une forte part dans les bénéfices.
Son excuse à ses propres yeux fut dans la ferme résolution de consacrer le produit de cette opération industrielle à la propagande anarchiste.
Il eut d’ailleurs à se féliciter d’avoir, une fois au moins, joué le rôle d’un capitaliste, car ce fut la Société anglaise pour l’exploitation de l’avertisseur automatique qui organisa et paya son évasion.
Cette évasion de Pini a donné lieu aux récits les plus fantaisistes.
Dès après l’arrestation de Ravachol, les estampeurs anarchistes répandirent à travers les journaux cette nouvelle à sensation : que Pini avait réussi à s’évader de Cayenne, qu’il venait d’arriver à Paris pour y procéder à une série d’explosions. Un estampeur poussa l’aplomb jusqu’à affirmer qu’il quittait l’Italien et avait eu avec lui un entretien de deux heures.
Le gouvernement tenta d’arrêter dans son vol ce canard révolutionnaire en publiant une dépêche télégraphique datée de Cayenne affirmant la présence du condamné à l’infirmerie des îles du Salut. Mal lui en prit. Un rédacteur de la Marseillaise, Jules Pianelli, démontra immédiatement que l’état de nos relations télégraphiques avec la Guyane rendait toute communication impossible dans les délais indiqués par le ministère de l’Intérieur.
Cet argument ne tranchait pas la question. Pini se trouvait-il encore à Cayenne ou s’en était-il échappé? Au cas d’une évasion, vivait-il en Europe ou en Amérique, à New York, à Londres ou à Paris? Pendant huit jours, le grand et le petit reportage se confondirent en hypothèses. Nous eûmes la question Pini comme nous avions eu la question du chat et la question du malheureux Bulgare. Puis, comme la série des explosions semblait fermée, comme Paris reprenait sa quiétude, il ne fut plus question de l’anarchiste italien.
En réalité, Pini est à Cayenne, malade, à l’infirmerie des îles du Salut. L’agence Havas ne nous avait point trompés.
Il n’a pu s’évader avec les frères Schouppe, pour deux raisons : d’abord parce que les trois co-condamnés de 1889 -Pini et les frères Schouppe- furent séparés, par ordre, dès leur arrivée à Cayenne et ne s’y rencontrèrent jamais; ensuite parce que Schouppe aîné est décédé à l’établissement du Maroni trois mois avant la tentative d’évasion qui réussit à son frère cadet.
Pini tenta de s’évader. Un chalutier hollandais nolisé dans un port de la Guyane hollandaise par les soins de la Société anglaise pour l’exploitation de l’avertisseur automatique -laquelle société paya les frais de l’expédition – réussit à embarquer Pini devant Cayenne et mit la voile dans la direction des possessions néerlandaises. Une erreur du capitaine – était-ce bien une erreur?- amena le débarquement du fugitif sur une grève de la côte française où il fut reconnu, pourchassé, traqué, blessé à la jambe par un gendarme et rendu au bagne.
On ne put s’en emparer que blessé, comme à Paris on n’avait pu l’arrêter qu’en le prenant au lasso, à la manière de Buffalo Bill.
Tout récemment encore, lorsque Parmeggiani vint se faire arrêter à Paris, on raconta que cet anarchiste avait, de complicité avec Pini, assassiné le journaliste socialiste Ceretti en Italie. Le renseignement était faux : Ceretti se porte comme le Pont-Neuf. Pini, qu’il avait qualifié de mouchard, fit en effet le voyage de Paris à Turin pour aller le poignarder ; mais, une fois arrivé, il se contenta de lui appliquer une verte correction. Parmeggiani l’accompagnait en effet.
« Il mé faut un coupain por l’exécouter ! », lui avait dit Pini.
Assurément, celui-ci n’est pas un voleur ordinaire. Il est vraiment un théoricien descendu dans la pratique, un voleur politique et social. Chargé de butin, les poches lourdes d’or, il n’a jamais dépensé plus de trois francs par jour pour sa vie matérielle et a pu affirmer sans mensonge aux douze «potirons» qui l’ont condamné qu’il n’avait volé que pour l’idée.
Tags: bagne, Flor O Squar, illégalisme, les coulisses de l'anarchie, Les Nuits Rouges, Milan, Paris, Parmeggiani, Pini, Schouppe, Vatican, voleur
 Imprimer cet article
Imprimer cet article
 Envoyer par mail
Envoyer par mail

