Dix questions à … Jean-Lucien Sanchez
 Jean-Lucien Sanchez travaille sur l’histoire pénale et coloniale de la Troisième République. Avec A perpétuité, sorti en 2013 chez Vendémiaire, il vous invite à un voyage de 384 pages dont on ne revient pas forcément indemne. Vous rencontrerez les quelques 17000 incorrigibles de la petite délinquance que la loi du 27 mai 1885 promettait à une disparition rapide et certaine sous le sunlight des tropiques de la France ultramarine. Vous côtoierez le bas-fond des bas-fonds, le monde des pieds-de-biche. Vous sentirez sur vous l’odeur des corps anémiés et meurtris par la faim, la chaleur, les maladies, les coups, le travail forcé. Vous sentirez, vous approcherez, vous toucherez, vous verrez cette œuvre d’exclusion et de mort légale que fut la relégation. « C’était l’oubliette de la République, le réceptacle de toutes les misères sociales, le résidu des ‘hommes tarés’ » écrit Dominique Kalifa dans son compte-rendu pour le journal Libération en date du 06 février 2013. On peut y rajouter aussi les femmes, même si elles ne furent que 509 entre 1887 et 1905 à échouer dans la colonie pénitentiaire. Point de voyeurisme pourtant dans cette étude au style simple, limpide, clair, mais une histoire sombre et oubliée qui, à n’en pas douter, fera date dans la connaissance des bagnes de Guyane. Car la relégue n’avait jamais été à ce point aussi bien révélée. L’auteur raconte des vies perdues comme celles d’Henry Marty et de Philippe Martinez dont les souvenirs qu’il a préfacés ont paru aux éditions Albache en 2011. C’est peu dire que nous vous conseillons fortement la lecture de ces deux livres de Jean-Lucien Sanchez qui a bien voulu répondre ici à quelques-unes de nos questions.
Jean-Lucien Sanchez travaille sur l’histoire pénale et coloniale de la Troisième République. Avec A perpétuité, sorti en 2013 chez Vendémiaire, il vous invite à un voyage de 384 pages dont on ne revient pas forcément indemne. Vous rencontrerez les quelques 17000 incorrigibles de la petite délinquance que la loi du 27 mai 1885 promettait à une disparition rapide et certaine sous le sunlight des tropiques de la France ultramarine. Vous côtoierez le bas-fond des bas-fonds, le monde des pieds-de-biche. Vous sentirez sur vous l’odeur des corps anémiés et meurtris par la faim, la chaleur, les maladies, les coups, le travail forcé. Vous sentirez, vous approcherez, vous toucherez, vous verrez cette œuvre d’exclusion et de mort légale que fut la relégation. « C’était l’oubliette de la République, le réceptacle de toutes les misères sociales, le résidu des ‘hommes tarés’ » écrit Dominique Kalifa dans son compte-rendu pour le journal Libération en date du 06 février 2013. On peut y rajouter aussi les femmes, même si elles ne furent que 509 entre 1887 et 1905 à échouer dans la colonie pénitentiaire. Point de voyeurisme pourtant dans cette étude au style simple, limpide, clair, mais une histoire sombre et oubliée qui, à n’en pas douter, fera date dans la connaissance des bagnes de Guyane. Car la relégue n’avait jamais été à ce point aussi bien révélée. L’auteur raconte des vies perdues comme celles d’Henry Marty et de Philippe Martinez dont les souvenirs qu’il a préfacés ont paru aux éditions Albache en 2011. C’est peu dire que nous vous conseillons fortement la lecture de ces deux livres de Jean-Lucien Sanchez qui a bien voulu répondre ici à quelques-unes de nos questions.
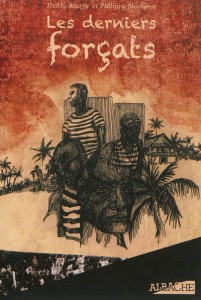 1) Tu es l’auteur d’un ouvrage important sur la relégation. Qu’est-ce qui t’as poussé à écrire À perpétuité ? Tu as aussi longuement préfacé en 2011 le livre Les derniers forçats chez les éditions Albache. En quoi les souvenirs d’Henry Marty et de Philippe Martinez t’ont-ils paru fondamentaux ?
1) Tu es l’auteur d’un ouvrage important sur la relégation. Qu’est-ce qui t’as poussé à écrire À perpétuité ? Tu as aussi longuement préfacé en 2011 le livre Les derniers forçats chez les éditions Albache. En quoi les souvenirs d’Henry Marty et de Philippe Martinez t’ont-ils paru fondamentaux ?
Tout d’abord, merci pour cet accueil sur ton site. À perpétuité. Relégués au bagne de Guyane (Vendémiaire, 2013) est tiré de ma thèse d’histoire que j’ai soutenue à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales en 2009, sous la direction de Gérard Noiriel. Il s’agit de l’adaptation de la deuxième partie de mon doctorat (qui en compte deux). L’écriture de cet ouvrage m’apparaissait essentiel pour permettre à un large public d’accéder à cette histoire si singulière, plutôt que de la cantonner, en l’état, à la seule disposition du public universitaire.
Quant à la préface du livre Les derniers forçats, je l’ai rédigée sur la proposition de Marine Coquet. Historienne du bagne colonial de Guyane, Marine prépare un doctorat d’histoire consacré à la commune pénitentiaire de Saint-Laurent du Maroni à l’EHESS, un travail qui s’annonce très prometteur. Marine m’a fait l’honneur et l’amitié de me demander de préfacer cet ouvrage qui repose sur les témoignages inédits de deux forçats moribonds, attendant que la mort les emporte au sein de l’hôpital André-Bouron de Saint-Laurent. Ces témoignages ont été découverts par Frank Sénateur, autre historien et collectionneur passionné du bagne, aux archives du Conservatoire national des arts et métiers. Ces écrits me semblent essentiels parce qu’ils restituent au plus près les expériences sensibles de ces deux bagnards, sans que les moulinettes d’un éditeur en mal de sensationnel ou de l’administration pénitentiaire ne soient intervenues. C’est ce qui constitue leur rareté et leur intérêt. Ces anciens forçats n’ont effectivement plus rien à perdre : en fin de vie, ils n’ont à craindre ni la censure de l’administration pénitentiaire (le bagne est fermé au moment où ils écrivent), ni le chiffre des ventes de leur éditeur. De ce fait, ils peuvent laisser libre cours à leur plume, sans respecter un quelconque cadre. D’où la nécessité, pour leur compréhension, de présenter leur contexte d’écriture ainsi que les trajectoires de ces deux auteurs que j’ai pu restituer en consultant, notamment, leurs dossiers individuels conservés aux Archives nationales d’outre-mer.
 2) Qu’est-ce que la relégation ? Un portrait type du relégué est-il possible ?
2) Qu’est-ce que la relégation ? Un portrait type du relégué est-il possible ?
La relégation est organisée par la loi sur la relégation des récidivistes du 27 mai 1885. Elle consiste en un internement perpétuel sur le sol d’une colonie de condamnés récidivistes. Près de 22 163 individus furent frappés par ce dispositif : 3 800 hommes et 470 femmes en Nouvelle-Calédonie de 1887 à 1897 et 17 375 hommes et 519 femmes en Guyane de 1887 à 1953. Cette loi aménage une « présomption irréfragable d’incorrigibilité » censée démontrer positivement le caractère « incorrigible » d’un condamné récidiviste. Son article 4 aménage ainsi plusieurs combinaisons de peines qui, si elles sont toutes inscrites au casier judiciaire d’un prévenu ou d’un accusé récidiviste, entraînent le prononcé obligatoire pour le magistrat de la peine de la relégation. Il ne s’agit donc pas d’une peine principale, mais d’une peine accessoire qui s’ajoute à une peine principale. Par exemple, un prévenu, condamné en l’espace de dix ans à trois délits de plus de trois mois de prison ferme pour vol simple, escroquerie ou vagabondage, se présente de nouveau devant un tribunal pour un délit prévu par la loi. Si le magistrat le condamne à plus de trois de prison ferme, il doit concurremment le condamner à la relégation. Il s’agit d’une mesure prise contre des condamnés regardés comme « dangereux ». Cette dangerosité se matérialise par le caractère récidivant de leurs infractions. Le législateur considère à l’époque que la pénalité classique, c’est-à-dire l’emprisonnement, n’est plus d’aucune efficacité pour s’assurer d’une certaine frange de la délinquance. Au lieu de « corriger » ceux qu’on lui confie, la prison ne cesse au contraire de produire de la récidive, donc des « incorrigibles ». La relégation, mesure pénale spécialement adaptée à cette nouvelle lecture de la criminalité, se substitue donc à la prison en éliminant socialement des récidivistes estimés « dangereux ».
En retour, la loi projette leur réinsertion sur le sol de la colonie en leur permettant d’y devenir colons. Pour ce faire, elle aménage un régime dual qui repose sur une distinction censitaire : les relégués qui bénéficient de bons antécédents en détention et qui disposent de moyens financiers suffisants pour se prendre en charge sur le sol de la colonie sont classés au régime de la relégation individuelle. Ils sont libres de contracter des engagements de travail auprès de particuliers, d’entreprises ou de services publics locaux ou peuvent s’installer en concession agricole ou industrielle. Libres de leurs faits et gestes (bien qu’ils soient pour l’immense majorité d’entre eux interdits de séjour dans une grande partie de la Guyane et cantonnés dans une zone très limitée, le territoire pénitentiaire du Maroni), ils n’ont pas le droit de quitter le sol de la Guyane et doivent répondre à deux appels annuels. Tous les autres, qui, trop pauvres pour pouvoir subvenir à leurs besoins (c’est-à-dire la quasi-totalité d’entre eux), sont classés au régime de la relégation collective. Les relégués collectifs sont internés au sein d’un dépôt de travail (le camp de Saint-Jean du Maroni et ses camps annexes) et doivent travailler pour le compte de l’État qui pourvoie en retour à leur entretien. Ils sont donc soumis à des travaux forcés effectués au sein d’un camp qui s’apparente, dans les faits, à un véritable pénitencier où ils sont encadrés par des agents de l’administration pénitentiaire. Ce régime, qui visait initialement à les habituer au labeur colonial et à leur permettre d’accumuler de l’argent sur leur pécule, s’apparente en définitive à une condamnation aux travaux forcés à perpétuité. Le traitement des relégués en Guyane est ainsi très proche de celui de transportés, condamnés aux travaux forcés en vertu de la loi du 30 mai 1854 sur l’exécution de la peine des travaux forcés. À cette différence près que les relégués ont déjà purgé leur peine principale sur le sol métropolitain ou de leurs colonies d’origines : la relégation représente ainsi une grave atteinte au principe de proportionnalité de la peine au délit.
Cette mesure a essentiellement frappé des délinquants récidivistes. Près de 83 % des condamnations à la relégation sont prononcées par des tribunaux correctionnels (essentiellement à Paris et en région parisienne, ainsi qu’en Algérie) contre des individus coupables de vol simple, de vagabondage et de rupture de ban d’interdiction de séjour. Le portrait-type d’un relégué est celui d’un journalier agricole, d’un ouvrier au chômage ou d’un vagabond désocialisé. Cette loi, d’une sévérité extrême, s’attaque ainsi aux classes les plus pauvres de la société et cherche à les éliminer pour en débarrasser les grands centres urbains.
 3) La loi de 1885 procède-t-elle d’une volonté d’éloignement, d’élimination du multirécidiviste ou plutôt correspond-elle à une manœuvre électorale dans un climat supposé d’insécurité à la fin du XIXe siècle ?
3) La loi de 1885 procède-t-elle d’une volonté d’éloignement, d’élimination du multirécidiviste ou plutôt correspond-elle à une manœuvre électorale dans un climat supposé d’insécurité à la fin du XIXe siècle ?
Je dirais les deux. Le but de cette loi est bien d’éliminer socialement des petits délinquants récidivistes pour en débarrasser définitivement le sol de la métropole et les oublier sur celui d’une colonie. Néanmoins, le contexte d’élaboration de cette loi a une incidence déterminante dans ce résultat aberrant. Un nouveau paradigme pénal émerge à la fin du XIXe en France qui distingue désormais les criminels et les délinquants en deux entités distinctes : les délinquants et les criminels primaires ou d’occasion, ceux qui en sont à leur première infraction, et les délinquants et les criminels dits « incorrigibles », ceux qui récidivent. Ce constat dérive de l’analyse que font différents experts (magistrats et criminologues) de la lecture du Compte général de l’administration de la justice criminelle en France. Cette statistique ne cesse de mettre en exergue, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, une hausse croissante de la récidive délinquante. D’où l’idée qu’il existerait des criminels et des délinquants incorrigibles. Cette construction sociale du problème de la récidive est ensuite capté dans l’espace public par différents agents qui le signalent au personnel politique afin qu’il le résolve. De multiples pétitions pour l’instauration d’une loi sur la relégation des récidivistes affluent ainsi à la veille des élections législatives de 1881 et des comités républicains l’inscrivent dans leur programme électoral (notamment celui de Léon Gambetta, dans le XXe arrondissement de Paris, qui est à l’origine de cette loi). Devenue promesse politique, la relégation entre en débats au Parlement à partir de 1883, mais les discussions achoppent rapidement sur la difficulté d’application de cette mesure et, surtout, sur son inanité. Néanmoins, la presse s’est dans l’intervalle saisie de cet événement et l’a diffusé à une vaste échelle, étendant le spectre d’une inquiétude concentrée autrefois à une sphère d’experts. Pris dans une surenchère sécuritaire, les députés se précipitent dans le vote de cette loi à la veille des élections législatives de 1885. Aussi imparfaite soit-elle, ils préfèrent la voter dans la précipitation plutôt que d’être taxés de laxisme face une « menace » qui inquiète grandement leurs électeurs. Cet aspect de la relégation sera l’objet de mon prochain ouvrage.
 4) Dans la préface qu’il donne à ton livre, Marc Renneville souligne que l’imaginaire du bagne s’est nourri de la transportation plus que de la relégation et donne pour preuve le fait que l’on cite toujours des noms de transportés célèbres. Y aurait-il des non-personnages de mémoire comme il peut y avoir des non-lieux de mémoire ? Pourquoi cet « oublié » que fut le relégué a-t-il mauvaise presse ?
4) Dans la préface qu’il donne à ton livre, Marc Renneville souligne que l’imaginaire du bagne s’est nourri de la transportation plus que de la relégation et donne pour preuve le fait que l’on cite toujours des noms de transportés célèbres. Y aurait-il des non-personnages de mémoire comme il peut y avoir des non-lieux de mémoire ? Pourquoi cet « oublié » que fut le relégué a-t-il mauvaise presse ?
Marc Renneville, en fin connaisseur du bagne, a parfaitement saisi cette dissymétrie mémorielle entre relégués et transportés. Dans l’imaginaire collectif, le bagne de Guyane est étroitement associé à de grandes figures de forçats qui ont marqué les esprits par leurs ouvrages. C’est le cas notamment d’Henri Charrière, dit Papillon, ou de Paul Roussenq, de René Belbenoit, d’Eugène Dieudonné, etc. Il s’agit de transportés, condamnés par des cours d’assises aux travaux forcés, à la suite de procès qui ont défrayé la chronique. Ces criminels ont bien souvent passionné les lecteurs de l’époque grâce à la presse qui relataient leurs affaires et leur donnait un écho important. À l’inverse, les relégués sont de petits délinquants récidivistes sans grande envergure, condamnés par des tribunaux correctionnels pour de simples délits. Le potentiel de vente est alors bien moindre : quel intérêt pour la presse à grand tirage de traiter des cas de ces petits anonymes coupables de menus larcins ? De même, lorsque les journalistes se rendent en Guyane pour y conduire des enquêtes sur le bagne (en particulier les reporters de journaux à faits divers comme le Détective ou Police magazine à partir des années 1930), ils ne s’intéressent le plus souvent qu’aux transportés. Ce biais repose sur leur mode d’action et sur la mise en récit de leur reportage : ils sont à la recherche de « vedettes d’assises » dont le procès a eu un grand retentissement, permettant à leurs lecteurs d’être informés de la suite de l’histoire en quelque sorte. Là aussi, il y a peu de chance de retrouver un « grand criminel » parmi les relégués, rien de bien croustillant à se mettre sous la dent… Lorsque leur sort est évoqué dans des articles, ils sont présentés, pour la majorité d’entre eux, collectivement, comme une entité un peu abstraite, alors que les transportés peuvent être singularisés et présentés sous la forme de portraits, procédé bien plus accrocheur. D’autre part, les relégués ont laissé peu de souvenirs sur leur expérience carcérale, à l’inverse des transportés qui ont produit une grande quantité de témoignages. Beaucoup de relégués sont effectivement analphabètes et, ceux en capacité d’écrire, de quoi peuvent-ils témoigner ? Un coupable d’assassinat, clamant son innocence et luttant contre l’arbitraire du bagne, offre une expérience émotionnelle pour le lecteur sans équivalent avec celle d’un relégué, simple « voleur de poule ». Ce dernier est forcément coupable, alors que le doute demeure pour un « grand criminel », et une empathie peut alors s’exercer.
 5) Comment la Guyane s’est-elle justement accommodée de la relégation ? Quels furent les rapports entre relégués et transportés ?
5) Comment la Guyane s’est-elle justement accommodée de la relégation ? Quels furent les rapports entre relégués et transportés ?
La Guyane, alors colonie de l’empire français, n’a pas eu son mot à dire. Tout comme les transportés à partir de 1852, elle s’est vu intimer l’ordre de recevoir tous les relégués de sa métropole. Mais les protestations d’habitants de la Guyane, en particulier celles du Conseil général et du maire de Cayenne de l’époque, Achille Houry (relayées par un commissaire du gouvernement, Jules Leveillé, envoyé sur place pour juger du succès de cette mesure avant son vote final au Parlement), ont entraîné une réaction du Sénat. Lors de l’examen du texte de la loi sur la relégation en première lecture, l’Assemblée nationale avait décidé de laisser les relégués libres de leurs faits et gestes en Guyane. Dans l’esprit des députés, les relégués auraient effectivement purgé leur peine principale avant d’arriver sur le sol de la colonie, et il était donc parfaitement injuste de les astreindre à une seconde peine. Mais le Sénat, sensibilisé aux protestations des Guyanais légitimement émus de devoir accueillir les « incorrigibles » de la métropole et du reste de son empire colonial, décide de modifier le texte dans un sens beaucoup plus restrictif, en créant le régime dual décrit plus haut : relégation individuelle et relégation collective. Par la suite, un décret d’application élaboré au ministère de l’Intérieur entérine cette orientation : les relégués seront concentrés sur le territoire pénitentiaire du Maroni, afin de les maintenir à l’écart de Cayenne et de sa banlieue. En procédant ainsi, le gouvernement évite aux Guyanais une cohabitation forcée avec les relégués, mais organise également leur isolement et, par là, la faillite programmée de la mise en œuvre locale de la loi. Les relégués sont effectivement installés dans la partie occidentale de la Guyane, celle réservée au bagne, où est concentré l’essentiel des installations pénitentiaires (les autres pénitenciers situés dans la partie orientale, exclusivement réservés aux transportés, sont de bien moindre importance). En outre, la majeure partie de ce territoire, créé par décret en 1860, est occupée par la ville de Saint-Laurent, qui accueille le principal pénitencier de la transportation. Les relégués, qui ne peuvent être confondus avec les transportés, sont donc installés dans la partie la plus reculée et la plus malsaine de ce territoire, à Saint-Jean. Cette double-relégation empêche alors ces hommes (et ces femmes jusqu’en 1905) de se mélanger à la population locale, comme l’avait projeté le législateur, et tue dans l’œuf le projet de colonisation par l’élément pénal porté par la loi.
Quant aux relations entre transportés et relégués, la plupart des documents qui en témoignent indiquent qu’elles ne sont guère chaleureuses. Les relégués sont considérés par leurs pairs transportés comme des petits voleurs sans envergure qui ne peuvent être confondus avec des bagnards, des « durs » dans l’argot du bagne. Les relégués sont frappés d’un stigmate au sein des sociétés carcérale et civile guyanaises où ils sont l’objet d’un rejet assez profond. La plupart des transportés ne les considèrent pas comme leurs égaux et, dans les multiples témoignages qu’ils ont laissés, tiennent à se distinguer d’eux. Ce biais se retrouve également au sein de la société civile locale. Les agents de l’administration pénitentiaire considèrent les relégués comme des petits vagabonds et voleurs, les énonçant dans leurs courriers officiels sous le vocable de « récidivistes », réservant le terme de « forçats » aux seuls transportés. La représentation qu’ils nourrissent à l’encontre des relégués recoupe celle véhiculée par la loi : ils sont considérés comme des « incorrigibles », censés persévérer dans leurs travers délinquants, alors que les transportés sont considérés, en règle générale, comme des criminels primaires. Ils ont certes commis un crime grave, mais ils n’en ont commis qu’un seul, tandis que les relégués sont des habitués du délit. Cette appréhension est également partagée par la société civile locale, en particulier par les principaux employeurs de la région du Maroni. Ces derniers préfèrent en règle générale recourir aux transportés, car ils associent les relégués à des voleurs récidivistes, ce qui les écarte de nombreux emplois et empêche leur intégration locale.
 6) Quelle différence y-a-t-il entre un relégué individuel et un relégué collectif ? Pourquoi les premiers furent-ils nettement moins nombreux que les seconds ?
6) Quelle différence y-a-t-il entre un relégué individuel et un relégué collectif ? Pourquoi les premiers furent-ils nettement moins nombreux que les seconds ?
Sans revenir sur ces deux régimes que j’ai déjà décrits plus haut, le faible octroi de la relégation individuelle durant toute la période d’application de la relégation en Guyane s’explique par plusieurs facteurs. En premier lieu, lors de l’arrivée du premier convoi de relégués en Guyane en juin 1887, rien n’est prêt pour les accueillir. Ils vont donc devoir construire dans l’urgence les infrastructures destinées à les abriter. Des paillotes sont rapidement érigées afin de parer au plus pressé. Mais l’usure due au climat et l’insalubrité de ces installations, couplée aux terribles épidémies qui sévissent à Saint-Jean, entraînent la reconstruction du village en un pénitencier. Des cases en briques et à armature en fer sont érigées et d’importants travaux d’assainissement sont entrepris (assèchement de marais, comblement et détournement de criques, aménagement des berges du fleuve, recul du manteau forestier, etc.). Ces travaux, s’ils permettent au camp de devenir plus salubre, nécessitent pour les réaliser un grand volant de main-d’œuvre. Les relégués sont ainsi tous maintenus au régime de la relégation collective, la relégation individuelle n’étant accordée qu’au compte-goutte. Dans un second temps, le ministère des Colonies donne des ordres à partir de la fin du XIXe siècle pour qu’un plus grand nombre de relégués soient admis à la relégation individuelle. Les relégués étant à la charge de son budget, le passage à l’individuelle lui permet d’effectuer de substantielles économies. Leur nombre atteint 826 en 1914 pour chuter brutalement, après la Première Guerre mondiale, à 400 individus, chiffre qui ne variera plus en moyenne jusqu’à la fin de l’application de la relégation en Guyane.
Si les autorités locales rechignent à accorder le bénéfice de la relégation individuelle à nombre de relégués (qui y ont pourtant légitimement droit), c’est parce que la plupart d’entre eux connaissent une situation dramatique à leur sortie du dépôt. Les relégués individuels sont pour la plupart frappés d’interdiction de séjour à Cayenne et dans sa périphérie. Ils sont donc obligés de demeurer sur le territoire pénitentiaire du Maroni où ils sont concurrencés par des transportés en cours de peine que l’administration pénitentiaire loue à des tarifs bien plus bas que ce qu’ils exigent aux quelques entreprises, particuliers et comptoirs commerciaux locaux. Ils sont également concurrencés par des transportés libérés et astreints au « doublage ». Ceux-ci, également pour la plupart interdits de séjour à Cayenne, sont tenus à leur libération de demeurer sur le sol de la colonie un temps équivalent à la durée de leur peine (ou à perpétuité s’ils ont été condamnés à huit ans ou plus de travaux forcés). Le placement à la relégation individuelle se transforme alors bien souvent pour ces hommes en une deuxième peine. Certains parviennent à s’engager dans des petits métiers peu rémunérateurs, en se faisant porteurs au marché ou dockers sur le port. Mais la plupart sombrent dans l’alcool et la misère ou en profitent pour s’évader. Beaucoup regagnent également le pénitencier. Enfin, rares sont ceux qui bénéficient d’une concession agricole, car les travaux sont assez durs et les rendements difficiles à obtenir.
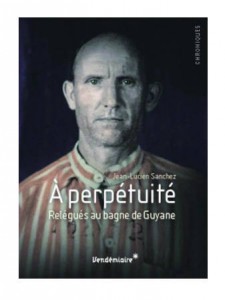 7) Dès le départ, tu signales pour la relégation des taux de mortalité effrayants et tu consacres même un chapitre à l’hécatombe de 1940 à 1944. De quoi meurt-on à Saint Jean du Maroni et dans les autres camps et chantiers de la relégation ?
7) Dès le départ, tu signales pour la relégation des taux de mortalité effrayants et tu consacres même un chapitre à l’hécatombe de 1940 à 1944. De quoi meurt-on à Saint Jean du Maroni et dans les autres camps et chantiers de la relégation ?
Dans les premières décennies d’installation du pénitencier, les relégués meurent en masse de paludisme, de fièvre jaune et de dysenterie, c’est-à-dire de maladies hydriques. Les moustiques pullulent du fait de la proximité de marécages et de la forêt équatoriale et entraînent de nombreuses épidémies. La dysenterie se propage du fait de l’absence d’adduction d’eau potable. De 1887 à 1918, la moyenne de vie d’un relégué européen dans la colonie ne dépasse pas ainsi six ans ! La situation va s’améliorer très progressivement, grâce aux importants travaux d’assainissement entrepris à Saint-Jean à partir des années 1890 jusqu’au début du XXe siècle. Néanmoins, la situation se détériore à nouveau lors des deux conflits mondiaux. Durant la Première Guerre mondiale, la métropole n’est plus en mesure d’approvisionner normalement en vivres et en matériel sa colonie (en particulier en médicaments et en habillement) et l’administration pénitentiaire reçoit l’ordre d’effectuer des économies. Le bagne n’étant jamais parvenu à être auto-suffisant sur le plan alimentaire, cette désorganisation entraîne un grand nombre de décès. La même situation se répète lors du Second Conflit mondial, mais dans des proportions dramatiques. Du fait d’un manque de vivres et de matériel, mais du fait également d’un régime disciplinaire considérablement durci, le taux de mortalité atteint un sommet : en 1942, près de 48 % de l’effectif des relégués meurt dans l’année.
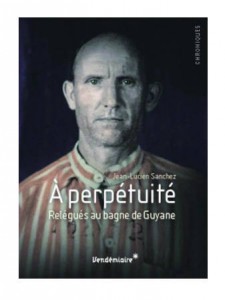 8 ) Peut-on alors comparer ces camps de travail français que furent ceux de Guyane aux goulags staliniens et aux camps de concentration nationaux-socialistes ?
8 ) Peut-on alors comparer ces camps de travail français que furent ceux de Guyane aux goulags staliniens et aux camps de concentration nationaux-socialistes ?
Je ne pense pas que l’on puisse mettre sur le même plan les camps de concentration staliniens ou nazis et les pénitenciers coloniaux guyanais. Pour reprendre la distinction effectué par Hanna Arendt, le bagne « ne bannit que d’une partie du monde vers une autre partie du monde, également habitée par des êtres humains ; il n’exclut pas totalement du monde des hommes.[1] » Le relégué est condamné par une décision judiciaire, à l’issue d’un procès contradictoire où ses droits sont assurés et garantis par le code pénal. Une fois au bagne, il demeure une personne juridique, en mesure d’opposer des droits qui lui sont là aussi assurés par une législation. Même si le bagne a conduit à la mort la majeure partie des forçats qui lui ont été livrés et que ceux-ci ont été victimes d’un système brutal et arbitraire, on ne peut pas confondre cette expérience avec celles conduites au cours du XXe siècle par les régimes totalitaires. Les forçats ne se résument pas à un bios pur, au sens où l’entend Giorgio Agamben, qui réduit un individu à sa simple « vie nue », ne disposant plus d’aucun droit, ni garantie assurés par son État. L’arbitraire administratif et la volonté d’extermination qui caractérisent les systèmes concentrationnaires totalitaires ne sont en rien comparables avec le projet politique porté par le bagne colonial qui devait, pour mémoire, permettre l’éclosion d’une colonie de peuplement, où forçats et population libre devaient fonder une société, à l’instar du modèle australien conduit par la Grande-Bretagne. Ce qui néanmoins relie ces deux modèles, à mon sens, est le recours au travail forcé, mais la similitude s’arrête là.
[1] Hanna Arendt, Les origines du totalitarisme. III. Le totalitarisme, Paris, Gallimard, 2002, p. 791.
 9) Le dernier chapitre de ton livre est consacré à la « liquidation de l’erreur » relégation. Le constat d’échec était-il évident dès le départ ? Pourquoi cette liquidation fut-elle aussi lente ? Que sont devenus les derniers relégués ?
9) Le dernier chapitre de ton livre est consacré à la « liquidation de l’erreur » relégation. Le constat d’échec était-il évident dès le départ ? Pourquoi cette liquidation fut-elle aussi lente ? Que sont devenus les derniers relégués ?
À partir des années 1930, le bagne est une institution en sursis, le constat de son échec étant acquis. Son coût et son incapacité à s’auto-suffire lui sont effectivement fatals. D’autre part, à la suite d’un reportage conduit par le journaliste Albert Londres au bagne de Guyane pour le compte du Petit Parisien à partir de 1923, l’opinion publique est alertée de la faillite de cette institution. En 1933, l’Armée du Salut s’installe en Guyane pour venir en aide aux forçats libérés et organiser leur rapatriement. En parallèle, les salutistes, par la voix de Charles Péan, militent en métropole pour l’abolition du bagne. Ce combat est également relayé par le jeune député de la Guyane, Gaston Monnerville, qui parvient, in extremis, à obtenir la signature d’un décret-loi en 1938 qui abolit la transportation en Guyane. Cette histoire est bien connue aujourd’hui grâce aux travaux de Danielle Donet-Vincent, qui a consacré deux ouvrages fondamentaux sur ce processus d’abolition[1].
Néanmoins, si elle est acquise pour les transportés, elle ne l’est pas pour les relégués : la relégation continue toujours, après 1938, à être exécutée en Guyane. Les autorités, rencontrant des difficultés à installer les transportés sur le sol de la métropole, ne parviennent pas à libérer suffisamment de places en établissements pénitentiaires pour les relégués. Ces derniers continuent donc à d’être expédiés en Guyane. Ce n’est qu’en 1946 que la décision est prise de ne plus les y envoyer. Par la suite, l’administration pénitentiaire, assistée par l’Armée du Salut, organise leur rapatriement jusqu’au dernier convoi, au mois d’août 1953. La plupart des relégués, trop âgés et trop usés par le bagne, finiront leurs jours à l’asile de Radepont, tenu par l’Armée du Salut, qu’ analysé en détail l’historien Jean-Claude Vimont[2]. Mais même s’ils ne prennent plus la route du bagne, la relégation n’est pas pour autant abolie. Alors que la peine des travaux forcés, donc la transportation, est abolie en 1964, la relégation ne prend fin qu’en 1970. Mais pour être remplacée par une tutelle pénale des multirécidivistes qui ne sera abolie à son tour qu’en 1981.
[1] Danielle Donet-Vincent, La fin du bagne, Rennes, Éditions Ouest-France, 1992 et Danielle Donet-Vincent, De soleil et silences : histoire des bagnes de Guyane, Paris, La Boutique de l’Histoire, 2003.
[2] Jean-Claude Vimont, « Les récidivistes et l’Armée du Salut (1952-1970) : L’assistance par le travail au château de Radepont (Eure) », Criminocorpus [En ligne], Varia, mis en ligne le 04 juillet 2012, consulté le 01 janvier 2014. URL : http://criminocorpus.revues.org/2016 ; DOI : 10.4000/criminocorpus.2016
 10) Dans ta riche bibliographie, tu ne mentionnes ni l’ouvrage du docteur Rousseau, Un médecin au bagne, ni les Écrits d’Alexandre Jacob qui ne fut ni Arsène Lupin et encore moins Chéri Bibi. Pourquoi ? Penses-tu d’ailleurs que le voleur anarchiste ait pu inspirer Maurice Leblanc ?
10) Dans ta riche bibliographie, tu ne mentionnes ni l’ouvrage du docteur Rousseau, Un médecin au bagne, ni les Écrits d’Alexandre Jacob qui ne fut ni Arsène Lupin et encore moins Chéri Bibi. Pourquoi ? Penses-tu d’ailleurs que le voleur anarchiste ait pu inspirer Maurice Leblanc ?
Effectivement, si ces ouvrages n’apparaissent pas dans ma bibliographie, c’est qu’il m’a fallu effectuer une sélection, ma bibliographie ne pouvant être exhaustive. Quant à l’influence qu’aurait pu opérer Alexandre Jacob sur Maurice Leblanc, je n’ai malheureusement pas de réponse. Mais je pense que Colombe de Dieuleveult, qui est l’auteure d’une thèse sur Alexandre Jacob, serait bien plus compétente que moi pour t’éclairer sur ce point[1].
[1] Colombe de Dieuleveult, « Alexandre Jacob, forçat anarchiste en Guyane : politique ou droit commun ? », Criminocorpus [En ligne], Justice et détention politique, Le régime spécifique de la détention politique, mis en ligne le 27 mars 2013, consulté le 02 janvier 2014. URL : http://criminocorpus.revues.org/2410
Tags: A perpétuité, Albache, Albert Londres, bagne, camp, chantier forestier, Colombe de Dieuleveult, délinquance, Dominique Kalifa, Frank Sénateur, Gaston Monerville, Guyane, Henry Marty, incorrigible, Jean-Lucien Sanchez, Les derniers forçats, libération, loi du 27 mai 1885, multirécidiviste, Péans, Philippe Martinez, relégation, Saint Jean du Maroni, Saint Laurent du Maroni, transportation, Vendémiaire
 Imprimer cet article
Imprimer cet article
 Envoyer par mail
Envoyer par mail


31 mars 2014 à 11:16
Bonjour !
Deux remarques :
1) La réponse de Sanchez à votre dixième question est dépourvue de sens. Il y a peut-être une autre raison rationnelle à l’absence de Jacob dans sa biblio, mais ça n’est certainement pas les deux lignes qu’il y aurait occupées.
2) L’adresse que vous indiquez pour la thèse de Colombe de Dieuleveult produit un message d’erreur.
31 mars 2014 à 13:08
Je crois que Jean-Lucien Sanchez sera capable de répondre tout seul à la première remarque mais je comprends aisément que l’on ne mentionne ni Rousseau ni Jacob sachant que les deux personnages ont essentiellement témoigné sur la transportation et non sur la relégation. Ensuite, la lupinose est un des points particuliers – certes fondamental – de l’historiographie de l’honnête cambrioleur. Quant au lien, je viens tout juste de le rectifier.
Merci pour les remarques.
JMD