Un médecin au bagne chapitre 9

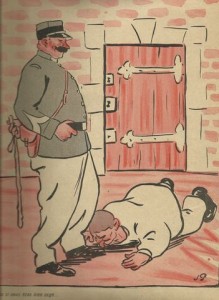 Avec le chapitre 9 sur « l’esprit pénitentiaire », le docteur Louis Rousseau en vient à décrire et à expliquer comment, dans un système pyramidal de type quasi féodal, les agents de l’AP peuvent à loisir s’entraîner à la méchanceté. Si tout au long de son ouvrage il n’a de cesse de dénoncer le sadisme, la férocité, la brutalité, la perversité, la veulerie, la lâcheté, l’alcoolisme du chaouch qui, pour se couvrir, pour bénéficier d’un avancement, pour punir plus sévèrement un condamné ou encore pour profiter d’un trafic, n’hésite pas à dénoncer ou à produire de faux témoignages ; cela peut se justifier par la haine sociale du criminel. Mais le rapport fort-faible autorise surtout pour le surveillant l’oubli et le refoulement de sa propre condition sociale. De la sorte et en jouant sur le sentiment raciste, les porte-clés, ces supplétifs de la surveillance majoritairement choisis dans la population pénale arabe, reproduisent le même schéma de domination et de violence exercée sur les hommes punis.
Avec le chapitre 9 sur « l’esprit pénitentiaire », le docteur Louis Rousseau en vient à décrire et à expliquer comment, dans un système pyramidal de type quasi féodal, les agents de l’AP peuvent à loisir s’entraîner à la méchanceté. Si tout au long de son ouvrage il n’a de cesse de dénoncer le sadisme, la férocité, la brutalité, la perversité, la veulerie, la lâcheté, l’alcoolisme du chaouch qui, pour se couvrir, pour bénéficier d’un avancement, pour punir plus sévèrement un condamné ou encore pour profiter d’un trafic, n’hésite pas à dénoncer ou à produire de faux témoignages ; cela peut se justifier par la haine sociale du criminel. Mais le rapport fort-faible autorise surtout pour le surveillant l’oubli et le refoulement de sa propre condition sociale. De la sorte et en jouant sur le sentiment raciste, les porte-clés, ces supplétifs de la surveillance majoritairement choisis dans la population pénale arabe, reproduisent le même schéma de domination et de violence exercée sur les hommes punis.
Mais Rousseau ne parle finalement que très peu de l’organisation interne du système bagne même s’il évoque longuement au 1er chapitre les lois et décrets régissant la transportation et la relégation. Théoriquement, le Directeur de l’Administration Pénitentiaire se trouve sous la coupe du gouverneur de la Guyane. En réalité, l’autorité de ce dernier s’arrête aux portes des pénitenciers même si le décret du 20 mars 1895 permet au chef du service judiciaire de la colonie d’organiser au moins une fois par an des tournées d’inspection et d’en référer par rapport à son ministre de tutelle. Nombreux sont ainsi les écrits de journalistes ou d’historiens mettant en relief l’inévitable et perpétuel conflit entre les deux autorités : politique (le gouverneur) et pénitentiaire (le Directeur). Nommé en conseil des ministres, le Directeur réside à Saint Laurent du Maroni. De là, il envoie ses ordres aux commandants des pénitenciers.
Chaque camp est tenu par un « chef de centre », généralement un militaire de 1e classe. Comme les bagnards, les surveillants se divisent en trois classes en fonction de leur avancement et de leurs états de service. La Guyane compte alors environ un demi-millier de ces fonctionnaires (surveillants militaires et civils de l’A.P.) chargés d’organiser la vie de dix fois plus de condamnés. Mais, en tenant compte des maladies et des congés d’un an passés en métropole, ce nombre doit être ramené à moins de 400. Cette faiblesse numérique explique non seulement la dureté du comportement du garde-chiourme mais également l’emploi des porte-clés. A l’origine, ces derniers ne font que fermer et ouvrir les portes des cases. D’où leur nom. Peu à peu, leurs fonctions, pourtant non légales, s’étoffent. Ils effectuent des tours de ronde avec les surveillants, fouillent les cases et les bagnards. Certains peuvent être armés de sabre d’abatis pour prêter main forte en cas de problème.
L’autorité honnie s’incarne ainsi au quotidien par le surveillant militaire, le garde-chiourme, le chaouch. Nombre d’entre eux viennent de Bretagne et de Corse, viviers traditionnels de fonctionnaires. Si Paul Rousseng, bagnard anarchiste, reconnaît que « parmi eux se trouvaient de bons garçons »[1], la majorité des témoignages ceux des fagots, ceux des journalistes, ceux enfin de médecins comme Léon Collin[2] rejoignent le propos du Dr Rousseau. Le surveillant, assermenté, profite des droits que lui confère sa fonction pour faire régner la terreur parmi la population carcérale et pour profiter d’elle aussi. Alain Sergent, dans la biographie d’Alexandre Jacob qu’il commet en 1950, reprend à son compte la réplique apocryphe de Napoléon III à qui l’on demandait en 1854 par qui il ferait garder tous ces bandits : « Par de plus bandits qu’eux ! »[3]. Pour Michel Pierre, historien, « il semble que l’ivraie l’ait emporté sur le bon grain »[4]. Les écrits d’Alexandre Jacob évoquent de temps à autre le monde des surveillants. Force est de constater que le portrait par lui dressé est rarement à leur avantage. Force est constater que le propos de l’honnête cambrioleur aboutit au même constat que celui de son ami, le docteur Louis Rousseau qui signale encore que les rares bagnards qui ont su résister à la vindicte du surveillant militaire sont « des hommes d’une trempe remarquable. On les compte. » Il y a tout lieu de penser que Jacob fut de ceux-là.
Un médecin au bagne
Editions Fleury, 1930, p.278-295
CHAPITRE IX : L’Esprit Pénitentiaire
Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire détestent les condamnés. Ils cherchent peut-être la justification de leurs dispositions hostiles dans le sentiment général de réprobation à l’égard des criminels, qui anime le public. Je crois plutôt que la criminalité des condamnés est un mobile très secondaire de leur haine qui trouve surtout son aliment dans l’exercice quotidien d’un métier mal conçu. Dès son arrivée au service le fonctionnaire, surveillant militaire ou cadre civil, voit que la barrière qui le sépare de l’élément pénal sépare, non les honnêtes gens des criminels, mais les forts des faibles. II n’aura que du mépris pour ceux qui, de l’autre côté, sont sans droits ni moyens, de l’aversion pour ceux qui ne savent pas se garder eux-mêmes et l’obligent à travailler. Comme s’exaltent les bons sentiments s’exaltent aussi les mauvais. On ne pardonne pas à son prochain le mal qu’on lui fait, les services qu’il vous rend. A dépouiller le condamné, à le punir, à l’emprisonner à l’abri des règlements inhumains impitoyablement appliqués, les fonctionnaires du bagne s’entraînent à la méchanceté. Mais, s’écrieront-ils, nous n’appliquons même pas le règlement comme nous serions en droit de le faire, et en accordant à nos administrés de nombreuses libertés nous fermons en réalité les yeux sur autant d’infractions !… Nous savons ce que vaut cette défense. Elle se base sur un fait exact : quelques règlements en effet ne sont pas appliqués, mais s’il en est ainsi c’est qu’ils sont inapplicables à force d’être trop durs, qu’ils nuiraient trop manifestement à la santé des condamnés, abrégeraient trop leur vie pour que l’arrivée régulière des convois suffise à maintenir l’effectif constant désirable, ou risqueraient de provoquer la révolte. C’est aussi que leur application fatiguerait le personnel. Enfin, en n’appliquant pas certains règlements pourtant applicables d’après les textes à tous et en tout temps, en se réservant de ne les appliquer qu’à certains individus, à des catégories limitées, voire à un pénitencier tout entier, mais pour un temps déterminé, l’administration pénitentiaire s’est constitué un système de répression qui répond à ses besoins, complète le système prévu et permet à tous les chefs de camps et de pénitenciers de punir directement, et sans laisser de traces écrites. C’est ce qu’ils appellent appliquer le règlement, serrer la vis ou encore cesser d’être bons ! C’est par ce calcul et nullement par humanité que l’administration pénitentiaire laissera les condamnés fumer en case et y jouer de la mandoline ; avoir des emplois défendus par leurs classements et, faire du commerce avec ses agents ; qu’elle réduira leurs heures de travail pour laisser les surveillants libres aux heures de sieste et d’apéritif… L’administration pénitentiaire étale ces tolérances avec complaisance quand le besoin s’en fait sentir. C’est ainsi que devant les gouverneurs et les procureurs généraux en inspection, elle masquera d’une apparente philantropie sa réelle cruauté. Toujours au contraire, l’administration pénitentiaire applique lois, décrets et règlements dans le sens le plus défavorable aux condamnés. Qu’il s’agisse d’administration courante, de punitions ou de récompenses, toujours l’action administrative leur est hostile. Les punitions, nous savons avec quelle largesse elles sont distribuées, mais les récompenses, il faut entendre par là les atténuations prévues par les règlements aux peines de tout ordre, on pourrait croire qu’ici l’hostilité cesse pour faire place à la bienveillance ? Il n’en est rien. Ce sont des raisons matérielles ou politiques qui contraignent l’administration à prononcer les désinternements des îles, les déclassements du camp disciplinaire et les libérations conditionnelle prévues pour les condamnés à la prison spéciale ou à la réclusion cellulaire : ce sont les locaux trop petits qu’il faut décongestionner, ce sont des particuliers toujours généreux qui demandent de la main-d’œuvre en abondance, c’est enfin la nécessité de produire en fin d’année des statistiques où figurera au moins un petit nombre de bénéficiaires des récompenses prévues par la loi. Ce seront aussi des intérêts inavouables qui présideront au trafic des envois en assignation et en concession. La justice intervient peu dans la distribution de ces faveurs, jamais la bienveillance.
Comme l’Administration de la Justice aggrave encore cette sévérité, que sur cent mesures de grâces proposées par l’Administration pénitentiaire, quatre-vingt-quinze sont systématiquement rejetées[5], on peut dire qu’à l’instar de la porte d’entrée du paradis chrétien, la porte de sortie de notre enfer pénitentiaire a les dimensions du châs d’une aiguille.
La pluralité des pénitenciers, des camps, des locaux de discipline mais surtout celle des chantiers et des corvées qui fractionne la population pénale en petits groupes disséminés, a nécessité la création des porte-clés. Depuis qu’ils furent créés, le personnel n’a jamais cessé de réclamer qu’on augmente leur nombre. Poussé par la paresse, il voit en eux non seulement des auxiliaires faits pour alléger sa tâche, mais des suppléants capables de faire à peu près tout le service, corvéables à merci et à qui toute revendication est interdite, ce qui est encore une bonne affaire. Quoi de plus tentant que de faire faire la surveillance des forçats par les forçats eux-mêmes ? Recrutés parmi les condamnés des deux premières classes, soixante-dix pour cent des porte-clés sont arabes, les autres européens. L’emploi a ses avantages. Finie la .corvée qui est l’essence même de la peine, fini le travail qui déshonore ! Désormais ce seront les heures de présence oisives, suprême récompense des fainéants et la surveillance qui rapporte, idéal des vagabonds. Ce seront des occasions journalières d’exploiter les co-détenus et de vivre à leurs dépens. Mais comme il faut garder une si bonne place, il faudra pour cinquante condamnés à qui on vend le silence en trahir cinquante autres pour plaire à l’autorité, lui montrer qu’on fait son service et qu’on est un auxiliaire indispensable. Peu à peu le personnel paresseux trouvant plus commode de substituer à sa surveillance propre celle des porte-clés, a perdu l’habitude de voir par lui-même, a encouragé les porte-clés à tout voir et tout rapporter, a même perdu l’habitude de contrôler leurs rapports, et s’est aveuglément fié à eux. Ainsi la délation a pris peu à peu la place de la surveillance directe, la seule digne d’une administration honnête, et l’administration pénitentiaire est devenue une administration de mouchards.
Le bon accueil réservé à tous les rapports vrais ou faux incite les porte-clés à mentir. Jamais un faux rapport ne leur est reproché, quelquefois il leur vaut un paquet de tabac. Aussi usent-ils de ce moyen pour tromper l’administration sur ceux de leurs co-détenus qui leur déplaisent ou qui déplaisent à d’autres forçats qui les paient pour mentir.
Tous les fonctionnaires du bagne considèrent que la délation est le signe de l’amendement du criminel. C’est par la délation que le forçat, en rendant service à l’administration, fait un premier pas vers elle, reconnaît sa force et s’y soumet. Aucune autre voie n’est ouverte aux réprouvés du bagne pour faire savoir à l’administration pénitentiaire qu’ils sont prêts désormais à suivre les lois de la société qu’ils ont offensée, et à vivre en bonne intelligence avec elle. A de telles conditions, les meilleurs des condamnés et les plus intelligents, préfèrent se renfermer jusqu’à la fin de leur peine dans leur dignité d’outlaws, plutôt que de se rapprocher de la société qui les a punis parce que, entre elle et eux, se dresse cette inqualifiable administration pénitentiaire qui ne sourit qu’aux délateurs.
La délation sévit, dans le personnel autant et plus que dans le monde pénal. Les chefs l’utilisent à toutes fins. Comme ils se renseignent sur les condamnés par l’intermédiaire des surveillants et d’autres condamnés, ils se renseignent sur les surveillants par l’intermédiaire des condamnés et des autres surveillants. Eux- mêmes sont espionnés. Le Directeur a deux yeux sur chaque pénitencier, l’un dans le monde pénitentiaire, l’autre dans le monde pénal.
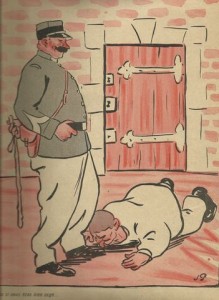 Les fonctionnaires du bagne ont tous conscience de la laideur de leur métier. Privés des satisfactions que donne l’accomplissement journalier d’un travail honorable, lassés par les longues heures de surveillance désœuvrée, souffrant en silence de la déconsidération dont ils se savent l’objet, beaucoup de ces fonctionnaires boivent. Lors d’une visite médicale à l’île de Saint- Joseph, le chef de camp me dit :
Les fonctionnaires du bagne ont tous conscience de la laideur de leur métier. Privés des satisfactions que donne l’accomplissement journalier d’un travail honorable, lassés par les longues heures de surveillance désœuvrée, souffrant en silence de la déconsidération dont ils se savent l’objet, beaucoup de ces fonctionnaires boivent. Lors d’une visite médicale à l’île de Saint- Joseph, le chef de camp me dit :
« Vous ne vous figurez pas la collection d’alcooliques que j’ai ici sous mes ordres. Ils sont douze et je n’en connais guère qu’un qui ne boive pas. D’autre part, j’en compte six qui sont tellement saoûls tous les soirs quand ils montent à la Réclusion prendre leur service, que dès le début de leur garde ils ne tardent pas à s’endormir profondément. Je fais mon possible pour doubler toujours un ivrogne d’un garçon sérieux, mais j’ai de la peine à y arriver. Heureusement que les porte-clés sont là ! L’autre jour dans ma ronde j’ai surpris Z… qui, tout surveillant de première classe qu’il est, était étendu sur une chaise-longue et ronflait la bouche ouverte et les mains sur le ventre dans le couloir du premier bâtiment de la Réclusion. Le bougre s’était débarrassé de son revolver qu’il avait pendu par la courroie au dossier de la chaise. J’ai pris le revolver et suis parti. A son réveil il fut, comme vous le pensez, fort ennuyé et obligé de me rendre compte de la disparition de son arme. Je lui fis de vifs reproches, lui rendis son revolver et le prévins que la prochaine fois je le signalerais. Il me promit alors qu’il ne boirait plus, mais depuis il est toujours aussi saoûl. Eh bien, ici, presque tous les surveillants sont comme ça ! Le jour où je voudrais les faire punir sévèrement, je n’ai qu’à les surprendre endormis pendant leurs gardes, ils m’en fournissent à chaque instant l’occasion ».
Ces buveurs sont tous assermentés et la justice du bagne repose sur l’infaillibilité de leur parole. Ici encore les faits abondent qui donneront une idée de la justice à laquelle peut prétendre un condamné.
Le 3 mars 192.., le surveillant Vas… lyncha sans aucun motif le condamné arabe Omar, qui travaillait sur l’appontement de Saint-Laurent au déchargement d’un cargo. Le forçat Perrin, qui était présent, arracha aux mains du surveillant son co-détenu qui fut incapable de travailler pendant dix jours.
Le 6 juillet suivant Perrin comparut devant le Tribunal maritime, inculpé d’outrage et de rébellion. Au Tribunal., figurait un madrier en bois d’angélique, de dix kilos ; c’était une pièce à conviction.
Perrin, partagé depuis l’incident entre l’espoir que donne le bon droit et l’anxiété inspirée par une justice dont on doute, fut, au grand étonnement du monde pénitentiaire et pénal, acquitté.
Que s’était-il donc passé ?
Le commandant du cargo, témoin du sanglant passage à tabac, avait à son arrivée en France remis un rapport à l’autorité maritime sur la scène scandaleuse. Ce rapport fut transmis au gouverneur de la Guyane, puis au directeur de l’administration pénitentiaire qui dut le transmettre au rapporteur. Celui-ci le versa au dossier l’avant-veille de l’audience. Il était temps !
La parole de l’inculpé ayant ainsi reçu une confirmation aussi éclatante que providentielle, le rapporteur dut renverser ses conclusions et le surveillant, convaincu d’avoir produit une fausse pièce à conviction, fut réprimandé par le président.
Quant à l’arabe lynché, l’administration pénitentiaire prolongea à plaisir la détention préventive dans laquelle il croupissait, car lui aussi, inculpé de rébellion, devait être jugé à la session suivante. Le directeur ne prononça le non-lieu que quinze mois après l’incident. Il fallait bien le punir sévèrement puisqu’il avait eu le tort d’être battu par un agent.
C’est à un hasard que Perrin dut de sortir indemne de cette affaire. Par principe, l’administration pénitentiaire, forte de son immunité, répond : « tu mens » au condamné qui dit la vérité, cela est courant, quotidien, et il est exceptionnel de voir un tiers confondre son audace insolente et prendre la défense de l’opprimé.. Si cela arrive, elle encaisse sans répondre, mais reste fidèle à ses traditions.
Voici un exemple très remarquable où on la voit prise à ses propres filets : quand un relégué s’évade et se fait arrêter par un surveillant, ce dernier touche une prime de capture de dix francs. Or ce relégué n’encourt pas une peine terrible comme les condamnés aux travaux forcés ; il se voit infliger quelques jours de cachot seulement – cellule aujourd’hui -, [6] en sorte que beaucoup d’entre eux s’évadent et se font reprendre à plaisir par un surveillant avec qui ils sont de connivence. Ce dernier touche chaque fois dix francs et en remet cinq au relégué qui est très heureux de faire quelques jours de cellule pour cinq francs. Lors de l’inspection mobile de 1917, un surveillant de Saint-Laurent-du-Maroni, dégoûté de ces procédés en faveur au pénitencier de la Relégation, signala le fait aux inspecteurs et leur remit une déclaration écrite et circonstanciée visant particulièrement un certain collègue qui abusait vraiment de ce genre d’escroquerie. Un relégué avait fait de son côté une déclaration analogue concernant le même surveillant. Les inspecteurs firent part au directeur de l’administration pénitentiaire de la seule déclaration du relégué, et dans une note où ils paraissaient ne pas mettre en doute la parole de ce relégué, appelaient vivement l’attention du directeur sur les pratiques délictueuses de certains de ses agents. La réponse du directeur fut des plus vives : comment, messieurs les inspecteurs, osez-vous ajouter foi aux déclarations d’un relégué qui ne pense qu’à mentir et à nuire, et qui, flatté de la confiance que vous lui faites, en profite pour donner libre cours aux extravagances de son mauvais esprit ? Comme on voit, messieurs, que vous n’avez aucune expérience de ces gens-là ! Je ne saurais trop vous mettre en garde… etc… Les inspecteurs adressèrent alors au directeur la déclaration du surveillant. Le directeur dut trouver que les inspecteurs étaient des fonctionnaires bien mal élevés, mais il se tint coi et les choses en restèrent là. Cette histoire, comme tant d’autres, a été relatée dans des rapports officiels, qui, s’ils n’ont pas été détruits dorment encore dans les cartons du Ministère des Colonies.
La moitié des punitions encourues par les condamnés résultent des rapports faux ou exagérés.
Dans les premiers mois de mon séjour aux Iles, le commandant du pénitencier m’invita à assister à une séance de commission disciplinaire à l’île de Saint-Joseph. Je fus profondément dégoûté. Je vis défiler une série de condamnés squelettiques auxquels un mois de cachot fut infligé. L’un avait joué aux cartes en case, l’autre avait volé des cocos…
Je me souviens de l’un d’eux qui avait volé des tomates dans un jardin du Service des cultures : il eut de ce fait trente jours de cachot. Comme il avait vendu les tomates volées et se refusait à dire à qui il les avait vendues, il eut encore trente jours de plus. Or, cet homme non seulement en toute équité, mais aux termes même des règlements ne devait être puni qu’une fois. Mais la plupart des surveillants et des commandants de pénitencier excellent à couper les motifs de punition en deux ou trois pour ‘punir davantage. Ainsi pour une seule et même faute le condamné est puni deux ou trois fois. Ceci se passait avant 1925, au temps du cachot et des fers. Or pour qui sait ce qu’étaient trente jours de cachot, il y avait là un abus révoltant dont souffraient beaucoup de malheureux qui n’avaient commis que de misérables petites peccadilles. Si le condamné se plaignait au directeur, celui-ci lui donnait quelquefois raison ; dans ce cas la réponse arrivait toujours quand le condamné avait fait ses deux ou trois mois de cachot. Il y gagnait toutefois que les punitions imméritées étaient effacées de son livret, ce qui était important pour les avancements en classe, mais sa santé en avait bien souffert.
La suppression du cachot et des fers, légiférée en 1925 n’a pas été pour ces abus un obstacle définitif. Il reste encore aux commandants de pénitenciers qui chérissent la manière forte la cellule effective qui, bien maniée, leur donne de grosses satisfactions.
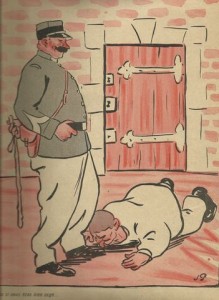 Le fonctionnaire pénitentiaire vit tout près du condamné. A la corvée, au camp, au chantier, dans les ateliers, dans les bureaux, à la salle de réunion, le condamné est à côté de lui. Garçon de famille, il entre dans son intimité, se fait son mouchard, assiste à ses beuveries, prend pied dans le ménage. En dépit de cette promiscuité jamais le fonctionnaire du bagne ne connaîtra le condamné. Jamais il n’essaiera dans un but de consolation et de relèvement de se pencher sur ses misères, de causer avec lui. Il croirait faillir à son devoir. L’esprit de la maison s’y oppose. Le ferait-il d’ailleurs, ce serait peine perdue. Pour s’ouvrir en confiance, il faut au condamné quelqu’un qu’il connaisse, de vieille date et qui sache garder une confidence. Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sont incapables d’une pareille discrétion, à moins qu’il ne s’agisse d’être le complice d’un mauvais coup. Ayant poussé les forçats à la délation, ils n’en retirent que le mensonge, et pendant que les faibles leur disent tout ce qui leur semble bon, excepté la vérité, les meilleurs, se renferment dans un mutisme absolu et définitif. Les seules personnes à qui ceux-ci consentiront à parler sincèrement seront étrangères à l’administration pénitentiaire. C’est ainsi que certains prêtres ou pasteurs, certains patrons bons pour leurs assignés, ont pu recueillir leurs pensées intimes. Ce fut aussi le cas des médecins qui comprirent leur devoir et surent regarder les criminels autrement qu’avec des yeux de garde-chiourme. Ceux-là ont vu, dans la pègre pénale des bons, des moins bons, des mauvais comme partout ailleurs. Ils ont vu des dégénérés et des fous, surtout beaucoup de sujets ressemblant étrangement à ceux qu’on voit partout, et qui pour avoir versé dans le crime n’en sont pas moins des hommes dignes de pitié. Le fonctionnaire de l’administration pénitentiaire considère que toutes ces nuances ne sont que des finasseries. Découlant de sa haine et de sa paresse, les idées qu’il se fait de la psychologie du condamné ne sont pas compliquées : ils sont tous les mêmes, ces gaillards-là ! Je les connais comme si je les avais faits ! Il n’y en a pas un, entendez-vous, pas un qui un jour ou l’autre ne puisse vous faire un sale coup !… Affirmation gratuite dont l’expérience montre l’absurdité, puisque la grande majorité des condamnés meurent sans avoir fait le moindre « sale coup » à un surveillant.
Le fonctionnaire pénitentiaire vit tout près du condamné. A la corvée, au camp, au chantier, dans les ateliers, dans les bureaux, à la salle de réunion, le condamné est à côté de lui. Garçon de famille, il entre dans son intimité, se fait son mouchard, assiste à ses beuveries, prend pied dans le ménage. En dépit de cette promiscuité jamais le fonctionnaire du bagne ne connaîtra le condamné. Jamais il n’essaiera dans un but de consolation et de relèvement de se pencher sur ses misères, de causer avec lui. Il croirait faillir à son devoir. L’esprit de la maison s’y oppose. Le ferait-il d’ailleurs, ce serait peine perdue. Pour s’ouvrir en confiance, il faut au condamné quelqu’un qu’il connaisse, de vieille date et qui sache garder une confidence. Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sont incapables d’une pareille discrétion, à moins qu’il ne s’agisse d’être le complice d’un mauvais coup. Ayant poussé les forçats à la délation, ils n’en retirent que le mensonge, et pendant que les faibles leur disent tout ce qui leur semble bon, excepté la vérité, les meilleurs, se renferment dans un mutisme absolu et définitif. Les seules personnes à qui ceux-ci consentiront à parler sincèrement seront étrangères à l’administration pénitentiaire. C’est ainsi que certains prêtres ou pasteurs, certains patrons bons pour leurs assignés, ont pu recueillir leurs pensées intimes. Ce fut aussi le cas des médecins qui comprirent leur devoir et surent regarder les criminels autrement qu’avec des yeux de garde-chiourme. Ceux-là ont vu, dans la pègre pénale des bons, des moins bons, des mauvais comme partout ailleurs. Ils ont vu des dégénérés et des fous, surtout beaucoup de sujets ressemblant étrangement à ceux qu’on voit partout, et qui pour avoir versé dans le crime n’en sont pas moins des hommes dignes de pitié. Le fonctionnaire de l’administration pénitentiaire considère que toutes ces nuances ne sont que des finasseries. Découlant de sa haine et de sa paresse, les idées qu’il se fait de la psychologie du condamné ne sont pas compliquées : ils sont tous les mêmes, ces gaillards-là ! Je les connais comme si je les avais faits ! Il n’y en a pas un, entendez-vous, pas un qui un jour ou l’autre ne puisse vous faire un sale coup !… Affirmation gratuite dont l’expérience montre l’absurdité, puisque la grande majorité des condamnés meurent sans avoir fait le moindre « sale coup » à un surveillant.
Cette médiocrité en matière de psychologie a conduit l’administration à des pratiques détestables et cruelles dont les névrosés, les originaux et les fous sont les plus innocentes victimes. Certains condamnés sont ainsi devenus de véritables souffre-douleurs. Les agents se les passent en consigne : « Fais-y attention à celui-là ; c’est une forte tête, un réclamateur. Quand tu ouvriras sa cellule, ouvre l’œil ! il est capable de tout ! » Puis la légende se propage en dehors du pénitencier. Le nom du condamné féroce est connu du public. Quand le porte-clé ouvre sa cellule, on dispose un surveillant à droite, un surveillant à gauche prêts à faire feu ou à maîtriser l’agresseur. Le procureur et le médecin s’attendent à voir un exalté bondir de sa cellule comme un diable à ressort de sa boîte, et ils voient un malheureux, tout nu, comme on le lui ordonne, décharné, les yeux surpris par la lumière, les mains tombantes et les talons joints dans l’attitude du soldat sans armes.
Chaque pénitencier compte toujours un certain nombre de condamnés irréductibles, que l’administration pénitentiaire s’efforce de mater par le cachot et la faim. J’en ai connu qui ne quittaient pas le cachot. Ils y étaient depuis plusieurs années et devaient y vivre plusieurs années encore. Au début, je me suis demandé si ces hommes-cloportes ne recherchaient pas l’encellulement, n’aimaient pas les murs ? Il n’en est rien ; ce sont tous des détraqués, des dégénérés, de grands malheureux. Ils ne sont pas fous au point d’être internés et restent aux mains de l’Administration pénitentiaire. Celle-ci leur applique la manière uniformément brutale qui lui est chère. Au cours de duels de plusieurs années, dans lesquels elle est loin d’avoir le beau rôle, elle torture et transforme en martyrs des individus auxquels leur constitution enlève toute valeur sociale et qui devraient être l’objet d’un traitement spécial. Mais la psychiatrie n’a pas ici droit de cité.
Le régime du bagne met toujours en relief les tares physiques et mentales des condamnés. Il donne aussi à ceux qui lui résistent l’occasion de prouver qu’ils sont normalement et même solidement construits. Les rares forçats qui sans tomber dans la délation et tout en conservant leur dignité ont su échapper aux rigueurs de ce régime d’une férocité insoupçonnable et ont pu accomplir leur peine sans une punition sont, cela est hors de doute, des hommes de trempe remarquable : on les compte. Aussi pour les condamnés du bagne français est-ce une tâche effrayante de revenir sur la bonne route après s’en être écarté. Jamais ils n’auront une parole d’encouragement ou de pardon. Et quand un de ces hommes remplis de bonne volonté a accompli le tour de force de subir sa peine sans punition et qu’il demande un adoucissement à son sort comme par exemple une levée d’interdiction de séjour, une dispense de la résidence obligatoire ou la relégation individuelle à la place de la relégation collective, presque toujours la demande annotée défavorablement au bas de l’échelle est retournée à son auteur avec un refus. On fait savoir au condamné que les autorités compétentes n’ont pas cru devoir faire un accueil favorable à sa supplique. Plus paresseuses que compétentes, elles n’ont fait que répéter sous une autre forme l’annotation initiale d’un chef de camp ou d’un commandant de pénitencier qui dix fois sur dix, à moins qu’il ne s’agisse d’un délateur ou d’un gros pistonné, aura moulé au bas de la lettre du forçat la formule consacrée : « Mauvais sujet, ne s’est pas amendé. Avis défavorable ». Dès lors on comprend très bien comment l’arrêté ministériel du 18 septembre 1925 relatif au mode de notation pour constater l’amendement moral et régler l’avancement en classe des condamnés ne peut donner aucun heureux résultat. De même on voit mal comment le principe des sentences indéterminées serait appliqué par de pareils fonctionnaires. Jamais ils ne s’occupent des condamnés, aussi le jour où ils ont à dire leur avis sur l’un d’eux, ils adoptent la même formule pour tous, et de peur de se tromper dans un sens qui pourrait être dangereux pour la société qu’ils croient défendre, ils adoptent pour tous une formule péjorative : « Sujet dangereux, ne s’est pas amendé. » Et le condamné est toujours abandonné à sa misère, alors même qu’il a tout fait pour qu’une main secourable se tende vers lui.
J’ai voulu voir si les médecins des prisons étaient à l’endroit des forçats un peu plus respectueux de leurs devoirs que les fonctionnaires du bagne. Hélas ! quelques-uns au moins s’attardent bien peu à cette clientèle, si d’autres s’en occupent. Avant leur départ de Saint-Martin-de-Ré pour la Guyane, tous les forçats doivent être visités un par un et classés en plusieurs catégories suivant leurs aptitudes physiques. Un jour je pris les livrets de trois nouveaux arrivants. Le premier était celui d’un unijambiste porteur d’un pilon, l’autre celui d’un ataxique qui pouvait à peine se tenir debout à l’aide d’un bâton, le troisième celui d’un tuberculeux cavitaire. Ces trois livrets portaient comme ceux des trois cents forçats du convoi la mention : « Apte à tous les travaux sous tous les climats ».[7]
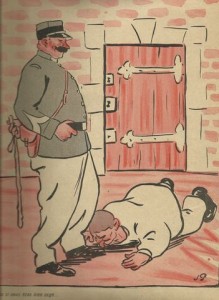 L’administration pénitentiaire qui, par la faim, la cellule et la délation s’efforce d’amener le condamné à la soumission veut aussi un personnel qui lui obéisse au doigt et à l’œil. Le microcosme pénitentiaire est un petit monde isolé dans lequel personne d’étranger à son administration ne peut pénétrer ; c’est ce qui permet à son chef d’agir en maître absolu. Celui-ci est bien sous l’autorité du Gouverneur de la Guyane et à certains points de vue sous le contrôle du Chef du Service judiciaire. Ces deux personnages font bien une tournée annuelle dans les péniténciers, mais, uniquement préoccupés d’éviter les histoires, ils ne mettent jamais le nez dans les affaires du fief pénitentiaire. Leur suzeraineté est donc peu gênante et le grand maître de la chiourme peut agir à sa guise. Sans pouvoir réclamer ni crier les abus, la grande masse des condamnés souffre et crève de faim. Quelques-uns parmi eux, acceptent d’ignobles fonctions, font n’importe quoi pour se remplir le ventre. D’autres, à force de volonté, arrivent par un travail opiniâtre et fort mal rémunéré dont profitent les fonctionnaires du bagne, à gagner quelques sous. En plantant, jardinant, pêchant, chassant, travaillant aux ateliers pour leurs gardiens, ils obtiendront quelques avantages qui leur rendront la vie moins dure. Mais à quel prix ! Au-dessus de l’élément pénal profitent et engraissent surveillants, commis et commandants de pénitenciers. Tous ceux-ci n’ont qu’un but : vivre largement aux dépens du condamné et avancer en grade. Seuls avancent ceux qui, fervents adeptes du régime, joignent la flatterie à la délation. Il ne s’agit pas ici de flatteries en paroles, mais de ces flatteries en nature qui remplissent les poches et les garde-manger des supérieurs. Tous ces agents auront les postes lucratifs dits « poste à camelote » et les postes de tout repos dans les bureaux du chef-lieu où l’on est si bien à l’abri des morsures du climat et à l’affût des décorations. Tous leurs efforts tendront à augmenter, en même temps que le leur, le casuel de leurs patrons, en sorte que le directeur des pénitenciers commande un petit domaine féodal où, sous prétexte de justice, de travaux forcés, d’amendement des criminels, six milliers d’ilotes renouvelables et qui, par conséquent, n’ont pas à être ménagés, entretiennent près d’un millier de paresseux.
L’administration pénitentiaire qui, par la faim, la cellule et la délation s’efforce d’amener le condamné à la soumission veut aussi un personnel qui lui obéisse au doigt et à l’œil. Le microcosme pénitentiaire est un petit monde isolé dans lequel personne d’étranger à son administration ne peut pénétrer ; c’est ce qui permet à son chef d’agir en maître absolu. Celui-ci est bien sous l’autorité du Gouverneur de la Guyane et à certains points de vue sous le contrôle du Chef du Service judiciaire. Ces deux personnages font bien une tournée annuelle dans les péniténciers, mais, uniquement préoccupés d’éviter les histoires, ils ne mettent jamais le nez dans les affaires du fief pénitentiaire. Leur suzeraineté est donc peu gênante et le grand maître de la chiourme peut agir à sa guise. Sans pouvoir réclamer ni crier les abus, la grande masse des condamnés souffre et crève de faim. Quelques-uns parmi eux, acceptent d’ignobles fonctions, font n’importe quoi pour se remplir le ventre. D’autres, à force de volonté, arrivent par un travail opiniâtre et fort mal rémunéré dont profitent les fonctionnaires du bagne, à gagner quelques sous. En plantant, jardinant, pêchant, chassant, travaillant aux ateliers pour leurs gardiens, ils obtiendront quelques avantages qui leur rendront la vie moins dure. Mais à quel prix ! Au-dessus de l’élément pénal profitent et engraissent surveillants, commis et commandants de pénitenciers. Tous ceux-ci n’ont qu’un but : vivre largement aux dépens du condamné et avancer en grade. Seuls avancent ceux qui, fervents adeptes du régime, joignent la flatterie à la délation. Il ne s’agit pas ici de flatteries en paroles, mais de ces flatteries en nature qui remplissent les poches et les garde-manger des supérieurs. Tous ces agents auront les postes lucratifs dits « poste à camelote » et les postes de tout repos dans les bureaux du chef-lieu où l’on est si bien à l’abri des morsures du climat et à l’affût des décorations. Tous leurs efforts tendront à augmenter, en même temps que le leur, le casuel de leurs patrons, en sorte que le directeur des pénitenciers commande un petit domaine féodal où, sous prétexte de justice, de travaux forcés, d’amendement des criminels, six milliers d’ilotes renouvelables et qui, par conséquent, n’ont pas à être ménagés, entretiennent près d’un millier de paresseux.
[1] Rousseng Paul, L’enfer du bagne, Libertalia, 2016, p.52.
[2] Léon Collin, Des hommes et des bagnes, Libertalia, 2015
[3] Sergent Alain, Un anarchiste de la Belle Epoque, LE Seuil, 1950, p.124.
[4] Pierre Michel, Bagnard, la terre de la grande punition, Editions Autrement, collection Mémoires, n°67, novembre 2000, p.88.
[5] Revue pénitentiaire. Année 1924 p. 455. M. Franceschi, directeur de l’A. P, Min. des Colonies.
[6] Telle est du moins dans la pratique la punition infligée à un relégué qui n’est pas sorti du territoire de la Guyane française. Dans le cas contraire l’évadé est traduit devant le Tribunal correctionnel qui peut infliger de 2 à 5 ans de prison. Par application de l’article 463 du C. P. la peine peut être réduite jusqu’à 8 jours de prison.
[7] Cette constatation eût pu relever le corps médical dans l’estime de M. Rivière, magistrat honoraire, qui se défie du sentimentalisme des médecins. Voir Revue pénitentiaire, 1924, p. 457.
Tags: Alain Sergent, alcoolisme, Alexandre Jacob, AP, arabe, autorité, avis, bagne, brutalité, camp, case, chaouch, délation, directeur, Editions Fleury, esprit pénitentiaire, férocité, fonctionnaire, gardien, gouverneur, Guyane, îles du Salut, Léon Collin, Louis Rousseau, méchanceté, médecin, Michel Pierre, ministre des Colonies, mouchard, porte-clés, racisme, Rousseau, Roussenq, sadisme, surveillant, travaux forcés, Un médecin au bagne, violence
 Imprimer cet article
Imprimer cet article
 Envoyer par mail
Envoyer par mail

