Un Médecin au bagne chapitre 11

 Rénovation pénitentiaire ? Parce qu’il est le dernier maillon d’une longue chaîne répressive qui a pour but l’éloignement, l’éviction ou plutôt l’élimination du criminel, le bagne ne pouvait aboutir qu’à un échec patent. Et si, dès sa création en 1854, il a su résister aux nombreuses critiques, c’est bien qu’il correspond parfaitement aux principes de préservation sociale et d’exemplarité qui fondent le système pénal français. Louis Rousseau s’attache alors à montrer dans le dernier chapitre de son ouvrage une organisation d’ensemble régie par la loi du talion. Le délinquant doit alors souffrir et faire repentance.
Rénovation pénitentiaire ? Parce qu’il est le dernier maillon d’une longue chaîne répressive qui a pour but l’éloignement, l’éviction ou plutôt l’élimination du criminel, le bagne ne pouvait aboutir qu’à un échec patent. Et si, dès sa création en 1854, il a su résister aux nombreuses critiques, c’est bien qu’il correspond parfaitement aux principes de préservation sociale et d’exemplarité qui fondent le système pénal français. Louis Rousseau s’attache alors à montrer dans le dernier chapitre de son ouvrage une organisation d’ensemble régie par la loi du talion. Le délinquant doit alors souffrir et faire repentance.
Nous avons précédemment vu combien apparaissaient vaines les reformes de 1925. Comme son ami Alexandre Jacob, dont il tire ici certainement l’anecdote d’une évasion en 1906, le médecin récuse cette illusion de l’amendement. Comme lui encore, il clame sa haine de l’Administration Pénitentiaire et pense que le bagne doit être supprimé. Mais son propos diverge toutefois de la pensée du libertaire qui voit dans la suppression totale des prisons la fin de l’épineuse question carcérale. Rousseau, lui, se veut réformiste même si son propos dépasse largement le discours ambiant sur les politiques d’enfermement.
S’appuyant alors sur les travaux du criminologue italien Enrico Ferri (1856-1929) et sur les exemples brésiliens, italiens, belges, il oppose à la violence répressive de la Vieille Ecole pénitentiaire – « Vous avez les bagnes que vous avez voulus » – l’idée d’une rénovation basée sur la santé psychique et physique du condamné, sur sa formation intellectuelle et professionnelle ainsi que sur le respect le plus strict des droits humains élémentaires.
Il se livre même à un étonnant éloge du système soviétique dont le code pénal de 1922, révisé en 1927, envisage une prison sans murs où le prisonnier ne peut être détenu plus de dix ans, où il n’a pas à subir de châtiments corporels et surtout où il se régénère par l’éducation et par le travail … loin, très loin dans les espaces sibériens. Rousseau, homme de gauche, ignore comme beaucoup à son époque l’horreur des goulags staliniens. Ses détracteurs, eux-mêmes peu au fait d’une réalité à l’époque cachée, pouvaient-ils le lui reprocher ? Nul doute en revanche que son propos ouvre un débat qui n’est toujours pas prêt de se refermer.
Un Médecin au bagne
Editions Fleury, 1930
p.329-356
CHAPITRE XI La Vieille Ecole et la Nouvelle
Rénovation pénitentiaire
L’étude des œuvres pénitentiaires métropolitaines nous a permis de connaître l’esprit pénitentiaire français. Elle nous aide maintenant à comprendre pourquoi la transportation qui comme son modèle anglais prétendait offrir aux criminels les moyens de se refaire une vie sous un autre ciel, se contenta de les exporter sur une terre meurtrière en vue de leur rapide disparition et se tint à ce programme. Nous comprenons mieux aussi pourquoi elle résiste aux critiques pourtant si méritées dont elle est l’objet. La loi de 1854 et les actes législatifs suivants sont l’expression de préjugés aussi tenaces aujourd’hui que sous le second Empire et qui s’opposent à toute rénovation pénitentiaire.
Avant 1854 les peines criminelles avaient pour but d’assouvir la vindicte publique et de protéger la société. La loi de 1854 se proposa comme les lois antérieures de protéger la société, mais elle voulut que la nouvelle peine des Travaux forcés, en restant toujours assez afflictive pour être intimidante et expiatrice, favorise le relèvement et l’amendement du criminel destiné à devenir un colon. Régénérer le coupable et le destiner à la colonisation, voilà son but. Malheureusement les législateurs du Second empire et de la Troisième république restèrent fidèles aux vieux principes du châtiment et de la vindicte qui jusqu’alors avaient servi de base à tous les codes, et, en poursuivant parallèlement deux buts diamétralement opposés, en voulant à la fois châtier et amender, ils mirent sur pied une législation criminelle digne des pires temps anciens. Le principe de préservation sociale devait seul conditionner le plan de régénération des criminels. Il n’en fut rien. Les vieux principes qui peuvent d’ailleurs contenir une part de justesse, étouffèrent dès sa naissance l’idée généreuse et l’empêchèrent de porter des fruits.
M. du Miral, rapporteur de la loi de 1854 a pensé avant tout à l’expiation et au repentir du coupable. Il a voulu que les condamnés sortent du bagne repentis et amendés par la souffrance. Ce député catholique a demandé à des règlements de prison de produire dans l’âme du criminel une révolution que Dieu seul peut produire dans l’âme du croyant. Si tu veux être assigné, si tu veux avoir une concession, souffre d’abord en raison de ton crime. Avant que s’ouvrent pour toi les portes de mon paradis pénitentiaire, séjourne dans mon purgatoire jusqu’à ce que tu sois digne d’y entrer. Chrétien à sa façon, il s’est posé en Dieu vengeur et fort peu miséricordieux. Il a réussi à jeter les fondations d’un enfer d’où sortirent un petit nombre de rescapés définitivement impropres à tout travail de colonisation. Chose incroyable, cette idée fixe de l’expiation entretenue par la haine du criminel et la vindicte sociale plus que par un pur sentiment de justice, inspira aussi les législateurs de la Troisième république. Ceux-ci achevèrent l’enfer dont Napoléon III avait posé la première pierre, lui donnèrent ses tourments et ses cycles, la faim, la maladie, le cachot, les camps disciplinaires et la réclusion cellulaire de Saint-Joseph !
M. du Miral et ses contemporains crurent au dogme de l’exemplarité, à la nécessité de l’intimidation. Quand il fallut réaliser l’idée de la transportation empruntée aux Anglais qui en avaient tiré un assez heureux parti, M. du Miral pensa que tout comme en Australie occidentale sous le régime anglais, il pourrait se faire que des criminels deviennent colons au bout de deux ans sans avoir jamais connu le cachot et la faim, et cela lui parut monstrueux. Il eut peur que nombre de forçats se conduisant aussi bien que des hommes honnêtes bénéficient des récompenses promises. Que deviendrait alors le principe de l’exemplarité? Il eut peur que la perspective de jouir d’un exil perpétuel mais doux, que l’espoir de passer contrat de propriété avec la cour d’assises comme notaire et l’administration pénitentiaire comme tutrice, ne soient qu’un encouragement au crime au lieu d’être un frein. Députés impériaux et républicains, juristes de tous les régimes, magistrats et professeurs de droit, tous obéirent aveuglément au principe d’exemplarité. Ce n’est pas qu’il faille nier l’exemplarité des peines. Les peines – elles n’ont pas besoin pour cela d’être si dures – empêchent incontestablement quelques crimes et quelques délits, mais dans une mesure dont il est bon de se rendre compte. L’exemplarité a son plein effet dans un milieu composé de sujets qui se soumettent bénévolement aux règles sociales de ce milieu. Cet effet est d’autant plus grand que l’individu considéré a une situation sociale plus avantagée et plus haute. C’est le cas de beaucoup de criminalistes, de juristes, de pénologues et d’administrateurs. Il est exact qu’à l’égard de tels hommes la perte de l’aisance relative et de la considération dont ils jouissent, ajoutée à l’exécution d’une peine très dure, doit avoir un effet inhibitif dans la balance des déterminations. Le contingent des criminels formé, sauf de rares exceptions, d’hommes qui ont peu à perdre, est peu touché par ces arguments. Sur ceux-ci l’exemplarité est presque inopérante. Pour une infraction donnée il y a des différences de pénalités considérables entre certains pays limitrophes, France, Italie et Belgique, par exemple. Ces deux derniers états ont rayé de leurs codes la peine capitale. Plusieurs infractions que le Code pénal français punit de peines perpétuelles ne sont que temporaires dans ces deux états. Or, si l’on consulte les statistiques, on verra que les criminels français n’ont jamais émigré dans ces deux états ; c’est peut-être le contraire qui se pourrait constater, eu égard au nombre élevé d’Italiens condamnés dans le sud-ouest de la France. Ces faits suggèrent que l’exemplarité est loin d’avoir une action illimitée. Dans un tout autre ordre de faits, est-ce que les pêcheurs, les marins, les mineurs, les aviateurs ont jamais abandonné leur métier, malgré la mort qui les menace à tout instant dans leur vie professionnelle ? Certes, l’intimidation ne s’exerce plus ici sur des criminels, mais ne s’agit-il pas toujours d’une menace aussi terrible que la peine de mort légale? Le châtiment n’empêche donc le crime que dans une mesure beaucoup plus restreinte que nous ne le croyons de prime saut. Le criminel est un joueur et comme tous les joueurs ne pense même pas qu’il puisse perdre la partie ; s’il y pense il s’en moque. L’éducation et le bien-être font seuls diminuer la criminalité, la férocité des peines est inutile.
Quand la peine des travaux forcés fut légiférée, on dut se demander, du moins je le pense, de quels travaux il s’agirait ? Le Prince président, dans son décret du 27 mars 1852, emploie les condamnés aux travaux de colonisation. Le législateur de 1854 les emploie aux travaux les plus pénibles de la colonisation. Trouvant ce superlatif insuffisant, celui de 1891 ajoute l’adverbe à l’adjectif, et les condamne aux travaux les plus particulièrement pénibles.
 La nouvelle législation de 1925 a supprimé l’adverbe de ses textes. Seuls les condamnés du camp d’amendement sont astreints aux travaux les plus pénibles. Tout cela, ce ne sont que des mots inutiles, c’est toujours la vindicte aveugle qui va son train. Tous ces faiseurs de lois et de décrets ne se sont pas souciés de savoir si seulement il y aurait des travaux à faire dans les pays qu’ils assignaient à la transportation. Ils se sont dit : légiférons d’abord, ensuite l’exécutif se débrouillera. Aussi bien ce qui se passa dans la suite montra l’esprit dans lequel la loi fut faite et fut comprise, et, en 1897, la Guyane où tout travail, quel qu’il soit, est particulièrement pénible aux hommes originaires des pays tempérés, fut fixée à l’exclusion de toute autre colonie, comme lieu de transportation. Les travaux que les condamnés devaient y faire, nous les connaissons. Ils ont pu être utiles exceptionnellement, mais toujours ils ont visé à produire le harassement moral du condamné et à détruire sa santé. Quant à l’entreprise de colonisation, elle fut en Guyane un échec lamentable. Elle ne pouvait réussir que dans des contrées vierges et inhabitées où l’européen peut s’acclimater et fonder une famille. La Guyane ne réalise pas les conditions de salubrité suffisante pour que la colonisation pénale y réussisse. Aussi bien l’échec des concessions fut-il piteux. Le nombre des condamnés arrivés à la première classe est toujours dix fois supérieur à celui des places en assignation disponibles et quarante fois supérieur à celui des lots de terrain mis en concession. Tout le terrain pénitentiaire pourtant pourrait être concédé par parcelles, et aucun texte ne limite le nombre des concessions à accorder aux transportés. D’ailleurs, pour ce que font les concessionnaires et en raison de l’impossibilité dans laquelle ils sont de mieux faire, l’administration fait peut-être aussi bien de ne pas étendre le terrain concédé. Mais alors que devient la loi de 1854 ? Les décrets de 1925 n’ont pu modifier cet état de choses. On a bien créé les élèves concessionnaires. Ceux-ci sous la conduite d’un surveillant doivent débrousser une parcelle de terre pendant six mois avant d’obtenir la concession. Tous, avant les six mois, ont perdu patience et demandé à être relevés pour redevenir plantons, garçons ou jardiniers dans les jardins de l’Administration pénitentiaire. Ces pauvres diables se seront tués de fatigue et auront déblayé le terrain pour que, dans la suite, un ou deux privilégiés bénéficient, moyennant finances, du fruit de leur peine.
La nouvelle législation de 1925 a supprimé l’adverbe de ses textes. Seuls les condamnés du camp d’amendement sont astreints aux travaux les plus pénibles. Tout cela, ce ne sont que des mots inutiles, c’est toujours la vindicte aveugle qui va son train. Tous ces faiseurs de lois et de décrets ne se sont pas souciés de savoir si seulement il y aurait des travaux à faire dans les pays qu’ils assignaient à la transportation. Ils se sont dit : légiférons d’abord, ensuite l’exécutif se débrouillera. Aussi bien ce qui se passa dans la suite montra l’esprit dans lequel la loi fut faite et fut comprise, et, en 1897, la Guyane où tout travail, quel qu’il soit, est particulièrement pénible aux hommes originaires des pays tempérés, fut fixée à l’exclusion de toute autre colonie, comme lieu de transportation. Les travaux que les condamnés devaient y faire, nous les connaissons. Ils ont pu être utiles exceptionnellement, mais toujours ils ont visé à produire le harassement moral du condamné et à détruire sa santé. Quant à l’entreprise de colonisation, elle fut en Guyane un échec lamentable. Elle ne pouvait réussir que dans des contrées vierges et inhabitées où l’européen peut s’acclimater et fonder une famille. La Guyane ne réalise pas les conditions de salubrité suffisante pour que la colonisation pénale y réussisse. Aussi bien l’échec des concessions fut-il piteux. Le nombre des condamnés arrivés à la première classe est toujours dix fois supérieur à celui des places en assignation disponibles et quarante fois supérieur à celui des lots de terrain mis en concession. Tout le terrain pénitentiaire pourtant pourrait être concédé par parcelles, et aucun texte ne limite le nombre des concessions à accorder aux transportés. D’ailleurs, pour ce que font les concessionnaires et en raison de l’impossibilité dans laquelle ils sont de mieux faire, l’administration fait peut-être aussi bien de ne pas étendre le terrain concédé. Mais alors que devient la loi de 1854 ? Les décrets de 1925 n’ont pu modifier cet état de choses. On a bien créé les élèves concessionnaires. Ceux-ci sous la conduite d’un surveillant doivent débrousser une parcelle de terre pendant six mois avant d’obtenir la concession. Tous, avant les six mois, ont perdu patience et demandé à être relevés pour redevenir plantons, garçons ou jardiniers dans les jardins de l’Administration pénitentiaire. Ces pauvres diables se seront tués de fatigue et auront déblayé le terrain pour que, dans la suite, un ou deux privilégiés bénéficient, moyennant finances, du fruit de leur peine.
Le travail pénal fut d’abord obligatoire et gratuit Le législateur de 1880 qui eut la témérité de créer le salaire des condamnés vit son œuvre détruite neuf ans plus tard par la féroce commission des treize. Les auteurs du décret de 1889 pensèrent avec raison que la paresse conduit au crime et que le travail régénère mais ils ne comprirent pas que le seul travail doué de ce pouvoir réformateur était le travail qu’on paye. Voulant redresser cette erreur, le législateur de 1925 rémunère le travail, mais sa rémunération reste théorique. En réalité le travail, rémunéré pour la forme, reste pratiquement gratuit. Notre régime pénal fait tout pour dégoûter les condamnés du travail au lieu de les y ramener. Il les en dégoûte en les frustrant du bénéfice sans lequel le travail n’est plus le travail, mais le dernier des supplices. Il ne leur montre pas le travail sous son vrai jour, le leur rend odieux et manque du même coup le but rééducateur qu’il prétend poursuivre. Il manque aussi le but utilitaire. Pour obtenir une production forte il faut intéresser le travailleur à la production. Le seul moyen est de le payer. L’intérêt personnel seul déclenche l’activité humaine, celle des forçats comme celle des autres hommes. Ici encore on peut regretter que la vindicte ait posé son bandeau sur les yeux du législateur qui a voulu par la contrainte et le châtiment obtenir ce qu’il était raisonnable, possible et moins onéreux d’obtenir par le salaire.
Le travail est forcé, le nom de la peine le dit. Il y a peu d’années encore, le condamné qui se refusait au travail était battu, et cela se comprend car les punitions corporelles sont le corollaire obligatoire des travaux forcés. C’est bien pour cela que le premier règlement sur la discipline prévu par la loi de 1854 mit vingt-cinq ans à paraître. Pendant tout ce temps-là, la bastonnade sévissait toujours. En 1880 le forçat délivré du fouet reçut un salaire qu’il perdit en 1889 mais resta délivré du fouet. Travaillé par la nostalgie de la chicote, ce même législateur qui n’osait rétablir la bastonnade, créa pour la remplacer le délit de refus de travail, qu’il punit de six mois à deux ans d’emprisonnement spécial ou de réclusion cellulaire selon que le délinquant serait un condamné à temps ou à perpétuité. Je me demande vraiment pourquoi ce refus de travail a tant préoccupé le législateur de 1889. Cette infraction est bien rare. Je me suis même quelquefois demandé si elle existait. Bien que je ne me dissimule pas ce qu’il y a de paradoxal en apparence à s’élever contre cette crainte du refus de travail, je n’hésite pas à déclarer qu’elle est mal fondée. Pour ma part, je n’ai jamais vu pendant les deux ans que j’ai passés dans les pénitenciers un homme valide qui se soit rendu coupable de cette infraction. Toute audacieuse que cette affirmation puisse paraître elle est pourtant le résultat d’une longue observation. Les statistiques du parquet de la juridiction spéciale mentionnent bien quelques condamnations pour refus de travail, mais il est à remarquer combien elles sont rares : il y en a suivant les années de une à cinq pour cent condamnations. Il est à remarquer aussi combien les inculpés de refus de travail sont souvent acquittés. D’autre part, les livrets de certains condamnés portent de très nombreuses punitions disciplinaires motivées par la mauvaise volonté au travail, mais cette mauvaise volonté s’explique par le manque d’intérêt d’un travail improductif, l’état de santé ou les provocations d’un chef de corvée. Il n’y a pas là, à proprement parler, refus de travail. Le condamné sain de corps et d’esprit qui par pure paresse dit « Je ne veux pas travailler » et persiste dans sa volonté de se croiser les bras après les sommations préalables exigées par le décret de 1889, n’existe pas. Toutes les infractions qui m’ont été présentées comme refus de travail et ont mené leurs auteurs devant le Tribunal maritime spécial procédaient de tout autres mobiles que de la volonté pure de ne rien faire. Quelquefois le refus de travail était le fait d’un déséquilibré. Plus souvent c’étaient des impotents à qui on demandait un travail au-dessus de leurs forces et que le tribunal avait souvent acquittés. Souvent aussi c’étaient des hommes qui avaient commis l’infraction en toute connaissance de cause, uniquement pour provoquer les conséquences de l’infraction et quitter ainsi un pénitencier ou un chantier où ils ne se sentaient plus en sûreté. Raisonnablement on ne peut considérer ces cas comme des refus de travail engendrés par la paresse et l’indiscipline. On ne voit d’ailleurs pas pourquoi un forçat valide refuserait le travail. Lorsque la population pénale est obligée de rester enfermée deux jours de suite, à l’occasion de jours fériés, elle s’ennuie à mourir, et quand un condamné est mis en détention préventive la première des choses qu’il sollicite c’est d’aller au travail. Autrefois, quand par défaut de main-d’œuvre on faisait appel aux hommes punis de cachot, jamais ceux-ci, Lien qu’ayant le ventre vide deux jours sur trois, ne refusaient d’aller travailler alors qu’ils auraient pu le faire sans encourir la moindre répression. Je crois que les condamnations pour refus de travail, rares d’ailleurs, sont à peu près toutes sujettes à critique. Un exemple : En 1906, onze forçats enlevèrent un canot de service en plein jour et partirent à force de rames. Les canotiers furent requis pour leur donner la chasse. Six refusèrent. Poursuivis pour refus de travail le Tribunal les condamna. Ce n’était pourtant pas un refus de travail. Le respect humain était l’élément constitutif du refus, non la paresse. Les juges furent peut-être de cet avis, mais ils estimèrent qu’en droit strict il fallait condamner et que l’exemplarité l’exigeait. En somme, je ne m’explique pas le caractère de gravité exceptionnelle que les rédacteurs du décret du 5 octobre 1889 ont attribué au refus de travail. Il est possible que par automorphisme psychologique ces treize cérébraux rebelles à tout travail physique n’aient pu concevoir le travail sans coup de chicote. Regrettant la bastonnade, qui n’est pas remplaçable, ils ont demandé au droit spécial, qui est toujours un mauvais conseiller, de les tirer d’embarras et là encore ils ont fait une bien mauvaise besogne qui a été respectée par le législateur de 1925.
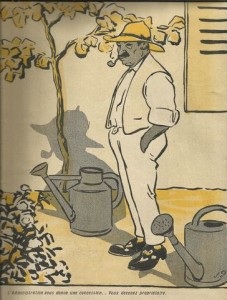 A la vérité, si on veut, chose stupide, obtenir un travail maximum, égal et soutenu de tous les condamnés, quels qu’ils soient, malingres, vigoureux, impotents, vieux ou déséquilibrés, il est incontestable que les châtiments corporels s’imposent. L’autorité déraisonnable demande à la force ce que la raison sait bien ne pouvoir obtenir. Nos législateurs soucieux de conserver la peine des travaux forcés qui, de leur avis, tient si bien sa place dans l’échelle des peines criminelles entre la réclusion et la mort, se sont ingéniés chaque fois que la mise en œuvre d’un châtiment corporel leur échappait, à remplacer immédiatement ce châtiment par un autre plus dur bien que considéré comme non corporel, et à créer des crimes et des délits spéciaux justiciables de ces nouveaux châtiments. Ces crimes et ces délits sont la voie de fait sur les agents, le refus de travail et l’évasion, auxquels s’ajoutent pour les libérés un délit de vagabondage qui ne ressemble à rien quant à ses éléments constitutifs au vagabondage de droit commun. Quant aux peines destinées à remplacer les châtiments corporels, l’une d’elles est la réclusion cellulaire qui dépasse en cruauté tout ce qui peut s’imaginer. Quand elle fut applicable, nombre de forçats condamnés à la double chaîne demandèrent que la réclusion ne leur soit pas appliquée. Ils préféraient de beaucoup la peine ancienne à la nouvelle. M. Guyot-Dessaignes, garde des sceaux, refusa. « …. La double chaîne, écrivit-il, a été supprimée parce qu’elle a été considérée comme inhumaine, de nature à froisser le sentiment public. La réclusion cellulaire lui a été substituée comme plus douce, plus appropriée aux idées modernes. Cette situation est acquise quel que soit le sentiment des condamnés… » Quelques mois après – décembre 1907 – M. Milliès-Lacroix, ministre des Colonies, jugea les choses plus sainement : « …. J’ai été amené à constater, écrit-il, que si en théorie et en droit la peine de la réclusion cellulaire simplement privative de la liberté est considérée comme étant plus douce que celle de la double chaîne, peine corporelle, il en est autrement en fait… » Une peine corporelle implique, dans l’esprit du public, des coups donnés par un bourreau, ou de lourdes entraves qui sans cesse vous obsèdent. La définition des peines corporelles mérite d’être élargie. La mise à la boucle dont l’administration pénitentiaire a fait jusqu’en 1926 un si honteux abus est bien un châtiment corporel. Qu’étaient le cachot, le camp disciplinaire, que sont encore aujourd’hui la cellule effective et la réclusion cellulaire sinon des attentats inutiles à la santé, partant des châtiments barbares et essentiellement corporels ? Pas plus que la mort ne suit fatalement et à très brève échéance l’exil en Guyane, la douleur physique, celle qui arrache un cri, ne suit les abominables claustrations du cachot et de la réclusion cellulaire. C’est pourquoi ces peines paraissent au public plus humaines que le fouet et la traîne du boulet. Le public n’accorde sa compassion que quand ses réflexes sont vivement sollicités, quand il entend des cris de douleur ou voit un malheureux traîner sans trêve la lourde chaîne, mais il ne sait pas fixer son attention sur les lentes agonies. Nos doux législateurs en profitent pour dissimuler sous des apparences de, progrès et d’humanité des peines nouvelles d’une savante cruauté, mais qui, suivant le mot cynique de M. Guyot-Dessaignes, ne sont pas inhumaines pour le public.
A la vérité, si on veut, chose stupide, obtenir un travail maximum, égal et soutenu de tous les condamnés, quels qu’ils soient, malingres, vigoureux, impotents, vieux ou déséquilibrés, il est incontestable que les châtiments corporels s’imposent. L’autorité déraisonnable demande à la force ce que la raison sait bien ne pouvoir obtenir. Nos législateurs soucieux de conserver la peine des travaux forcés qui, de leur avis, tient si bien sa place dans l’échelle des peines criminelles entre la réclusion et la mort, se sont ingéniés chaque fois que la mise en œuvre d’un châtiment corporel leur échappait, à remplacer immédiatement ce châtiment par un autre plus dur bien que considéré comme non corporel, et à créer des crimes et des délits spéciaux justiciables de ces nouveaux châtiments. Ces crimes et ces délits sont la voie de fait sur les agents, le refus de travail et l’évasion, auxquels s’ajoutent pour les libérés un délit de vagabondage qui ne ressemble à rien quant à ses éléments constitutifs au vagabondage de droit commun. Quant aux peines destinées à remplacer les châtiments corporels, l’une d’elles est la réclusion cellulaire qui dépasse en cruauté tout ce qui peut s’imaginer. Quand elle fut applicable, nombre de forçats condamnés à la double chaîne demandèrent que la réclusion ne leur soit pas appliquée. Ils préféraient de beaucoup la peine ancienne à la nouvelle. M. Guyot-Dessaignes, garde des sceaux, refusa. « …. La double chaîne, écrivit-il, a été supprimée parce qu’elle a été considérée comme inhumaine, de nature à froisser le sentiment public. La réclusion cellulaire lui a été substituée comme plus douce, plus appropriée aux idées modernes. Cette situation est acquise quel que soit le sentiment des condamnés… » Quelques mois après – décembre 1907 – M. Milliès-Lacroix, ministre des Colonies, jugea les choses plus sainement : « …. J’ai été amené à constater, écrit-il, que si en théorie et en droit la peine de la réclusion cellulaire simplement privative de la liberté est considérée comme étant plus douce que celle de la double chaîne, peine corporelle, il en est autrement en fait… » Une peine corporelle implique, dans l’esprit du public, des coups donnés par un bourreau, ou de lourdes entraves qui sans cesse vous obsèdent. La définition des peines corporelles mérite d’être élargie. La mise à la boucle dont l’administration pénitentiaire a fait jusqu’en 1926 un si honteux abus est bien un châtiment corporel. Qu’étaient le cachot, le camp disciplinaire, que sont encore aujourd’hui la cellule effective et la réclusion cellulaire sinon des attentats inutiles à la santé, partant des châtiments barbares et essentiellement corporels ? Pas plus que la mort ne suit fatalement et à très brève échéance l’exil en Guyane, la douleur physique, celle qui arrache un cri, ne suit les abominables claustrations du cachot et de la réclusion cellulaire. C’est pourquoi ces peines paraissent au public plus humaines que le fouet et la traîne du boulet. Le public n’accorde sa compassion que quand ses réflexes sont vivement sollicités, quand il entend des cris de douleur ou voit un malheureux traîner sans trêve la lourde chaîne, mais il ne sait pas fixer son attention sur les lentes agonies. Nos doux législateurs en profitent pour dissimuler sous des apparences de, progrès et d’humanité des peines nouvelles d’une savante cruauté, mais qui, suivant le mot cynique de M. Guyot-Dessaignes, ne sont pas inhumaines pour le public.
En somme la peine des travaux forcés d’aujourd’hui n’est ni plus efficace, ni plus moralisatrice, ni moins dispendieuse, ni beaucoup moins inhumaine que l’ancienne, comme le promettait le message de Louis-Napoléon. Le bagne d’aujourd’hui porte l’empreinte des galères et des bagnes des ports de guerre. Le lieu d’exécution de la peine a seul changé. C’était folie de demander à une peine aussi afflictive d’être réformatrice. Une peine ne peut être réformatrice que si elle est peu afflictive. Si on veut amender les criminels, il n’y a pas lieu d’aggraver leurs peines à l’extrême. La proportionnalité des peines aux crimes est encore un de ces principes qu’il faut savoir ne pas pousser trop loin. On ne voit vraiment pas, quand on a mis un criminel en prison, ce qu’on peut lui faire de plus. Si proportionnaliste qu’on soit, il faut bien admettre que, passé un certain degré, les peines ne peuvent plus suivre dans leur ascension l’énormité des crimes. Au-delà d’un certain poids la balance de Thémis ne peut plus servir. Il semble donc que la prison suffise à tout criminel qui n’est pas condamné à la peine de mort, et par prison j’entends non pas les cellules inhumaines de l’île de Saint-Joseph, mais la prison conforme à toutes les exigences de l’hygiène, dans laquelle le condamné sous la direction d’agents honnêtes et de quelque valeur technique fasse un travail qui lui rapporte et puisse en dehors de ses heures de travail se distraire sainement et s’instruire. Que les partisans de l’expiation et de l’intimidation se rassurent ! La prison, si humaine que puisse la faire un état civilisé, a de quoi assouvir les plus légitimes vindictes ! Au moins le criminel comprendra que si la société l’a privé d’une liberté qu’il employait à lui nuire, elle ne le traite pas comme un infâme dont elle veut la perte mais au contraire l’aide à supporter sa peine et lui laisse un espoir.
Cette méthode ne peut avoir que d’heureux résultats. Elle seule permet de résoudre le problème de la libération. Le libéré qui a été maltraité en cours de peine est toujours une épave. Celui qui, dès le premier jour de son incarcération a été traité comme un homme, préparé au travail et maintenu en santé, peut vivre en liberté sans récidiver. Si les libérés des travaux forcés donnent quelquefois des mécomptes, c’est qu’après avoir subi la plus inhumaine des peines, ils se trouvent jetés dans un petit pays où jamais ils ne cessent d’être marqués d’infamie. Ils ont beau avoir fini leur temps de séjour au pénitencier, ils sont toujours pour le public le criminel. Libérés en France, ils pourraient se perdre dans la foule, échapper à cette réprobation si pénible et trouver du travail. J’ai connu des forçats qui sont restés dehors de nombreuses années – l’un d’eux dix-sept ans ! – et n’ont jamais commis la moindre infraction. Il a fallu pour qu’ils reviennent au bagne une dénonciation ou une circonstance banale qui les oblige à déclarer leur identité. De nombreux évadés se sont établis dans les Etats de l’Amérique centrale, et y ont prospéré. Ces anciens forçats se sont ressaisis, parce que personne n’était plus là pour leur rappeler leur passé. Ce sont là des preuves que, tout au moins pour un bon nombre de libérés, il suffirait de n’être plus considéré comme un criminel pour redevenir sociable. Il y a tout lieu de croire que, du jour où le régime pénal inhumain et corrupteur d’aujourd’hui sera remplacé par un emprisonnement convenablement compris, où le condamné en cours de peine se sentira secouru au lieu d’être méprisé, la libération sera beaucoup moins à craindre.
Je sais bien que pour le commun des hommes la notion de justice se confond avec le plaisir de la vengeance. Il en sera sans doute toujours ainsi. Mais la vengeance est aveugle et mauvaise conseillère. L’école pénitentiaire moderne n’en fait plus aucun cas. Elle rejette aussi l’expiation, cruelle sans profit, et se refuse à poursuivre un repentir qui échappe à toute mesure. Elle part de ce principe que ce n’est pas pour ce que le criminel a fait, mais bien pour ce qu’il est et ce qu’il pourrait faire qu’on le met en prison. Elle soutient que la peine doit être appropriée au criminel et non à son crime. Elle assimile le criminel à un égaré qu’on peut ramener ou à un malade qu’on doit traiter jusqu’à guérison. En France ces idées pénologiques nouvelles sont accueillies par nos auteurs avec intérêt, quelquefois avec admiration, mais restent l’objet de discussions théoriques. A l’étranger elles prennent racine et sont quelquefois consacrées par des lois. Ici c’est la construction d’une prison d’où l’ancien système de la terreur est complètement exclu, là la création de prisons en plein air en vue de supprimer la cruauté du régime cellulaire. Ailleurs la multiplication des peines est jugée comme un trompe-l’œil onéreux et stérile, et le système répressif est simplifié. Autre part – Brésil, pays limitrophe de notre Guyane – les mots « Institution de régénération » dont le sens est significatif sont écrits au-dessus de la porte d’un grand pénitencier. Il est incontestable que sous l’influence de l’école italienne et de son éminent maître Enrico Ferri les pays civilisés seront tôt ou tard amenés à ne plus chercher la mesure de la faute morale pour ne plus s’attacher qu’à la défense sociale et à la rééducation ou au traitement des délinquants. Malheureusement ils se sont montrés jusqu’ici plus velléitaires que réalisateurs. En Italie même le grand projet de réforme de droit pénal préconisé par Enrico Ferri a rencontré de nombreux détracteurs et n’a pu s’imposer. Notons cependant que depuis vingt ans déjà ce pays possède, annexés à quelques-unes de ces prisons, des services d’anthropologie criminelle. Dans ce sens la Belgique donne un bel exemple. Sans modifier les assises de son droit ni la lettre de son code, elle opère par voie administrative un remaniement assez complet de son système pénitentiaire. Depuis 1920 les services psychiatriques annexés à ses quatre prisons principales recherchent systématiquement les condamnés anormaux. Ceux-ci suivent des traitements appropriés à leur état de santé. Les débiles et les épileptiques sont envoyés à un asile et soumis à leur libération au contrôle d’un organisme de patronage et de réadaptation sociale. Si leurs tendances antisociales persistent ils sont maintenus dans l’asile spécial traités et non punis. Une prison sanatorium pour les tuberculeux a été créée. Enfin, à l’inverse de ce qui se passe dans nos maisons de force où le travail imposé aux condamnés n’a aucun caractère éducatif, le travail des détenus de toutes catégories est organisé en vue de leur relèvement moral. Nul doute que la Belgique, et d’autres pays à sa suite, n’arrivent un jour, par voie de réformes régulièrement poursuivies à une solution meilleure du problème pénitentiaire. La Russie qui, à la faveur de la révolution, détruisit en même temps que toutes les institutions juridiques du tzarisme son ancien système pénitentiaire, a pu envisager le problème dans son ensemble et poser les principes fondamentaux d’une œuvre entièrement nouvelle. Pendant la longue guerre civile qui suivit la révolution d’octobre, le pouvoir soviétique, occupé à défendre ses conquêtes dut, en l’absence de toute loi écrite, faire confiance aux juges ouvriers et paysans de ses tribunaux révolutionnaires. Lorsque la guerre civile s’apaisa, le nouveau droit russe fondé, comme d’ailleurs le droit de tous les pays, sur la force, mais au profit du seul prolétariat devenu classe unique et souveraine, s’inscrivit dans des codes. Promulgué en 1922, puis révisé, corrigé et complété, le code pénal russe reparut le 1er janvier 1927 pour être mis en vigueur dans la plus grande des républiques fédérées. Ce code fait table rase de la vieille conception de la souffrance essence de toute peine. C’est là un fait remarquable et nouveau dans l’histoire du droit pénal, car il faut convenir que c’est de la loi du talion que dérivent encore aujourd’hui toutes nos peines judiciaires, et c’est bien la première fois depuis que le monde est monde qu’un code, rompant avec les vieux usages, se refuse à châtier et se propose de corriger. Quand on a vu ce qu’était le régime disciplinaire dont j’ai fait ici le procès, on éprouve une satisfaction mêlée d’espérance à lire l’article 9 du code soviétique que voici : « Les mesures de défense sociale ne peuvent avoir pour objet d’infliger des souffrances physiques ou de ravaler la dignité humaine, et elles ne se proposent pas d’exercer une vengeance ou d’exercer un châtiment ». Ces lignes sont pleines de promesses. La défense sociale s’appuie désormais sur la prévention des crimes et l’isolement des criminels qu’il faut séparer de la société en vue de leur amendement. C’est le traitement médical s’il s’agit de malades, pédagogique s’il s’agit de mineurs. Les criminels adultes sont corrigés par la bienfaisante influence du travail. A cet effet a été rédigé un « Code de Correction par le travail » qui fixe les modalités d’application des jugements comportant la détention. Celle-ci n’ayant plus pour objet de causer des souffrances physiques ne saurait être prolongée, La législation soviétique rejette les détentions supérieures à dix ans car, plus longues, elles aboutiraient nécessairement à des souffrances physiques. Les prisonniers sont éclairés sur leurs droits et leur situation juridique. Leur droit de se plaindre ne doit être aucunement limité. « Les occupations (Art. 51 du Code de Correction par le travail) imposées aux détenus, ont un caractère éducatif et moralisateur, elles ont pour objet de les accoutumer au travail et, en les instruisant dans une profession, de leur permettre de vivre d’une vie laborieuse lorsqu’ils sortiront du lieu de détention ». Le détenu, en toute circonstance, a droit à son salaire qui est établi par le Commissariat du travail. Un bon rendement dans son travail lui rapporte une réduction de peine et la possibilité de recouvrer sa liberté avant l’expiration du terme fixé par la loi l’incite à se corriger. L’instruction et l’éducation qui lui sont données ont pour objet de relever son niveau intellectuel et sa conscience civique. Aucun châtiment corporel. L’usage de la parole et du tabac sont autorisés sans restriction. Ajoutons que la politique soviétique s’efforce d’appliquer à la majorité des condamnés la peine du travail obligatoire sans privation de liberté ; le condamné n’est pas enfermé ; il est seulement tenu de travailler à un endroit déterminé, le plus souvent dans des colonies spécialement aménagées où il jouit d’une complète liberté de circulation à l’intérieur, et d’où il peut, dans certains cas, sortir en congé. Enfin le code criminel précise que la compensation d’une amende par l’emprisonnement ou de l’emprisonnement par l’amende jugée comme un abus – avec raison – ne peut être admise en aucun cas. Toutes ces dispositions sont humaines au plus haut point.
 Nous avons déjà dit qu’il ne suffit pas pour connaître un régime pénal de connaître les textes qui s’y rapportent, tellement l’application pratique peut pour mille causes diverses d’ordre matériel, moral ou social, tromper les vues du législateur. Il faudrait donc pour porter un jugement sur les diverses méthodes pénitentiaires les voir longtemps à l’œuvre en toute liberté, ce qui est difficilement réalisable, et ne pas se contenter de lire des textes de lois, ni surtout les rapports faits dans les congrès. Néanmoins il paraît clair que de loyaux essais sont tentés dans plusieurs pays étrangers pour moderniser et moraliser la pratique pénitentiaire tandis que chez nous la vieille méthode d’élimination reste souveraine.
Nous avons déjà dit qu’il ne suffit pas pour connaître un régime pénal de connaître les textes qui s’y rapportent, tellement l’application pratique peut pour mille causes diverses d’ordre matériel, moral ou social, tromper les vues du législateur. Il faudrait donc pour porter un jugement sur les diverses méthodes pénitentiaires les voir longtemps à l’œuvre en toute liberté, ce qui est difficilement réalisable, et ne pas se contenter de lire des textes de lois, ni surtout les rapports faits dans les congrès. Néanmoins il paraît clair que de loyaux essais sont tentés dans plusieurs pays étrangers pour moderniser et moraliser la pratique pénitentiaire tandis que chez nous la vieille méthode d’élimination reste souveraine.
Nos hommes les plus avertis en droit pénal, légistes, magistrats, avocats, administrateurs, s’inclinent presque tous devant cette méthode. Ils se réclament de la Rome antique, de la relegatto in insula. Ils opposent aux adversaires du régime actuel la dureté de l’encellulement perpétuel, comme si la perpétuité s’imposait pour tous les crimes, comme si aucun moyen terme n’existait entre nos travaux forcés actuels et l’encellulement. Ce qu’ils veulent, c’est éliminer les criminels. Ceux-ci, de ce fait, perdent tout intérêt, et c’est dans leur abandon définitif à une administration qui n’a d’autre rôle que d’assister froidement à leur disparition progressive que nous devons ce que les uns appellent les bienfaits, ce que nous appelons les crimes de cette administration.
Et vous, théoriciens de la transportation, Léveillé, Emile Garçon et autres maîtres de l’école néo-classique, vous avez les bagnes que vous avez voulus. Quand un de vos élèves s’indigne des abus commis au bagne, je cherche en vain la part de sincérité qui entre dans cette indignation. Un des membres de la Commission composée de magistrats et de hauts fonctionnaires qui, en 1924, étudia le problème de la transportation, avocat général à la Cour d’appel de Paris, se rendit à cette époque au pénitencier de Saint-Martin-de-Ré. Il voulait étudier les conditions de promiscuité dans lesquelles se trouvaient les condamnés aussitôt après leur condamnation. Je lui passe la parole :
« Le hasard, dit cet avocat général, me fit monter à La Rochelle dans le même compartiment que sept ou huit individus portant un uniforme que je ne connaissais pas, avec une bande bleue au pantalon et de gros galons aux manches, armés de grands sabres et de revolvers énormes, qui, causant bruyamment, avaient l’air de sous-officiers en goguette. Je ne tardai pas à comprendre que c’étaient des gardiens ; j’ai écouté leurs conversations et je fus effrayé de la bassesse des sentiments et du manque de conscience que révélaient leurs paroles. « Il faut les terroriser immédiatement » tel est le mot d’ordre qu’ils se passaient. Nul sentiment de leurs fonctions, nulle idée de l’importance du devoir social qu’ils ont à accomplir.
J’entends bien qu’on ne peut pas choisir ces hommes parmi les anciens ambassadeurs et que le bagne, par son climat et son ambiance a une influence délétère sur les plus honnêtes gens, mais ne pourrait-on faire comprendre à ces gardiens qu’il y a parmi les condamnés des individus dignes d’intérêt, victimes de leur atavisme et de leur milieu ; peut-être pourrait-on leur commenter ces mots de François de Curel : « Les croix tombent du ciel et ne choisissent pas les épaules sur lesquelles elles tombent ». Si on arrivait ainsi à leur faire acquérir une conception plus digne de leurs fonctions on pourrait espérer de la transportation de meilleurs résultats ».
Eh bien, monsieur l’avocat général, j’ai les plus grandes difficultés à vous croire sincère. « Terrorisons-les ! » N’est-ce pas là l’esprit même de la loi, n’est-ce pas là ce que vous voulez ? Est-ce que vous, magistrat debout, revêtu de votre robe noire, n’êtes pas au haut de la hiérarchie, ce qu’est plus bas le surveillant au grand sabre, l’incarnation de la terreur légale ? Et quand, au retour de votre voyage à Saint-Martin-de-Ré où vous aviez étudié les déplorables résultats de la promiscuité des condamnés, devenu législateur, vous rédigeâtes l’article 1er du premier décret du 18 septembre 1925 sur le régime disciplinaire, que fîtes-vous sinon imposer au début de la peine des Travaux forcés un encellulement absolu d’un an avant l’embarquement, c’est-à-dire ajouter à une peine qui suffisait déjà à tuer son homme un peu plus de terreur ?
Lors de cette même visite à Saint-Martin-de-Ré vous fûtes reçu par le directeur qui vous parut « un excellent homme faisant tout ce qu’il est humainement possible de faire pour les condamnés ». Monsieur l’avocat général, depuis 1854, les Gouverneurs des colonies pénitentiaires, les chefs du Service judiciaire, les magistrats en mission – je ne dis pas les inspecteurs – ont toujours vu dans les commandants de pénitencier ou chefs de camp chez qui les menaient leurs devoirs professionnels, d’excellents hommes faisant tout ce qui est humainement possible pour les condamnés, et qu’il eût été discourtois et injuste de rendre responsables de la triste condition de leurs administrés. Ceux-là aussi, comme vous, ont rendu responsables des erreurs d’un système les surveillants, éternels boucs émissaires. Or nous les connaissons les défauts des surveillants, mais l’avancement de ces fonctionnaires n’est-il pas en raison de ces défauts qui sont pour leurs chefs les plus essentielles qualités professionnelles ? Quels sont ceux qui avancent, sinon les plus mouchards, les plus terribles ? C’est bien mal reconnaître les services rendus que jeter la pierre à des agents qui sont ce que leurs chefs les ont fait. Et puis, n’est-ce pas la loi, qui, par le rite ridicule de la prestation de serment, permet à ces chefs, couverts par la parole désormais sacrée d’hommes à tout faire, de rester sourds aux appels de la détresse et de sévir en aveugles ? Pourquoi dès lors reprocher à de fidèles auxiliaires de faire ce qui leur est demandé ? Car, il faut l’affirmer, rejeter sur les fonctionnaires chargés de l’exécution les erreurs de la loi, c’est éluder le problème pénal et renoncer à toute réforme. C’est bien pour avoir adopté cette attitude que le législateur de 1925 s’est contenté d’apporter des modifications discrètes là où s’imposait une réforme d’envergure. Il a supprimé le cachot noir et les fers, le pain sec et le lit de camp. Ces suppressions qui s’imposaient avec urgence font honneur au rédacteur du second décret sur le régime disciplinaire, mais n’ont rien changé au caractère fondamental de la peine qui reste ce qu’elle a toujours été, uniquement et très efficacement éliminatrice. Après avoir délivré le condamné en cours de peine de quelques sévices, le législateur de 1925 estima sa tâche terminée. Il ne fît rien pour le tirer de sa condition de paria exploité et corrompu par des méthodes pénitentiaires immorales. La peine finie, que pouvait-il faire d’un homme révolté par les injustices subies et maintenu dans l’erreur par les mauvais exemples reçus ? Le laisser végéter et mourir en Guyane. L’obligation à la résidence fut respectée. La méthode éliminatrice était une fois de plus consacrée.
En 1924 sur 6.243 transportés 485 meurent, soit 7,77 %
|
Aujourd’hui comme autrefois le libéré, sans ressources, sans travail, sans aide, contraint au vagabondage, n’a devant lui d’autres alternatives que les camps de la Relégation ou les hôpitaux de la Transportation et leurs annexes, asile d’aliénés, léproserie, camp d’incurables. Tôt ou tard, à moins qu’il ne s’évade, il meurt victime du climat et de la faim. Le comité de patronage institué par le décret qui termine l’œuvre législative du 18 septembre 1925 ne saurait corriger cette erreur criminelle. Chaque année cinq cents malheureux sont rejetés par les pénitenciers dans un pays grand comme la cinquième partie de la France, riche en puissance si l’on veut, mais insalubre, à peine peuplé et sans industrie. Chaque année aussi douze cents condamnés ou relégués traversent l’océan et remplacent les douze cents hommes morts, évadés ou disparus dans l’année, en sorte que la population pénale totale dépasse rarement le plafond de huit mille deux cents hommes, et c’est là le but. La réforme de 1925 n’a eu aucune influence sur l’effroyable mortalité. Le cachot et les fers, pour cruels qu’ils soient, faisaient souffrir sans faire mourir. De même la perte accidentelle d’une méchante ration alimentaire. Je vais plus loin. La redoutable réclusion cellulaire ne fait périr que quelques unités. A bon compte, je veux dire sans que la statistique obituaire varie d’un iota, le législateur de 1925 aurait pu la supprimer. Il eût paru encore plus humain et la valeur éliminatrice de la peine des travaux forcés n’était en rien compromise, tant il est vrai que les facteurs à peu près exclusifs de la mortalité sont le climat – c’est-à-dire les maladies propres au pays – et la faim. Au reste les chiffres qui suivent sont parfaitement édifiants :
 Plus de dix pour cent par an ! Cependant que la Relégation, peine réputée moins afflictive et qui n’est pas comprise dans les chiffres ci-dessus, a une mortalité qui excède tous les ans dix pour cent et donne pour l’année 1927 entre autres le chiffre de 11,45 % avec 178 décès sur 1.553 hommes.
Plus de dix pour cent par an ! Cependant que la Relégation, peine réputée moins afflictive et qui n’est pas comprise dans les chiffres ci-dessus, a une mortalité qui excède tous les ans dix pour cent et donne pour l’année 1927 entre autres le chiffre de 11,45 % avec 178 décès sur 1.553 hommes.
C’est là de l’élimination, et de la meilleure. J’ai peur que ce soit aussi un record et peu glorieux, à mon sens, pour notre pays.
Que faire quand on aura supprimé cette pratique barbare de la transportation ? Nous savons que le même esprit a présidé à la construction de tout le système pénitentiaire français, que les colonies pénitentiaires et correctionnelles pour mineurs corrompent la jeunesse, que les maisons centrales de force ou de correction ne visent nullement à corriger le délinquant et que les prisons affectées aux condamnés à la réclusion transforment ceux-ci en loques humaines de valeur sociale moindre à leur sortie qu’à leur entrée. La suppression du bagne guyanais ne peut donc être que la première tranche d’un vaste programme de rénovation pénitentiaire dans lequel la prophylaxie du crime sera envisagée et le sauvetage des enfants en danger moral basé sur leur instruction et non leur exploitation. Instituer des sanctions en rapport avec les notions nouvelles dont s’est enrichie la science du crible et des criminels. Supprimer les peines perpétuelles. Laisser au criminel condamné l’espoir de recouvrer sa liberté à une échéance sensée, qu’une santé morale incompatible avec la vie sociale peut seule indéfiniment différer, mais qu’il lui appartiendra d’écourter par sa conduite et son travail. Lui enseigner le respect de la personnalité humaine en la respectant chez lui. Reconnaître ses droits. Lui permettre, s’il est lésé, d’obtenir réparation immédiate sans risquer d’être puni ou mal vu. L’instruire et le faire travailler d’une manière productive pour lui et pour la société. Tel est le programme. Il a contre lui la routine, des préjugés tenaces et les doctrines de l’école. Sa réalisation s’imposera de plus en plus sous la pression des idées, des événements et des exemples venus du dehors.
Tags: Administration Pénitentiaire, Alexandre Jacob, amendement, bagne, Belgique, Brésil, cachot, code pénal, crime, criminologie, cruauté, décrets du 18 septembre 1925, double chaîne, du Miral, éducation, élimination, Emile Garçon, enfermement, Enrico Ferri, garde des Sceaux, goulag, gouverneur, Guyane, Guyot-Dessaignes, île Saint Joseph, îles du Salut, Italie, Léveillé, libéré, loi, loi du talion, Louis Napoléon Bonaparte, Louis Rousseau, Milliès-Lacroix, ministre des Colonies, mort, mortalité, prison, psychologie, réforme, régénérer, Rousseau, Russie, Saint Martin de Ré, salaire, santé, souffrir, suppression, travail, Un médecin au bagne, URSS
 Imprimer cet article
Imprimer cet article
 Envoyer par mail
Envoyer par mail

 (6 votes, moyenne: 4,83 sur 5)
(6 votes, moyenne: 4,83 sur 5)