Un témoignage sur les derniers mois de Bakounine
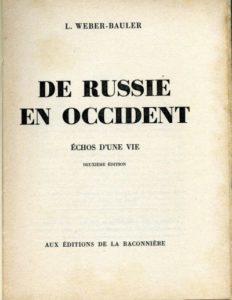 Marianne Enckell, du CIRA de Lausanne, que je remercie chaleureusement, a récemment attiré mon attention sur un témoignage personnel à propos des derniers mois de Bakounine à Lugano. Il s’agit d’une dizaine de pages (p. 107-117) dans le livre de souvenirs de Léon Weber-Bauler (1870-1956), De Russie en Occident. Échos d’une vie, qui fut publié en Angleterre en 1940 et en France en 1943. L’auteur est un médecin français d’origine russe (qui fut aussi l’époux et le père des enfants de la peintre russe Maria Iakountchikova), dont la mère, militante nihiliste au début des années 1870, est venue en Suisse et y a fait la connaissance de Michel Bakounine. C’est moins de l’activité militante de ce dernier qu’il est question dans ce chapitre que de «Papa Bakounine», donc du rapport de Bakounine à ses enfants Carlo, Sofia et Maroussia (nés respectivement en 1868, 1870 et 1873 et dont le père biologique, comme ce fut déjà signalé sur ce blog, n’était autre que Carlo Gambuzzi, avocat napolitain et militant libertaire).
Marianne Enckell, du CIRA de Lausanne, que je remercie chaleureusement, a récemment attiré mon attention sur un témoignage personnel à propos des derniers mois de Bakounine à Lugano. Il s’agit d’une dizaine de pages (p. 107-117) dans le livre de souvenirs de Léon Weber-Bauler (1870-1956), De Russie en Occident. Échos d’une vie, qui fut publié en Angleterre en 1940 et en France en 1943. L’auteur est un médecin français d’origine russe (qui fut aussi l’époux et le père des enfants de la peintre russe Maria Iakountchikova), dont la mère, militante nihiliste au début des années 1870, est venue en Suisse et y a fait la connaissance de Michel Bakounine. C’est moins de l’activité militante de ce dernier qu’il est question dans ce chapitre que de «Papa Bakounine», donc du rapport de Bakounine à ses enfants Carlo, Sofia et Maroussia (nés respectivement en 1868, 1870 et 1873 et dont le père biologique, comme ce fut déjà signalé sur ce blog, n’était autre que Carlo Gambuzzi, avocat napolitain et militant libertaire).
Je ne retranscris pas l’intégralité du chapitre intitulé «Bakounine», mais seulement les cinq dernières pages, où apparaît effectivement le révolutionnaire russe. Ce qui précède cette fin de chapitre raconte comment la mère du narrateur est arrivée en Italie et en est venue à faire la connaissance de Bakounine. Par-delà les approximations et reconstitutions (j’en énumère quelques-unes à la fin de ce billet), cet amusant témoignage donne une assez bonne idée de Bakounine comme parent et (non-)éducateur!
Ma mère alla trouver Bakounine ; les premiers rapports furent assez froids : ma mère, socialiste ardente, n’était pas pour la violence ; Bakounine, lui, était un destructeur farouche, un protagoniste de l’action directe. Mais ce grand combattant de la révolution sociale était vieux, fatigué, malade et un peu déçu. Dès les premières entrevues, il fut frappé par la haute intelligence, la grande culture de ma mère ; aussi, en peu de jours, devint-elle sa confidente et son soutien : « mon Antigone », l’appellera-t-il plus tard.
Mais ce qui attira surtout Bakounine vers ma mère, c’était le souffle russe qu’elle apportait directement au vieil exilé.
− Sacha, lui dira-t-il, sais-tu ce que j’aime le plus en toi? C’est que tu parles le vrai grand-russien et c’est aussi que tu sais me conter comment l’Oka s’épand, au printemps sur les basses prairies ; comment votre jardin fruitier de Niéstérovo se couvrait de fleurs, comment le rossignol russe chantait dans les lilas… Oui, pour moi les temps sont révolus. Ma sœur me disait en mourant : « Ah, Michel, comme il fait bon mourir : on peut enfin s’étendre à son gré ». Voilà ce qu’on peut dire de mieux de la mort.
Un jour, ma mère nous emmena chez son nouvel ami qui avait un garçon et deux filles, dont la cadette, Maroussia, dite Bomba en raison de son caractère explosif, avait à peu près mon âge. La monumentale figure de Bakounine restera pour moi un souvenir indélébile.
Quand je le vis la première fois, il était dans son jardin qu’il faisait retourner de fond en comble. Je me sentais comme le petit Poucet devant l’Ogre. Une vieille houpelande noire à pèlerine lui battait les talons, sa tête s’ombrageait d’un feutre à larges bords d’où s’échappaient de longs cheveux blancs. Il abaissa sur nos deux êtres minuscules un regard bienveillant et sourit, non pas comme un Ogre, mais comme un bon Saint-Nicolas, dans sa barbe frisée.
− Allons, bambini, allez jouer avec Sofia et Bomba.
Nous rejoignons les deux fillettes et leur frère.
− Dis, Bomba, ton padre, il est grand comme un Ogre, est-ce qu’il est méchant ?
− Méchant? Padre Michele? Nous en faisons ce que nous voulons.
En fait, les enfants étaient les maîtres ; même que le vieux Padre Michele, dans ses bons jours, jouait avec nous aux Indiens, apportait le bois des feux que nous allumions et qu’il affectionnait.
− Fuoco, fuoco ! s’exclamait-il devant les langues oranges des flammes qui pétillaient : brûlez, détruisez tout, enfants !
Nous ne nous le faisions pas répéter au grand dam de la jeune femme de Bakounine, une Polonaise maigre, froide mais alerte qui était à bout de forces pour ramener un peu d’ordre dans le désordre apporté par ses enfants et son vieux mari.
Un jour que tout le monde était au jardin, nous traînons dans l’antichambre de la villa un fagot de sarment, du papier, nous frottons des allumettes et « Hardi, fuoco, fuoco ! » Les sarments crépitent, la maison s’emplit de fumée, va brûler. On accourt, on éteint le feu…
Bakounine assiste, impassible : « Mais pourquoi tout ce tralala ? Lasciate fare i bambini − laissez faire les enfants » s’exclame-t-il.
Aussi point n’est besoin de dire que nous adorions notre Padre Michele.
Après avoir dépensé, en vrai communiste, son argent et celui de ses parents et amis, Michel Bakounine était maintenant très pauvre. Mais un espoir s’ouvrait devant lui : une partie de l’héritage familial. Cet espoir lui fit acheter, à crédit la villa qu’il habitait.
La belle-sœur de Michel venait de rentrer de Russie où elle avait négocié avec son frère, Paul Bakounine, le paiement de la part de cet héritage.
Paul Alexandrovitch Bakounine, également un géant, avait reçu la visiteuse dans la «commune familiale» des Bakounine, dans leur propriété du gouvernement de Toula. Quand la noble polonaise fut introduite dans la serre où Paul l’attendait, elle le vit, nudiste avant la lettre, en costume d’Adam, arrosant ses fleurs. L’androïde velu tourna vers elle ses pectoraux de gorille et son ventre de Silène, lui baisa galamment la main, la fit asseoir au milieu des gueules amarantes et des bourses mouchetées de ses orchidées, appesantit son postérieur sur un siège de rotin et engagea la plus cordiale des conversations qui aboutit à la promesse d’envoyer de l’argent à Michel.
En attendant la somme libératrice, Bakounine achevait, au milieu des souffrances de la maladie − une inflammation de la prostate − et des pires difficultés pécuniaires, une vie personnelle malheureuse, aux côtés de sa femme Antossia, sa jeune et froide Polonaise. Il ruminait les insuccès de l’insurrection de Pologne, qu’il avait fomentée, les basses calomnies du principal de ses adeptes Netchaïev, un vrai bandit, dont le maître mot était « à toute vapeur à travers la boue », et pour lequel le fin justifiait tous les moyens, inclus l’assassinat de ses camarades.
La seule consolation de Bakounine était maintenant ma mère et plusieurs révolutionnaires italiens qui l’avaient suivi dans son refuge tessinois. Presque tous les jours, il recevait la visite de l’« illustre professeur » Pederzoli [c’est ainsi que cet homme, qui dispensait des leçons d’italien, fut présentée à la mère de l’auteur] et d’un groupe d’ouvriers dont le plus marquant était Sata Andrea, un cordonnier de Ravenne, jeune homme à la beauté sans égale d’un centurion romain.
En général, un barine russe avait un sens aigu de la démocratie, acquis au contact journalier du peuple avec lequel il vivait à la compagne. Le même fait s’était produit dans l’ancienne France terrienne où le seigneur, tant qu’il avait vécu sur ses domaines, était plus près du serf que du bourgeois.
Ce sens démocratique était un des secrets de l’ascendant de Bakounine sur les masses : il dominait l’humble partisans de toute la hauteur de l’intelligence et du savoir, mais il se faisait adorer de lui par l’intensité qu’il mettait à connaître sa vie et ses besoins.
Voilà donc « Michele » assis, accoudé à sa table branlante sur laquelle s’amoncellent sa provision de tabac et ses manuscrits. Dès son lever, il a fumé et bu tasse sur tasse de son thé ; il est près de minuit, et il continue à fumer et à boire. Comme il fait chaud, il est en chemise et en caleçon ; la lampe éclaire l’humble chambre nue et l’amas de journaux qui jonchent le plancher ; la lumière met en relief son visage léonin et dominateur, ceint de l’argent de sa barbe et de ses cheveux bouclés. L’ours polaire oppose sa puissante masse blanche au sombre groupe de ses disciples méridionaux qui dévorent de l’ardeur de leurs yeux, aux jaunes sclérotiques, leur chef, leur idole, leur cher « Michele ».
Et Bakounine parle : ses prunelles vertes sourient ou fulminent, une ardente conviction allume son discours qui présente avec un relief sans pareil, en un italien impeccable, l’idéal de demain, tout de justice, de bonheur, de dignité humaine. « Et surtout, combattez sans merci tout pouvoir personnel ou collectif, n’admettez que la communauté d’hommes libres et égaux. Tout pouvoir, quel qu’il soit, démoralise et déprave ses détenteurs, toute obéissance à ce pouvoir humilie et abaisse ceux qui lui sont subordonnés. »
Comment expliquer cette influence des révolutionnaires russes sur les hommes d’Occident ? Aucun de ces révolutionnaires n’a pourtant inventé ce qu’il a proclamé. Ce sont les cerveaux de Saint-Simon, de Fourier, de Proudhon, d’Engels, de Marx qui ont édifié le socialisme. Les Russes n’ont été que les commentateurs de ces forgerons du monde nouveau. Mais leur élan, leur enthousiasme, leur foi ont transposé et vivifié la théorie : un Lénine a tenté de réaliser Marx et c’est le léninisme qui, à l’heure actuelle, a essayé de bouleverser le monde.
Au début de l’automne, notre mère nous emmène faire nos adieux au « padre Michele » qui devait partir pour Berne consulter un célèbre docteur de ses amis.
Nous entrons dans la chambre, Bakounine était couché sur son petit lit de fer qui criait sous le poids de son corps. Andrea, le cordonnier de Ravenne, était également là, son beau visage d’albâtre portant la marque de la désolation. Nous nous tenions tous quatre devant le malade. Il était assoupi, sa tête reposait dans l’entremêlement de ses cheveux et, à chaque expiration, il émettait un court gémissement. Il ouvrit les paupières, lentement, nous dévisagea et, en un court moment, je reconnus dans le regard de cet homme si puissant, fondateur d’un mouvement historique, la même expression entrevue, jadis, dans les yeux de l’humble maître de poste, mon grand-oncle, agonisant à Niéstérovo.
En fait, Michel Bakounine mourut quelques semaines après son arrivée à Berne.
Ce portait de Bakounine en vieux papa gâteau est conforme à ce que d’autres témoins ont pu raconter. Je pense que l’auteur voit juste également lorsqu’il s’agit de comprendre l’attachement d’un certain nombre d’hommes du peuple à l’aristocrate russe (même si les explications plus générales qu’il fournit sur la prétendue proximité entre aristocratie et paysannerie sont franchement fantaisistes). En revanche, il y a certaines approximations, bien compréhensibles pour des souvenir rédigés à 60 ans de distance. Par exemple, l’auteur raconte qu’il avait à peu près le même âge que Maroussia, dite Bomba (la future mathématicienne, aussi connue sous le nom de Maria Bakunin), mais il confond visiblement avec Sofia, née comme lui en 1870 (Maroussia était née en 1873, et elle devait n’avoir que deux ans lorsqu’il fit sa connaissance). L’auteur ne donne pas de dates, mais dans la mesure où tout cela se passe à Lugano, où Bakounine s’était installé avec sa petite famille à la fin de l’année 1874, les faits rapportés ont dû commencer au cours de l’année 1875, donc lorsqu’il avait entre 5 et 6 ans (ce qui rend difficilement crédible l’idée que Bakounine mourant lui rappelle son grand-oncle aperçu jadis dans la même situation). J’ajouterais encore que ce n’est pas à l’automne que Bakounine partit vers sa dernière destination, mais en juin 1876 − il mourut le 1er juillet. Quant au récit pittoresque sur l’héritage de Bakounine et la visite de la sœur de sa femme Antonia à son frère Paul, elle ressemble fort à une galéjade. Je soupçonne également certains aspects de cette évocation d’avoir été reconstitués sur la base de la littérature existante − ainsi du discours tenu par Bakounine à ses amis italiens, qui ressemble bien à ce que le révolutionnaire russe a pu écrire, mais guère à ce qu’aurait pu retenir un enfant de 5 ans. Et j’en oublie sans doute, mais au fond qu’importe, puisque reste le principal, avec ce portrait du vieux Bakounine sur ses derniers jours.