Bakounine et le rôle révolutionnaire des déclassés
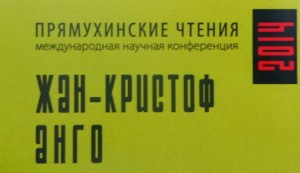 [Je reproduis ici le texte de ma contribution à la récente conférence qui tenue à Priamoukhino, village natal de Bakounine, à l’occasion du bicentenaire de sa naissance. Il s’agit ici du texte original, que Misha Tsovma a traduit en russe à des fins de surtitrage, pendant que je lisais une version anglaise, nettement moins bonne puisque concoctée par mes soins – pour une fois les locuteurs anglophones sont donc désavantagés par rapport aux francophones et aux russophones. Une version de ce texte devrait paraître en russe dans les prochains mois, et une version abrégée a peut-être déjà été publiée dans une revue anarchiste russe, si j’ai tout bien compris (en tout cas, je me renseigne)… L’image ci-contre est une reproduction d’un badge avec mon nom transcrit en russe, fabriqué par les organisateurs de la conférence.]
[Je reproduis ici le texte de ma contribution à la récente conférence qui tenue à Priamoukhino, village natal de Bakounine, à l’occasion du bicentenaire de sa naissance. Il s’agit ici du texte original, que Misha Tsovma a traduit en russe à des fins de surtitrage, pendant que je lisais une version anglaise, nettement moins bonne puisque concoctée par mes soins – pour une fois les locuteurs anglophones sont donc désavantagés par rapport aux francophones et aux russophones. Une version de ce texte devrait paraître en russe dans les prochains mois, et une version abrégée a peut-être déjà été publiée dans une revue anarchiste russe, si j’ai tout bien compris (en tout cas, je me renseigne)… L’image ci-contre est une reproduction d’un badge avec mon nom transcrit en russe, fabriqué par les organisateurs de la conférence.]
Bakounine et le rôle révolutionnaire des déclassés
J’aimerais, dans cette contribution, m’intéresser à l’un des aspects des écrits de Bakounine qui entre le plus en résonance avec l’actualité des mouvements révolutionnaires, à savoir le rôle révolutionnaire qu’il reconnaît à des groupes sociaux ou nationaux qui sont habituellement négligés par les socialistes de son temps, et qui plus généralement l’ont été dans l’histoire du marxisme. D’un point de vue social, je veux parler de la paysannerie, de la jeunesse, des bandits, de ceux que le marxisme a pris l’habitude de réunir sous l’appellation infamante de Lumpenproletariat (sous-prolétariat ou prolétariat en haillons) et de ceux que Bakounine lui-même qualifie de déclassés. D’un point de vue national, cela correspond aux pays dans lesquels de telles couches sociales sont fortement représentées et cela renvoie à des nations qui ne sont pas complètement intégrées à la domination capitaliste.
Par conséquent, dans cette contribution, je prendrai le parti de considérer Bakounine moins comme le penseur d’un anarchisme théorique que comme représentant de l’anarchisme révolutionnaire. J’entends par là non seulement que Bakounine fait de l’anarchie, entendue comme libre organisation d’une société libérée de l’État, le but de la révolution, mais aussi qu’il s’intéresse à l’anarchie en acte que constitue le processus révolutionnaire. Il est frappant en effet que Bakounine n’a jamais entrepris d’exposé de ses idées politiques et philosophiques qui fût détaché des exigences pratiques du moment et qu’il a consacré la plupart de ses écrits à déceler les potentialités révolutionnaires que recelaient telle ou telle situation historique à laquelle il était confrontée. Revenir sur cet aspect de l’activité théorique de Bakounine me semble important pour au moins deux raisons : la première, c’est qu’en cette année de commémoration, il me semble important d’éviter toute forme de canonisation de cette grande figure de l’anarchisme historique, et en particulier d’éviter de tirer de ses écrits quelque chose comme une théorie originale de la société, de l’économie, de l’organisation politique, etc., toutes choses qu’il est sans doute très difficile d’y trouver ; la seconde, c’est que ce qu’écrit Bakounine des processus révolutionnaires me semble particulièrement éclairant lorsque l’on cherche à appréhender les mouvements révolutionnaires ou contestataires qui ont secoué, avec une intensité variable, différentes parties du globe ces dernières années : « printemps arabe », dont le nom même évoque ce « printemps des peuples » de 1848 dont Bakounine fut l’une des figures emblématiques, mouvement des Indignados (ou du 15M) en Espagne, Occupy aux États-Unis, contestation en Russie et plus récemment encore certains aspects du soulèvement populaire de Kiev.
Classes et révolution dans le marxisme
S’il est intéressant de chercher à éclairer notre appréhension de ces mouvements à partir de ce que Bakounine a pu écrire de la manière dont il concevait le processus révolutionnaire, c’est aussi que nous vivons à une époque où la théorie marxiste de la révolution, dans ses différentes variantes, peut difficilement être assumée, et se trouve d’ailleurs grandement mise en échec par la forme qu’ont revêtue les mouvements auxquels je viens de faire allusion. Au risque de simplifier, d’homogénéiser à l’excès et donc d’occulter ce qu’il peut y avoir encore d’intéressant pour nous dans ces théories, il faut d’abord rappeler quelques thèmes structurants des conceptions marxistes de la révolution et du sujet révolutionnaire, qui permettront de faire mieux ressortir, a contrario, l’originalité et la fécondité des conceptions bakouniniennes. À nouveau, ces conceptions peuvent être restituées à l’échelle d’une nation déterminée, du point de vue donc des classes sociales qui la composent, mais aussi à l’échelle internationale, du point de vue des nations qui sont considérées comme pouvant connaître une révolution – et il est clair que le premier point de vue détermine en grande partie (mais pas totalement) le second. Pour Marx et Engels, au moins depuis le Manifeste communiste (1847), l’histoire de toute société est déterminée par une lutte pour la domination entre les classes sociales qui la composent. Cela signifie que les sociétés qui ne connaissent pas de structure de classe sont en dehors de l’histoire et qu’il ne saurait y avoir de révolution sans que les classes dominées renversent la domination qu’elles subissent. Le clivage qui tend de plus en plus à prédominer dans l’histoire des sociétés, en tant que celle-ci tend à faire triompher le mode de production capitaliste, c’est celui qui sépare les propriétaires des moyens de production et ceux qui ne possèdent rien d’autre que leur force de travail et sont donc contraints de la vendre. Cette perspective s’appuie sur le pronostic que les classes sociales intermédiaires seront de plus en plus résorbées dans ces deux classes, que Marx et Engels désignent comme la bourgeoisie et le prolétariat : par exemple, les travailleurs indépendants (petits artisans, petits commerçants, petits paysans) sont condamnés dans leur écrasante majorité à rejoindre les rangs du prolétariat, lequel constitue la classe dominée, qui peut seule valoir dès lors pour sujet révolutionnaire. D’un point de vue international, le fait de reconnaître cette tendance historique a une conséquence immédiate : c’est évidemment dans les pays où le capitalisme industriel se développe, et où par conséquent le clivage entre bourgeoisie et prolétariat devient structurant pour la société, que l’on a le plus de chance de rencontrer des mouvements révolutionnaires allant dans un sens communiste.
Il faut maintenant souligner quelques éléments qui viennent compliquer ce schéma, et souligner les problèmes politiques qu’il pose. Tout d’abord, la division de la société en deux classes antagonistes n’est pas complètement achevée au moment où Marx et Engels écrivent, et on pourrait d’ailleurs soutenir qu’elle n’est toujours pas achevée aujourd’hui, pour d’autres raisons. De fait, subsiste encore aujourd’hui une classe de travailleurs indépendants, que ce soit dans l’artisanat, le commerce ou l’agriculture. Ce fait, dont Marx et Engels sont partiellement conscients, les conduit à se demander ce que pourrait et devrait être l’attitude politique de ces groupes sociaux qui ne sont intégrés ni à la bourgeoisie, ni au prolétariat industriel. Mais de surcroît, le développement ultérieur du capitalisme a fait surgir des couches sociales qui, si elles semblent relever formellement du prolétariat, ou plus exactement du salariat, ont néanmoins un statut moins net – ce qui tient notamment au développement du tertiaire, mais aussi des services publics. Quel est par exemple le statut des étudiants, des enseignants, et de tout le prolétariat intellectuel ? Pour toutes ces couches de la population (émergentes ou résistantes), qui peuvent finir par être majoritaires en regard du seul prolétariat industriel dans certains pays, on va voir que se pose un problème politique aigu : doivent-elles renoncer à la révolution en attendant que les conditions objectives soient réunies, comme on dit ? Le problème est encore compliqué par le fait que Marx et Engels prennent acte de l’existence de populations déclassées, qu’ils désignent parfois sous le nom de Lumpenproletariat (soit prolétariat en haillons) bien qu’il regroupe des éléments issus de milieux sociaux les plus divers (chômeurs, voleurs, souteneurs, etc.).
Le deuxième élément qui vient compliquer ce schéma d’ensemble, c’est la prise en compte du facteur national. En effet, bien que la perspective adoptée par Marx et Engels dès le Manifeste soit globale (« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! »), il reste que, comme vont bien vite le prouver les révolutions de 1848, les révolutions continuent à se produire dans un cadre national, et Marx et Engels n’hésitent pas à promouvoir les luttes qui prennent pour enjeu la construction d’un tel cadre (en Italie et surtout en Allemagne), avec l’idée que la construction d’un pouvoir national centralisé ne peut que favoriser sa saisie par le prolétariat révolutionnaire (c’est la même logique qui, par la suite, les poussera dans certaines circonstances à favoriser le suffrage universel, comme moyen permettant au prolétariat de parvenir au pouvoir par les urnes). De sorte qu’il s’agit d’appliquer l’analyse politique en termes de classes à la situation de chaque pays, ce à quoi Marx s’est par exemple employé dans ses deux textes écrit au lendemain de la révolution française de 1848 (Les luttes de classes en France et Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte). Il s’agit alors non plus de pronostiquer que la révolution de l’avenir verra le prolétariat triompher de la domination bourgeoise, mais plutôt de proposer une analyse en termes de classes d’une révolution qui a eu lieu, ce qui conduit Marx à assigner à chaque classe ou groupe social un comportement bien déterminé : si les attitudes respectives de la noblesse, de la bourgeoisie et du prolétariat industriel permettent de vérifier les analyses du Manifeste, les cas de la paysannerie, des professions indépendantes et surtout de ce que Marx désigne comme Lumpenproletariat font apparaître des difficultés dans l’application de ce schéma qui corrèle la position politique à l’appartenance de classe.
Mais cette prise en compte de la nation ne s’arrête pas au cadre national dans lequel interviennent les révolutions, elle s’étend à des considérations géopolitiques. De même que certaines classes semblent condamnées par Marx et Engels à servir de supplétifs à la réaction (paysannerie), à accomplir ses basses œuvres (Lumpenproletariat) ou à tergiverser entre bourgeoisie et prolétariat (la petite bourgeoisie), certaines nations semblent destinées à ne pas connaître de révolution démocratique et sociale, à ne pouvoir recevoir le progrès que de l’extérieur et, faute que cela advienne, à fournir des troupes pour l’écrasement des soulèvements démocratiques. C’est ce qui ressort notamment de la réponse formulée par Engels à l’Appel aux Slaves de Bakounine, au début de l’année 1849 : la seule manière pour les peuples slaves de connaître une modernisation économique et politique, c’est d’accepter la domination allemande et la diffusion du capitalisme, faute de quoi ils seront simplement les instruments des cours européennes, comme le prouve leur enrôlement dans les armées russe et autrichienne. Ce qui se dessine ainsi, c’est l’idée selon laquelle l’Allemagne devrait constituer le fer de lance de la civilisation en Europe centrale, parce que c’est par elle que passe la modernité capitaliste, laquelle peut seule permettre l’éclosion d’une classe prolétarienne porteuse du projet de révolution communiste.
Cette conception des rapports entre classes et révolution pose au moins trois problèmes. Tout d’abord, elle est soumise à une philosophie de l’histoire très lourde qui veut que le cours de l’histoire soit orienté téléologiquement vers l’avènement du communisme et que cet avènement ne puisse intervenir qu’en opérant le passage par le mode de production capitaliste, de sorte que tout ce qui s’oppose à ce cours nécessaire de l’histoire est rejeté au mieux dans la nostalgie improductive et la résistance dérisoire et inutile, et au pire dans la réaction objective. En deuxième lieu, une telle conception est paralysante du point de vue de l’action révolutionnaire : elle n’offre d’autre perspective aux pays en cours d’industrialisation que d’attendre le développement du prolétariat industriel et son organisation par le procès même de concentration du capital pour que, les « conditions objectives » étant enfin réunies, la révolution soit possible ; et elle n’offre d’autre perspective aux pays qui ne sont pas intégrés dans ce processus de modernisation industrielle que de s’y soumettre pour pouvoir participer à l’histoire universelle. Autrement dit, elle a pour résultat paradoxal (et profondément démoralisant) qu’elle suppose le triomphe (présumé temporaire) du capitalisme. En troisième lieu, comme le montre l’évolution de Marx entre le Manifeste et ses textes sur les révolutions de 1848, une telle conception s’avère impuissante à rendre compte des révolutions effectives (et non celles dont rêvent Marx et Engels). Ce qui valait d’ailleurs pour les révolutions intervenues du vivant de ces deux auteurs vaut tout autant pour celles qui ont éclaté après eux tout en se réclamant d’eux (les deux principaux pays qui se sont réclamés du marxisme étaient des pays à dominante agricole et paysanne) et surtout pour celles auxquelles nous assistons aujourd’hui.
Bakounine de la question nationale à la question sociale : le statut des paysans
Je me propose à présent de présenter la manière dont Bakounine a pu proposer une conception alternative des forces en jeu dans tout processus révolutionnaire. Pour cela, je vais d’abord partir de ce qui constitue un élément de continuité dans tout le parcours politique de Bakounine, à savoir son attachement à une révolution qui ne concernerait pas que les pays les plus avancés sur la voie de la civilisation industrielle. C’est en effet l’un des motifs constants de l’engagement de Bakounine que d’avoir cherché à penser les conditions d’une révolution, notamment en Russie, mais plus largement dans des sociétés faiblement soumises au capitalisme industriel. Outre qu’il tient aux préoccupations de Bakounine, qui n’a cessé d’espérer que son pays natal connaîtrait un jour une révolution, ce souci s’appuie sur un constat : le poids de la paysannerie dans la plupart des pays d’Europe oblige les révolutionnaires à prendre en compte ses revendications. S’il faut attendre qu’elle soit transformée par l’expansion du capitalisme, plusieurs générations seront sacrifiées. L’exigence d’une révolution qui ne soit pas seulement ouvrière est donc aussi un refus de l’attentisme. Lorsque des millions d’être humains subissent l’oppression, il ne peut être question d’attendre que les conditions sociales parviennent à une prétendue maturité qui les rendrait propices au déclenchement d’une révolution.
Dans la première période de son parcours révolutionnaire, cet attachement à une révolution démocratique qui n’attendrait pas l’expansion capitaliste s’est surtout exprimée chez Bakounine à propos de la question slave, en particulier au moment des révolutions de 1848. Ces révolutions, qui ne furent pas seulement des soulèvements démocratiques et ouvriers (comme ce fut le cas en France, en Allemagne et en Autriche), mais aussi des soulèvements nationaux, qu’il s’agisse de réaliser l’unité politique de nations morcelées (Allemagne et Italie) ou de se soustraire à des dominations impériales (peuples soumis à l’Autriche et à la Russie), ont d’emblée posé un problème : celui de l’articulation entre ces différentes dimensions révolutionnaires, et le risque de l’instrumentalisation de l’une contre les autres. C’est de ce problème que traite l’Appel aux Slaves de Bakounine, qui souligne que la question sociale, en tant qu’elle suscitait des mobilisations spécifiquement ouvrières, pouvait être utilisée par les conservateurs pour revenir sur les révolutions démocratiques, ou encore que les aspirations nationales des Slaves pouvaient être utilisées contre celles des Allemands et des Magyars. Il est clair que la tentative d’un Bakounine isolé de tenir ensemble toutes ces composantes des révolutions de 1848 fut un échec, qu’il paya personnellement et lourdement, par huit années d’emprisonnement dans différentes forteresses (1849-1857) puis quatre années d’exil en Sibérie (1857-1861). Il me semble néanmoins que cet échec, quel que soit le rôle qu’aient pu y jouer les aspirations chimériques du révolutionnaire russe, doit aussi être apprécié comme le résultat d’un refus de se soumettre à la nécessité de l’histoire.
C’est dans une continuité partielle avec ces tentatives que Bakounine reprend, à partir de la fin des années 1860, son questionnement sur les conditions de possibilité dans les pays qui restent à dominante rurale. Cela concerne toujours les pays slaves, mais aussi un pays comme l’Italie. Dans sa Lettre à La Liberté de Bruxelles du 29 août 1871, il commence ainsi par reconnaître le retard de l’Italie dans le « développement de la production monopolisée par le capital » (I, 81). Mais ce retard n’empêche pas selon lui qu’une révolution sociale puisse intervenir dans ce pays, avec le soutien de la paysannerie, dont les orientations antiétatiques sont nettement affirmées. Deux ans plus tard, la dernière partie d’Étatisme et anarchie développe amplement cette question, en reprochant à Marx l’orientation exclusivement ouvrière de la révolution qu’il projette et qui conduit à placer les paysans sous la direction des ouvriers :
« Si le prolétariat devient la classe dominante, qui, demandera-t-on, dominera-t-il ? C’est donc qu’il restera encore une classe soumise à cette nouvelle classe régnante, à cet État nouveau, ne fût-ce, par exemple, que la plèbe des campagnes, qui, on le sait, n’est pas en faveur chez les marxistes et qui, située au plus bas degré de la civilisation sera probablement dirigée par le prolétariat des villes et des fabriques ; ou bien, si l’on considère la question d’un point de vue ethnique, disons, pour les Allemands, la question des Slaves, ceux-ci se trouveront, pour la même raison, vis-à-vis du prolétariat allemand victorieux, dans une sujétion d’esclave identique à celle de ce prolétariat par rapport à la bourgeoisie. » (IV, 346 [278])
Si dans les années 1840, Bakounine pouvait être tenté de proposer une analogie entre les Slaves et le prolétariat, à partir de cette idée que la classe ou la nation qui conquiert en dernier un rôle politique est aussi celle qui va le plus loin dans l’émancipation, au moment de son engagement explicitement anarchiste, il envisage simplement sous deux biais différents la même question paysanne. Au sein de chaque nation, la dictature du prolétariat, telle qu’il la comprend, aboutirait de fait à une dictature sur la paysannerie. Mais en tant que certaines nations sont plus rurales que d’autres, elle aboutirait nécessairement à la dictature des nations les plus avancées, où la classe ouvrière est parvenue à la domination, sur les nations en retard, où domine encore la paysannerie. S’il demeure toutefois un élément de continuité entre ces deux périodes de l’engagement révolutionnaire de Bakounine, il réside dans l’identification de la civilisation à la bourgeoisie et aux nations dans lesquelles elle domine, ce qui fait apparaître les classes non intégrées au capitalisme et les nations dans lesquelles elles prédominent comme un élément de barbarie susceptible de venir régénérer la civilisation.
La réponse de Marx à cette accusation, lorsqu’il en prendra connaissance en lisant directement en russe Étatisme et anarchie, permet de prendre la mesure du décalage entre ce qu’il soutient et ce que Bakounine lui attribue, mais aussi de l’écart qui subsiste entre les deux auteurs. En premier lieu, Marx nie que la paysannerie fasse partie du prolétariat, sauf dans les pays, comme l’Angleterre, où règne l’exploitation capitaliste de la terre et où la paysannerie a été remplacée par le salariat agricole. Par conséquent, trois cas de figure sont possibles en cas de révolution prolétarienne. Le premier est celui qu’a déjà vécu la France : la paysannerie s’unit aux classes dominantes pour faire échouer la révolution. C’est une manière pour Marx de rappeler le rôle historiquement réactionnaire qu’a joué la paysannerie. Le deuxième, que Marx considère avec le plus de faveur, consisterait pour le nouveau pouvoir ouvrier à prendre des mesures favorables au paysan, afin de le gagner à la cause de la révolution, mais des mesures qui « en même temps facilitent le passage de la propriété privée de la terre à la propriété collective, de sorte que le paysan, de lui-même, en arrive là par la voie économique. »1 Le dernier cas de figure est celui que soutient Bakounine : l’abolition du droit d’héritage et le démantèlement des grands domaines pour redistribuer la terre aux paysans. Pour Marx, la première de ces deux mesures n’a de pertinence que là où le salariat agricole a déjà remplacé la paysannerie ; quant à la seconde, elle conduit à « renforcer la propriété parcellaire » et il convient par conséquent de s’y opposer.
Contrairement à l’image bakouninienne d’un Marx viscéralement hostile à la paysannerie, il apparaît que les deux auteurs sont au moins en accord sur un point : il est vital de gagner la paysannerie à la cause de la révolution sociale et celle-ci ne peut advenir sans (au moins) la neutralité bienveillante de la paysannerie. C’est sur les moyens de s’attirer les faveurs de la paysannerie qu’ils divergent. Bakounine considère que le meilleur moyen consiste à satisfaire les intérêts immédiats des paysans, à introduire la discorde dans les campagnes et à détourner l’hostilité paysanne vers les grands propriétaires (comme le disaient les Dead Kennedys dans leur style inimitable, Let’s Lynch the Landlords!). Mais plus fondamentalement, c’est sur le rôle du politique qu’ils divergent. Pour Marx, le passage de la propriété privée de la terre à la propriété collective implique une intervention politique, des mesures qui le facilitent. Pour Bakounine, peut-être marqué par les structures collectives qui prévalent en Russie, distribuer la terre aux paysans tout en ne maintenant de la propriété que le fait de la possession laisse les paysans libres de s’associer. Et comme le travail en coopération est plus efficace que le travail isolé, les paysans, âpres au gain, ne tarderont pas à s’associer en coopératives. Au volontarisme de l’État, Bakounine oppose donc le développement spontané des formes sociales.
C’est pourtant le volontarisme aveugle que Marx reproche à Bakounine à propos des pays slaves. En prétendant qu’une révolution sociale serait possible en terre slave, Bakounine commettrait une « ânerie d’écolier » car « une révolution sociale radicale est liée à certaines conditions historiques de développement économique, qui en sont les prémisses. » La principale de ces conditions, c’est que « le prolétariat industriel occupe pour le moins une place importante dans la masse du peuple. » Parce qu’il refuse de prendre en considération ces conditions, Bakounine « ne comprend absolument rien à la révolution sociale » ; d’où cette conclusion cinglante : « la volonté, et non les conditions économiques, telle est la base de sa révolution sociale. »2 Mais l’on pourrait tout aussi bien retourner l’argument et dénoncer la position de Marx comme attentiste. Pour Bakounine, attendre que se développe dans les pays slaves un prolétariat industriel, avec pour corrélat une extension de la production capitaliste aux campagnes, c’est admettre le sacrifice de plusieurs générations, particulièrement lourd si l’on songe à la misère qui a accompagné le développement du prolétariat urbain, par exemple en France et en Angleterre. Toutefois, ces Notes critiques ne présentent pas le dernier état de la pensée de Marx sur la question, puisqu’à la fin de sa vie, celui-ci en viendra à envisager qu’une révolution sociale puisse avoir lieu avant que le prolétariat industriel ait acquis une position dominante au sein du peuple. Or ces corrections interviendront précisément à propos de la Russie3. De son côté, c’est parce qu’il estime qu’une révolution sociale est possible en Russie que Bakounine, depuis 1868, a repris la propagande en direction de son pays natal. Cette activité ne s’interrompt pas au cours des années suivantes et constitue une part importante de ses écrits et de sa correspondance4.
Bandits, jeunes et déclassés : la révolution hors-classe
Plus profondément, autour des dernières pages d’Étatisme et anarchie, Marx et Bakounine divergent en deux endroits sur la question de la dictature de prolétariat : d’une part sur le rôle historique de la classe ouvrière, d’autre part, mais moins nettement qu’on pourrait le croire, sur la question de la dictature elle-même. Il y a une divergence profonde entre Marx et Bakounine s’agissant de l’appréciation du caractère révolutionnaire de telle ou telle couche sociale. En la matière, Marx s’en tient à insister sur le nécessaire accroissement du rôle joué par le prolétariat industriel, ce qui le conduit à nier à la paysannerie toute capacité d’initiative révolutionnaire, mais aussi à rejeter la partie inférieure du prolétariat, dénigrée comme Lumpenproletariat, ou prolétariat en haillons. Dans plusieurs textes, Bakounine s’en prend à cette exclusion, qu’il considère comme le signe d’un attachement de Marx à la civilisation bourgeoise. Quelle que soit la valeur de cette attaque, elle exprime une divergence réelle entre les deux auteurs. Comme il l’explique par exemple dans sa longue lettre à Netchaïev du 2 juin 1870, les militants révolutionnaires ne peuvent ignorer « le monde des vagabonds, des brigands et des voleurs, profondément enraciné dans notre vie populaire, et constituant un de ses principaux phénomènes. » Certes, admet Bakounine, « utiliser le monde des brigands comme instrument de la révolution populaire […] est une tâche difficile », et il avoue que les hommes de sa génération « en sont incapables » en raison de leur éducation. Mais plus loin, il explique ce que signifie cette utilisation révolutionnaire des brigands :
« Aller vers les brigands ne signifie pas devenir soi-même un brigand et rien qu’un brigand ; cela ne signifie pas partager leurs passions, leurs misères, leurs mobiles souvent odieux, leurs sentiments et leurs actes ; cela signifie leur donner une âme nouvelle et éveiller en eux le besoin d’un but différent, d’un but populaire ; ces hommes farouches et durs jusqu’à la cruauté ont une nature vierge, intacte et pleine de vitalité, et par conséquent accessible à une propagande vivante, si tant est qu’une propagande bien entendu vivante et non doctrinale ose et puisse les approcher. » (V, 234)
Même si un tel projet a pour horizon la réalité sociale russe, on peut y voir la source de la revalorisation fréquente chez Bakounine de la « canaille populaire. » Dès 1868, il s’oppose ainsi à ces révolutionnaires « qui ont une si grande habitude de l’ordre créé par une autorité quelconque d’en haut et une si grande horreur de ce qui leur paraît les désordres et qui n’est autre chose que la franche et naturelle expression de la vie populaire, qu’avant même qu’un bon et salutaire désordre se soit produit par la révolution, [ils rêvent] déjà la fin et le musellement par l’action d’une autorité quelconque qui n’aura de révolutionnaire que le nom. » La révolution doit au contraire se définir comme « le déchaînement de ce qu’on appelle aujourd’hui les mauvaises passions » et comme « la destruction de ce qui dans la même langue s’appelle »l’ordre public ». »5
L’intérêt que Bakounine porte à des éléments délictueux, qui seraient à même d’incarner la dimension négative de la révolution, s’inscrit dans un intérêt plus large pour des éléments qui ne sont pas révolutionnaires en raison de leur seule appartenance de classe. On peut d’ailleurs remarquer que, discrètement, Bakounine s’oppose aux tentations ouvriéristes d’une partie de l’Internationale, qui s’opposait à l’adhésion des « ouvriers de la pensée ». Bien que le rejet de ces éléments étrangers à la classe ouvrière ait été défendu par des délégués qu’il ne porte guère dans son cœur (notamment le proudhonien de droite Tollain), Bakounine reconnaît que cette défiance ouvrière découle de l’instinct socialiste des prolétaires, car il est vrai « qu’il est très difficile à un enfant de la bourgeoisie de vouloir sincèrement toutes les conditions et toutes les conséquences de la justice et de l’égalité. » (I, 212 [37]) Mais Bakounine ne s’oppose pas moins à l’injustice de ce qu’il considère comme un préjugé6, ce qui lui permet de mettre en avant le caractère révolutionnaire d’éléments qui n’appartiennent stricto sensu pas à la classe ouvrière : paysans, sous-prolétaires, jeunes et déclassés.
Ainsi, à propos de l’Italie, il remarque que les associations ouvrières commencent à échapper à l’influence mazzinienne, à se détourner des questions politiques et à « faire place aux idées socialistes dans leur sein. » Dès lors, pour que l’Internationale puisse s’établir fermement dans la péninsule, « il ne manque que des initiateurs, des semeurs, et c’est précisément ces derniers qu’il faut former. » Pour cette tâche, Bakounine compte sur les éléments de la jeunesse instruite qui se sont détournés de leur milieu d’origine :
« Il existe maintenant en Italie une grande masse de gens nés dans la classe bourgeoise, mais qui ayant dédaigné d’un côté le service de l’État, et n’ayant point trouvé de place ni dans l’industrie ni dans le commerce, se trouvent complètement déplacés et désorientés.
Ils ont été touchés par l’esprit du siècle, et fatigués de contempler la beauté mystique de Dante et la grandeur de la Rome antique, ils se sont faits en masse des libres penseurs, au grand désespoir de Mazzini. De la libre pensée au socialisme, il n’y a qu’un pas qu’il faut les aider à franchir. »7 (I, 82)
C’est dans cette perspective que s’inscrivent les nombreux appels que Bakounine lance à la jeunesse d’Italie, mais aussi à « la jeunesse déclassée et lettrée de la Russie. »8 Cette valorisation du rôle politique de la jeunesse réfléchit peut-être l’itinéraire de Bakounine lui-même, jeune noble qui quitta l’armée, dédaigna la carrière de fonctionnaire et refusa de s’occuper du domaine familial, préférant la philosophie, puis la carrière de révolutionnaire. Les projets de Bakounine en direction de la jeunesse reposent sur ce constat qu’une part de plus en plus importante de cette dernière ne trouve pas sa place dans la société, et qu’elle est dès lors disposée à remettre en cause l’ordre social tout entier. Un fragment de La théologie politique de Mazzini définit le rôle de le jeunesse par rapport au prolétariat :
« Jeunes gens qui voulez vous sauver de la gangrène qui a gagné et qui dévore aujourd’hui le corps de la bourgeoisie tout entière, prenez le plus souvent possible des bains de vie populaire. Plongez-vous dans le peuple, vivez avec lui et pour lui. Ayez du cœur pour ses misères et pour ses douleurs ; considérez-le non plus comme un instrument nécessaire à la réalisation de vos idées politiques, mais comme le but suprême de tous vos efforts. Apprenez à l’aimer et à le respecter, et comprenez que si vous avez beaucoup de choses à lui enseigner, vous en avez encore plus à apprendre de lui. En retour des pensées que vous lui apporterez, il vous apportera toute la richesse de ses instincts. Vous lui donnerez les formules de la vie, il vous donnera la vie. De l’union de votre pensée avec son instinct naîtra la vie populaire. » (I, 220 [54-55] n.) (Idem I, 258)
Bakounine conçoit ici le rôle révolutionnaire de la jeunesse italienne sur le modèle d’un mouvement qui commence à se répandre dans la jeunesse russe, et au développement duquel il n’a pas peu contribué, un mouvement qui consiste à « aller au peuple. »9 Il ne s’agit pas d’inciter la jeunesse à devenir elle-même ouvrière ou paysanne – comme une partie de la jeunesse protestataire en France au lendemain de mai 1968. Il s’agit au contraire que se produise une rencontre entre la vie et la théorie, entre les instincts populaires, qui seuls portent la vitalité sociale, et leur formulation. Pour Bakounine, cette rencontre ne bénéficie à aucun des deux termes plus qu’à l’autre, puisqu’elle permet à la fois au peuple de rendre ses aspirations audibles et à la jeunesse de participer au « mouvement si vivant, si puissant aujourd’hui, de la réelle émancipation populaire. » (I, 258 [123]) Il est vrai que les appels de Bakounine en direction de la jeunesse russe contiennent la recommandation suivante : « Quittez ces universités, ces académies et ces écoles dont on vous chasse maintenant, et dans lesquelles on n’a jamais cherché qu’à vous séparer du peuple. Allez dans le peuple, là doit être votre carrière, votre vie, votre science. » Mais cette recommandation ne signifie pas que les étudiants doivent se muer eux-mêmes en travailleurs manuels, car ce qu’il s’agit d’apprendre « au milieu de ces masses aux mains durcies par le travail », c’est la manière dont il est possible de « servir la cause du peuple. » Et sur ce point, Bakounine affirme déjà en 1869 à propos de la Russie, le rôle qu’il conçoit également deux ans plus tard pour la jeunesse italienne :
« Rappelez-vous bien, frères, que la jeunesse lettrée ne doit être ni le maître, ni le protecteur, ni le bienfaiteur, ni le dictateur du peuple, mais seulement l’accoucheur de son émancipation spontanée, l’unisseur [sic] et l’organisateur des efforts et de toutes les forces populaires.
Ne vous souciez pas en ce moment de la science au nom de laquelle on voudrait vous lier, vous châtier. Cette science officielle doit périr avec le monde qu’elle exprime et qu’elle sert ; et à sa place, une science nouvelle, rationnelle et vivante, surgira, après la victoire du peuple, des profondeurs mêmes de la vie populaire déchaînée. »10
À travers ses appels à la jeunesse, ce que cherche à concevoir Bakounine, c’est une forme d’alliance inédite entre les deux pôles dont il ne cesse d’observer une tension depuis le début des années 1840 : la jeunesse instruite est en effet la représentante de la théorie, même si ses tendances populistes ou nihilistes entraînent son exclusion des universités, alors que le peuple est l’incarnation de la pratique, du développement spontané de la vie sociale indépendamment de toute théorie. La seule alliance qui soit alors possible entre théorie et pratique consiste en ce que la jeunesse instruite exprime les aspirations du prolétariat, contribue à l’élaboration de cette science sociale vivante qui serait le fidèle reflet de l’évolution économique et sociale spontanée. Cette manière de se mettre au service du peuple ou du prolétariat ne place pas la jeunesse instruite à la remorque de ce dernier, s’il est vrai que les aspirations qu’elle formule ne sont pas les désirs mortifères qui peuvent parfois s’emparer du peuple.
L’insistance de Bakounine sur les tendances révolutionnaires de la jeunesse instruite, du sous-prolétariat et de la paysannerie constitue une remise en cause importante du schéma marxiste qui affirme une structuration de la société en classes et qui fait de la lutte entre ces dernières le moteur du devenir historique. Elle est particulièrement intéressante pour nous aujourd’hui. Il est indéniable que le fait qu’une partie importante de la population possède à la fois un niveau élevé d’instruction et ne parvienne pas à trouver sa place dans une société constitue un facteur très puissant de révolution. De fait, en Égypte et en Tunisie, ce sont notamment de jeunes instruits issus de classes moyennes en crise qui ont provoqué l’écroulement de régimes arbitraires et corrompus. Cela fait confluer les analyses de Bakounine avec celles qui avaient été proposées dans les années 1960 par Marcuse ou par les situationnistes, autour de la question de savoir si une révolution était encore possible dès lors que le capitalisme tardif semblait constituer une machine à intégrer et que le prolétariat industriel, notamment au travers de ses organisations politiques et syndicales, semblait avoir renoncé à renverser la domination capitaliste. Il y a bien chez Bakounine la dénonciation d’une tendance à l’embourgeoisement de certaines composantes du monde ouvrier, tendance qu’il faut moins comprendre en termes sociaux qu’en termes politiques : l’embourgeoisement signifie ici l’acceptation des règles du jeu de la démocratie bourgeoise. Comparativement, l’existence de groupes sociaux, de plus en plus larges, qui ne sont pas intégrés au jeu de la négociation, des élections, de la recherche de travail, constitue donc un facteur de révolutions. Mais il ne faut jamais oublier que la constitution de ces groupes est aussi liée au fait que l’État, dans tous les pays, prend de plus en plus une allure prédatrice : si la révolution peut être une fête, ce n’est jamais contre des choses bien réjouissantes que les révolutions surgissent.
1. Marx/Bakounine, Socialisme autoritaire ou libertaire, 2, édition citée, p. 376.
2. Ibid., p. 376-377 (Marx souligne).
3. Voir les réponses à Véra Zassoulitch et à Mikhailovski in Marx, Œuvres, t. II, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p. 1555-1557.
4. Deux volumes des Œuvres complètes publiées aux éditions Champ Libre, outre Etatisme et anarchie, sont consacrés aux relations slaves de Bakounine : le vol. V pour ses relations avec le seul Netchaïev, le vol. VI pour le reste.
5. Programme et objet de l’organisation révolutionnaire des Frères internationaux (automne 1868), p. 4.
6. L’autre préjugé que combat Bakounine, c’est celui qui concerne la richesse : « Ne calomnions donc pas la richesse, elle est une condition de notre humanité, et sans elle nous ne saurions accomplir le moindre progrès. Ce qui démoralise, c’est l’accaparement des richesses entre des mains privilégiées et nécessairement oisives ; ce sont les jouissances matérielles et même intellectuelles et morales, non accompagnées de travail ou surpassant la quantité, l’intensité ou la peine du travail. » (I, 263 [133]) L’Adresse de février 1872 revient dans les mêmes termes sur la participation d’éléments issus de la bourgeoisie à l’Internationale (III, 74-75 [124-128] n.)
7. Voir aussi la lettre à Francesco Mora du 5 avril 1872 : « il y a en Italie ce qui manque aux autre pays : une jeunesse ardente, énergique, tout à fait déplacée, sans carrière, sans issue, et qui malgré son origine bourgeoise n’est point moralement et intellectuellement épuisée comme la jeunesse bourgeoise des autres pays. » (Bakounine souligne)
8. Quelques paroles à mes jeunes frères en Russie (septembre 1869), in Le socialisme libertaire, édition citée, p. 205
9. Ibid., p. 210 : « L’union de cette jeunesse avec le peuple, voilà le gage du triomphe populaire. » (Bakounine souligne)
10. Ibid., p. 210-211 (souligné par l’auteur).